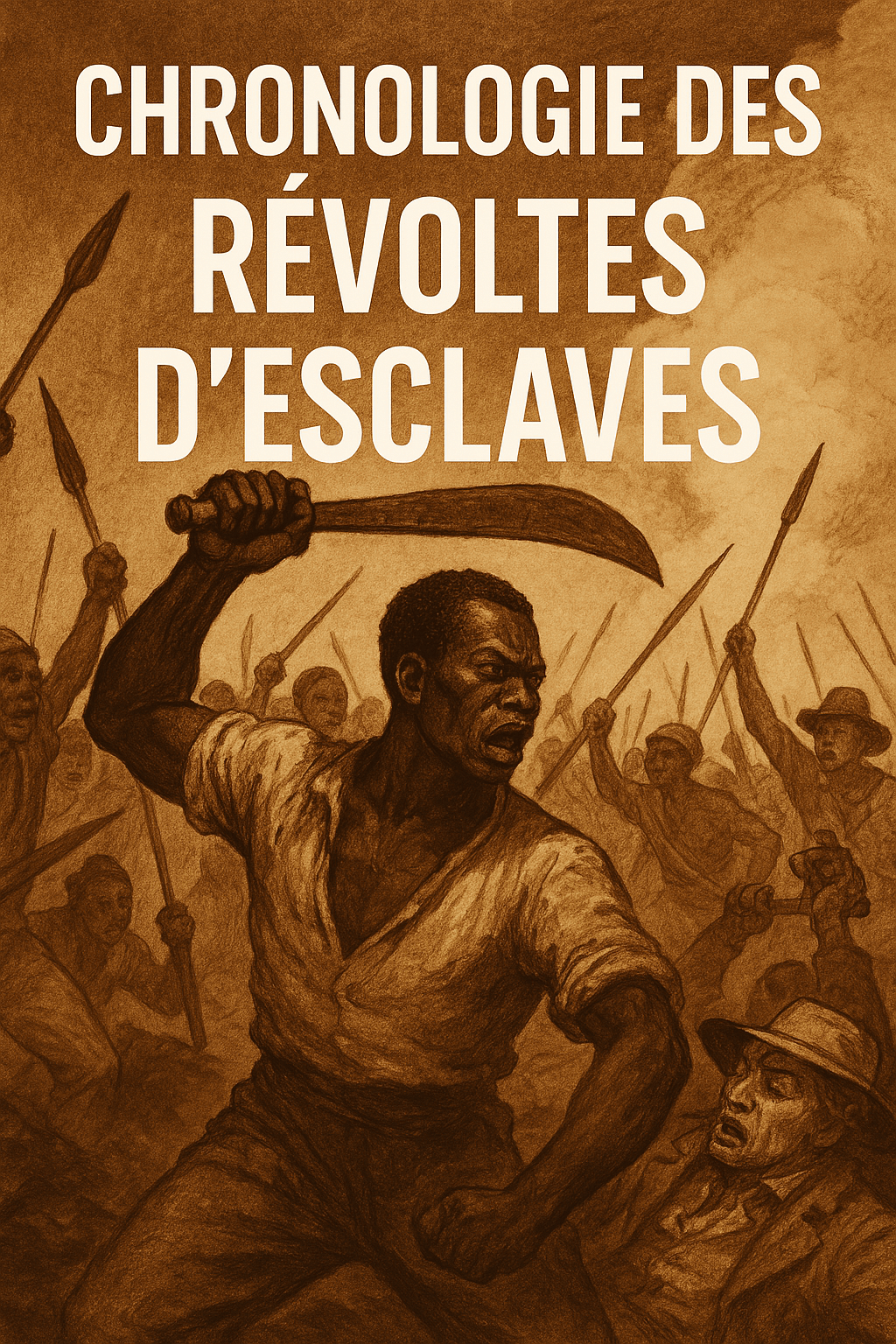Elle est chevalière, guerrière, mère d’un empire. Mais qui était vraiment Yennenga ? Entre mythe fondateur et récit d’émancipation féminine, retour sur une figure clé de l’identité Mossi et de l’histoire du Burkina Faso.
L’épopée d’une cavalière

Aux premières lueurs du jour, la plaine du Yatenga s’étire, encore moite de la nuit. Une brume ocre danse au-dessus des hautes herbes, et le vent chaud, chargé de poussière rouge, s’engouffre dans les tam-tams du silence. On n’entend que le souffle de l’aube… et celui du cheval.
Elle surgit comme un mirage. Juchée sur un étalon au pelage clair, la jeune femme fend la brume, droite, fière, déterminée. L’arc en bandoulière, les tresses nouées avec soin, elle porte une tunique qui épouse ses gestes comme une armure de coton et de grâce. Elle n’a pas l’âge des reines, mais déjà le regard de celles qui savent qu’on ne les oubliera pas.
Avant l’État, avant l’Histoire écrite, avant les livres et les généalogies officielles, il y avait une femme à cheval. Une cavalière. Une fille de roi. Une guerrière en rupture.
Elle s’appelait Yennenga.
Ce n’est pas seulement l’histoire d’une princesse rebelle. C’est celle d’un peuple qui naquit d’un refus, d’une fuite, d’un amour libre. Une nation fondée non par conquête, mais par une femme qui décida de tracer sa propre trajectoire dans un monde d’hommes et de rois.
Et si Yennenga est aujourd’hui statufiée sur les places publiques, chantée dans les contes, utilisée comme étendard national, il faut s’interroger sur ce que ce récit nous dit ; de nous, de l’Afrique, de nos héroïnes oubliées et de la fabrique des mythes.
Ce récit n’est pas une chronique figée. C’est une mémoire vivante, entre tradition orale et réécriture politique. Et derrière le halo de la légende, il y a peut-être autre chose : la vérité d’une femme, celle qu’on n’a pas notée sur les parchemins, mais qui galope encore dans les veines d’un continent.
Dagomba, le royaume d’avant les cartes
Longtemps avant que l’on nomme les frontières, bien avant que l’on grave « Haute-Volta » sur des papiers timbrés, le nord du Ghana actuel était un carrefour. Un de ces lieux-tissu, tressé par les sabots, les épées et les palabres. On l’appelait le royaume Dagomba, terre des cavaliers, des commerçants, des forgerons et des griots.
C’est là que naquit Yennenga. Pas dans un vide, mais dans un monde déjà dense, structuré, mouvant.
Au XIe siècle, les royaumes sahéliens formaient un chapelet vibrant : Ghana, Gao, Kanem, Djenné, Dagomba… Tous baignaient dans un flux d’échanges ; or, sel, coton, mais aussi savoirs et légendes. Les armées se déplaçaient vite, à cheval ou à dos de dromadaire. Et avec elles, des langues, des styles de coiffure, des dieux, des princesses.
Le Dagomba, à l’époque de Yennenga, n’était pas un petit royaume périphérique. C’était un nœud stratégique entre les royaumes haoussa à l’est, les communautés mandingues au nord-ouest, et les peuples akan au sud. Il y avait déjà des codes royaux, des systèmes d’initiation, des chefferies redoutées, et des femmes… oui, des femmes au pouvoir. Pas décoratives. Décisives.
Le père de Yennenga, le roi Nedega, dirigeait son royaume avec rigueur. C’est lui qui la forma dès l’enfance aux arts martiaux, à la monte, à la stratégie militaire. Elle fut non pas une exception, mais l’héritière d’une tradition de leadership féminin souvent invisibilisée dans les récits coloniaux. Car l’Histoire (celle que l’on nous a enseignée) a souvent déshabillé l’Afrique de ses cavalières.
Et pourtant, elles étaient là. Reines peules, guerrières soninké, matrones dogons…
Le Sahel, à cette époque, n’était pas un désert de patriarcat monolithique. Il était plus complexe, plus nuancé, plus contradictoire. Comme Yennenga.
La légende de Yennenga

Les anciens racontent qu’elle maniait l’arc comme un prolongement de sa volonté. À quatorze ans, Yennenga menait déjà des batailles aux côtés des guerriers de son père. Elle chevauchait en première ligne, traquait les pillards, défendait les frontières. Elle était plus que la fille du roi : elle était son bras armé.
Mais le même père qui la glorifiait au combat la refusait en épouse. Nedega ne voulait pas la perdre, ni à un mari, ni à un autre royaume. Alors il l’enferma dans un rôle de combattante, tout en lui refusant celui de femme libre.
C’est là que commence la fracture.
Yennenga, la redoutable, la loyale, sentit l’injustice. Elle demanda à prendre époux. Son père refusa. Elle insista. Il ferma les portes. Alors, elle s’enfuit. Déguisée en homme, à cheval, elle traversa les savanes et les forêts, bravant les frontières invisibles tracées par les royaumes d’alors.
La suite du récit est floue, comme tous les mythes. On parle d’un cheval blessé, d’un vieux chasseur, d’un refuge dans la forêt. Là, Yennenga aurait rencontré un jeune homme, Rialé, cultivateur solitaire ou prince oublié, selon les versions.
Ils s’aimèrent, loin du tumulte. De cette union naquit un fils : Ouedraogo, “le garçon étalon”, ainsi nommé en hommage au cheval blanc qui avait porté sa mère à travers l’exil.
Ouedraogo, qui deviendra le premier roi des Mossi.
Histoire ou mythe ?

On ne trouvera pas Yennenga dans les archives impériales du Mali. Aucun chroniqueur arabe du Moyen Âge ne mentionne son nom. Pas une ligne chez Ibn Battûta. Pas d’encre. Seulement des voix.
Ce que nous savons d’elle vient de la parole transmise : griots, chefs coutumiers, traditions familiales. La mémoire, ici, n’est pas une bibliothèque. Elle est une peau vivante, un tam-tam qui se répercute d’une génération à l’autre. Mais comme toutes les mémoires orales, elle fluctue, elle s’adapte, elle se réinvente.
Yennenga, c’est moins un fait historique qu’un acte de langage collectif. Une manière pour un peuple (les Mossi) de dire :
« Voici d’où nous venons. Voici ce que nous devons à une femme. »
Et cette revendication n’est pas anodine.
Car dans les récits de fondation, l’Afrique est souvent privée de mères. Les grands empires ? Fondés par des guerriers. Les villes ? Par des rois. Les peuples ? Par des conquérants. Et pourtant… ici, c’est une femme qui enfante une dynastie.
D’Ouedraogo à Ouagadougou

Yennenga n’a pas seulement donné naissance à un fils. Elle a fondé une lignée. Selon la tradition, Ouedraogo, l’enfant né de son union avec Rialé, deviendra le premier Naaba, c’est-à-dire le chef fondateur du royaume mossi. À partir de lui, une succession de rois structurera un des ensembles politiques les plus durables de l’histoire ouest-africaine : les royaumes mossi.
Ces royaumes, organisés autour de cités comme Tenkodogo, Yatenga ou encore Ouagadougou, développent rapidement une administration centralisée, une hiérarchie sociale complexe et une culture politique spécifique. Le pouvoir y est monarchique, mais structuré selon des règles coutumières précises. Le titre de Naaba ne se transmet pas seulement par le sang : il se gagne aussi par la reconnaissance de la communauté et la validation des lignages.
Le nom de l’enfant, Ouedraogo (qui signifie « étalon mâle ») n’est pas anodin. Il incarne à lui seul la fusion entre l’héritage de la cavalière Yennenga et la vigueur de la lignée à venir. Ouedraogo devient le symbole de la continuité politique, là où sa mère représentait la rupture. À travers lui, le récit bascule du mythe au pouvoir.
Aujourd’hui encore, la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou, tire son nom de cette histoire. Le palais royal des Naabas y demeure un lieu central, à la fois symbolique et politique. On ne comprend pas l’imaginaire burkinabè sans saisir la place de cette dynastie, qui a résisté aux razzias, aux tentatives de conquête mandingues, aux influences coloniales, et qui continue d’incarner une forme de stabilité identitaire.
Mais cet héritage n’est pas figé. Il est vivant, transmis, interrogé. Yennenga n’est pas qu’un nom gravé dans les discours d’État ou les manuels d’histoire : elle est l’origine d’une nation qui se pense encore à travers elle. Chaque statue d’elle, chaque place, chaque festival qui porte son nom, rappelle cette vérité : au commencement des Mossi, il y eut une femme, une cavalière, une transgression.
Yennenga dans le Burkina postcolonial
Yennenga n’est pas restée figée dans la poussière des légendes. Au Burkina Faso, son image a été patiemment sculptée, réinvestie, érigée en symbole de l’unité nationale. Elle est partout. Sur les billets, dans les noms d’avenues, dans les manuels scolaires, et surtout, dans le regard des Burkinabè qui ont grandi avec l’idée que leur histoire commence par une femme.
Au cœur de cette récupération moderne, un événement concentre toute l’ampleur symbolique de Yennenga : le FESPACO. Ce festival panafricain du cinéma, l’un des plus importants du continent, décerne chaque année son prix suprême (l’Étalon d’or de Yennenga) à l’œuvre jugée la plus représentative de l’Afrique. Ce n’est pas anodin. Le trophée est un cheval, élancé, fièrement dressé, comme celui qui porta la cavalière à travers les frontières du Dagomba. Il ne s’agit pas simplement de récompenser un film, mais de consacrer une vision du monde : une Afrique en mouvement, en création, en quête de mémoire et de sens.
L’icône de Yennenga a aussi été mobilisée dans le contexte politique post-indépendance, notamment sous Thomas Sankara. Le révolutionnaire burkinabè, fervent défenseur de la souveraineté, de l’émancipation des femmes et de la réappropriation culturelle, voyait en Yennenga une figure idéale : à la fois ancrée dans la tradition et subversive, africaine et universelle, femme et fondatrice. Sous son impulsion, l’image de la cavalière a été érigée en modèle : pour les jeunes filles, pour les soldats, pour le peuple. Elle devenait non seulement une héroïne, mais un idéal à atteindre.
Mais cette sacralisation, aussi puissante soit-elle, n’est pas sans ambiguïtés. À force d’être utilisée par les pouvoirs successifs, Yennenga est parfois figée dans un rôle de mascotte nationale, vidée de sa complexité. On l’érige, on la cite, mais on la réduit aussi. La révoltée devient statue ; la fugitive devient matrone. Elle cesse parfois d’être une femme pour devenir une image.
Et pourtant, derrière les usages politiques, derrière les rhétoriques officielles, son nom continue de vivre autrement. Dans les chants, dans les récits des anciens, dans les graffitis des rues, dans les prénoms que l’on donne aux filles. Une mémoire populaire, souple et sincère, qui rappelle qu’avant d’être une figure d’État, Yennenga fut une histoire d’amour, de choix, de désobéissance. Une histoire qui touche, parce qu’elle est à la fois lointaine et intime. Une histoire africaine ; mais aussi une histoire humaine.
Pourquoi raconter Yennenga aujourd’hui ?
Pourquoi, mille ans plus tard, parler encore de Yennenga ? Pourquoi se pencher sur une cavalière dont on ignore la date exacte de naissance, dont le nom n’apparaît dans aucun manuscrit ancien, dont la vie se confond avec la légende ?
Parce que les mythes sont des boussoles.
Parce que dans un monde qui a trop souvent nié aux peuples africains leur droit à l’Histoire, à la grandeur, à la complexité, les figures comme Yennenga rappellent que l’Afrique a ses propres origines, ses propres héroïnes, ses propres manières de dire le commencement.
Raconter Yennenga aujourd’hui, ce n’est pas chercher une vérité archéologique. C’est poser un geste politique. C’est reconnaître que l’oralité, les chants, les généalogies parlées, les contes transmis à la veillée sont aussi des archives. C’est refuser que le savoir africain soit confiné à ce que les colons ont jugé digne d’être écrit.
C’est aussi interroger ce que nous faisons, collectivement, de nos héroïnes. Les figeons-nous dans le bronze des statues ? Ou leur permettons-nous de vivre, de parler, de contester ? Yennenga, aujourd’hui, peut être plus qu’un nom sur un trophée. Elle peut être un principe actif : celui du courage de désobéir, de l’audace d’aimer hors des normes, de la puissance de créer un monde nouveau à partir d’un exil.
Dans une Afrique en quête de repères, en lutte pour sa souveraineté culturelle, où les récits féminins peinent encore à être mis en avant sans être récupérés ou esthétisés, Yennenga est un miroir.
Elle nous regarde. Elle nous interroge.
Elle nous dit que la liberté ne se transmet pas toujours par les armes, ni par les trônes, mais parfois… par une femme qui choisit de partir.
Sources
- Ki-Zerbo, Joseph, Histoire de l’Afrique noire : d’hier à demain, Hatier, 1972.
- Herskovits, Melville J., Dahomey: An Ancient West African Kingdom, Northwestern University Press, 1938.
- Maquet, Jacques, La pensée africaine, UNESCO, 1971.