Longtemps ignorées ou mal comprises, les sociétés matrilinéaires africaines sont aujourd’hui accusées, à tort, d’avoir fragilisé le continent face à la colonisation. En retraçant l’histoire des lignages maternels du Ghana à l’Égypte antique, cet article démonte les idées reçues et replace la question dans une perspective historique rigoureuse, loin des fantasmes idéologiques. Une enquête au cœur des structures familiales africaines, entre puissance symbolique, résilience culturelle et réalités géopolitiques.
Une question polémique, un impératif de clarté
Depuis plusieurs années, les débats intellectuels au sein des diasporas afrodescendantes opposent deux visions radicalement différentes de la structuration familiale africaine. D’un côté, certains courants panafricanistes, afrocentrés ou décoloniaux appellent à réhabiliter les modèles lignagers traditionnels, perçus comme plus proches de la réalité historique africaine précoloniale. De l’autre, des voix plus critiques, souvent influencées par des schémas occidentaux patriarcaux ou des lectures essentialistes du pouvoir, questionnent la pertinence ou l’efficacité des sociétés dites « matrilinéaires » dans l’histoire politique du continent.
Ce débat, aussi actuel que sensible, est souvent embrouillé par une confusion conceptuelle majeure. Il convient donc, en toute rigueur, d’opérer d’entrée une distinction claire entre deux notions trop souvent assimilées : la matrilinéarité et le matriarcat. Une société matrilinéaire ne signifie nullement que les femmes y exercent un pouvoir absolu ou majoritaire (comme le suggère à tort le mot « matriarcat »), mais uniquement que l’héritage, le nom, voire le pouvoir, se transmettent par la lignée maternelle. En Afrique, ces modèles cohabitaient souvent avec des formes de pouvoir masculin, où le roi ou le chef était désigné par sa mère ou par sa lignée maternelle, mais exerçait lui-même l’autorité.
À partir de ce constat, une question fondamentale se pose : les structures matrilinéaires de certaines sociétés africaines ont-elles contribué, d’une manière ou d’une autre, aux processus de déstabilisation ou de chute de ces entités face aux puissances extérieures (arabes, ottomanes, européennes) ? Autrement dit, peut-on faire le lien entre un modèle de transmission du pouvoir et une incapacité structurelle à résister aux agressions coloniales ou impériales ? À l’inverse, les sociétés africaines organisées sur un modèle patrilinéaire auraient-elles été plus résilientes, plus centralisées, mieux préparées aux conflits géopolitiques ?
Ces interrogations sont légitimes. Mais pour y répondre sérieusement, il faut s’extraire des constructions idéologiques contemporaines, souvent biaisées, pour revenir aux faits historiques vérifiés, aux logiques internes des sociétés africaines et à la géographie réelle du pouvoir précolonial. Il ne s’agit pas ici de défendre ou de condamner la matrilinéarité, mais d’en évaluer objectivement la place, les effets, et les limites, dans des contextes politiques précis, sur la longue durée.
C’est à ce prix que l’on pourra dépasser les jugements simplistes (qu’ils soient afro-centrés ou occidentalo-centrés) pour analyser, sans fétichisme ni dénigrement, les trajectoires de civilisation africaines. Une telle entreprise requiert un ancrage rigoureux dans l’anthropologie historique, la géopolitique et la science politique comparée. En somme, une méthode que nous appliquerons ici à la lettre.
Cartographie historique des sociétés matrilinéaires en Afrique
La diversité civilisationnelle de l’Afrique interdit toute lecture unifiée de ses structures sociales. À l’échelle continentale, les sociétés lignagères se répartissent en deux grands modèles : les systèmes patrilinéaires, dominants numériquement, et les structures matrilinéaires, plus restreintes mais d’une grande cohérence interne. Loin d’être anecdotiques, ces dernières s’inscrivent dans des configurations politiques stables et durables, souvent antérieures à la pénétration européenne. Pour comprendre leur rôle dans l’histoire, il convient d’abord d’en dresser la cartographie.
Les sociétés matrilinéaires ne sont ni marginales ni résiduelles dans l’histoire africaine. Elles se concentrent principalement dans trois grands foyers civilisationnels :
- Afrique centrale
- Les Luba (actuelle RDC) organisent leur royauté autour d’un système strictement matrilinéaire, où le pouvoir du roi dérive de sa lignée maternelle. Le Balopwe (roi) est choisi non pas en fonction de son père, mais par son lien avec la reine-mère.
- Les Bemba, peuple bantou de Zambie, suivent un modèle analogue : le chef suprême, ou Chitimukulu, est désigné parmi les neveux de la lignée maternelle du roi précédent, excluant ainsi la filiation directe.
- Les Baluba du Katanga, voisins des Luba, maintiennent une structure semblable, avec des oncles maternels exerçant une autorité politique et rituelle prépondérante.
- Les Mongo, en RDC équatoriale, constituent un autre exemple, bien que leur matrilinéarité ne débouche pas systématiquement sur un pouvoir féminin explicite.
- Afrique de l’Ouest
- Le cas des Akan est emblématique. Ce groupe ethnolinguistique (Ashanti, Baoulé, Agni, Fanti, etc.), présent au Ghana, en Côte d’Ivoire et au Togo, suit une matrilinéarité stricte pour la transmission du pouvoir royal et des biens. Chez les Ashanti, par exemple, l’Asantehene est issu du clan de la reine-mère (Asantehemaa), détentrice du droit de nomination.
- Les Baoulé (Côte d’Ivoire), issus d’une migration Ashanti au XVIIIe siècle, ont maintenu ce système matrilinéaire, avec des chefs issus de lignées féminines, même si l’exercice du pouvoir reste majoritairement masculin.
- Afrique orientale
- Plusieurs groupes bantous dispersés (notamment en Tanzanie et au Malawi) présentent des traits matrilinéaires, en particulier en matière d’héritage foncier et de filiation. Toutefois, le pouvoir politique y reste fréquemment patrilocal (résidence chez le mari).
- Chez les Makhuwa (Mozambique), l’héritage du pouvoir coutumier et des terres suit également la lignée maternelle.
- Cas particulier : l’Égypte ancienne
- Bien que la société pharaonique soit globalement patrilinéaire, des traces importantes d’un usage matrilinéaire partiel subsistent, notamment dans la désignation des rois. La reine (épouse royale ou sœur) servait parfois de légitimatrice dynastique, et plusieurs pharaons tirèrent leur légitimité de leur mère, comme en témoigne le rôle de la « Grande épouse royale » et les titulatures incluant le nom de la mère du roi (cf. Hatshepsout, Thoutmosis III).
Le système matrilinéaire ne saurait être réduit à une simple curiosité généalogique. Il engage des logiques politiques précises et contraignantes :
- Transmission du pouvoir par la lignée maternelle
- Le fils du roi n’est jamais héritier automatique. C’est le fils de la sœur du roi qui concentre les droits dynastiques, garantissant que le sang royal passe toujours par la même matrice clanique féminine.
- Cette logique évite la patrimonialisation du pouvoir et permet une forme de rotation dynastique régulée, empêchant les dérives absolutistes liées à la transmission directe de père en fils.
- Statut politique des femmes
- Si les femmes ne règnent pas directement dans la majorité des cas, elles détiennent le pouvoir de désignation, via leur statut de reine-mère, de sœur royale, ou de matriarche du lignage.
- Le rôle des reines-mères est crucial : elles arbitrent les querelles de succession, veillent à la continuité rituelle du pouvoir, et conservent une autorité morale sur l’ensemble de la communauté royale.
- Prééminence des oncles maternels
- Dans les sociétés matrilinéaires, le frère de la mère est souvent plus important que le père biologique. C’est lui qui initie l’enfant aux rituels, le prépare à la succession, et lui transmet les secrets symboliques du clan.
- Cette configuration génère un système éducatif spécifique, où la famille élargie joue un rôle prépondérant, au détriment de la cellule nucléaire (père-mère-enfant) plus typique des modèles occidentaux.
En somme, la matrilinéarité africaine n’implique pas une domination féminine directe, mais une logique de pouvoir fondée sur la transmission par la femme, qui permet à des lignées masculines d’exercer l’autorité tout en demeurant sous le contrôle symbolique du matriarcat clanique.
La matrilinéarité comme force structurante des royaumes africains
Loin d’avoir constitué une fragilité politique, les structures matrilinéaires ont, dans de nombreuses sociétés africaines, permis la consolidation dynastique, la stabilité politique et la cohésion sociale. En articulant pouvoir, lignage et économie autour des femmes sans nécessairement leur conférer le pouvoir exécutif, ces sociétés ont mis en place un équilibre institutionnel original, ancré dans la longue durée. L’examen des exemples historiques les plus documentés permet d’en saisir la robustesse fonctionnelle.
Le cas de l’Empire Ashanti illustre avec éclat la rationalité politique de la matrilinéarité. Dans cette confédération militaro-sacrée d’Afrique de l’Ouest, fondée au XVIIe siècle par Osei Tutu, le pouvoir royal repose sur une double autorité : celle de l’Asantehene (roi) et celle de l’Asantehemaa (reine-mère). Cette dernière ne se contente pas d’un rôle symbolique : elle co-détient la souveraineté et participe activement à la désignation du souverain.
La succession royale ne s’effectue jamais de père en fils. Le roi est toujours choisi dans le lignage utérin de la reine-mère, c’est-à-dire parmi les fils de ses sœurs. Cette règle, loin d’être décorative, garantit une continuité dynastique indépendante des ambitions personnelles du monarque en place, et empêche la transmission du pouvoir à un enfant issu d’une union extérieure au clan royal.
La matrilinéarité permet ainsi une maîtrise des alliances matrimoniales : en contrôlant les épouses des princes et les descendances féminines, les reines-mères encadrent l’extension du pouvoir et évite la dilution du sang royal dans des alliances incontrôlées. Cette maîtrise du lignage permet une stabilité sur plusieurs générations, observable dans la longévité institutionnelle de l’Empire Ashanti jusqu’à sa confrontation avec les Britanniques à la fin du XIXe siècle.
Une autre conséquence directe de la matrilinéarité est la réduction des conflits de succession, pathologie fréquente des systèmes patrilinéaires où le roi cherche à imposer son propre fils, au détriment d’autres prétendants issus du lignage.
Dans les royaumes matrilinéaires, le fils d’un roi n’est jamais éligible à sa succession. L’héritier potentiel appartient à la lignée de la sœur du roi défunt. Cette règle, impersonnelle et perçue comme sacrée, neutralise les conflits intra-familiaux liés à l’ambition dynastique. Le fils du roi est par définition écarté du trône : cela élimine une rivalité potentielle, et renforce l’autorité des conseils lignagers dans le choix du successeur.
Dans les sociétés segmentaires (sans État centralisé), la matrilinéarité offre un pôle de cohésion : les femmes, et en particulier les matriarches, jouent un rôle pacificateur, tant dans la résolution des litiges que dans la diplomatie inter-clanique. Leur position d’arbitre, fondée sur leur autorité lignagère et leur absence d’intérêt militaire direct, en fait des actrices de la stabilité locale, souvent sollicitées dans les rites de réconciliation ou les pactes de paix.
Dans les sociétés matrilinéaires africaines, l’économie de subsistance et d’échange repose largement sur les lignées féminines. Les femmes détiennent souvent l’usage et la gestion des terres agricoles, même si la propriété rituelle reste masculine. Ce mode d’organisation garantit la transmission de la terre par le clan maternel, ce qui assure la continuité de l’exploitation sans morcellement anarchique.
Les marchés, quant à eux, sont dans de nombreuses cultures africaines entièrement dirigés par les femmes. C’est notamment le cas chez les Akan, mais aussi chez les Yorubas et les Igbo (sociétés non matrilinéaires, mais où l’économie féminine est dominante). Ces marchés ne sont pas de simples lieux d’échange : ce sont des espaces de régulation sociale et politique, où se décident parfois les grandes orientations commerciales, et où les femmes peuvent exercer des pressions sur le pouvoir masculin en cas d’injustice économique.
Par ailleurs, la transmission du savoir artisanal, médicinal et religieux s’effectue souvent par les femmes, dans un cadre lignager matrilinéaire. Elles forment les générations suivantes, assurent la préservation des recettes, des rites et des symboles propres au groupe, garantissant la pérennité culturelle au-delà des bouleversements politiques.
En somme, la matrilinéarité n’est pas une survivance archaïque ni un accident institutionnel. Elle constitue une logique civilisationnelle cohérente, qui articule pouvoir, identité et économie dans des formes adaptées aux structures africaines. Elle a permis à des entités politiques aussi puissantes que les Ashanti, les Bemba ou les Luba de maintenir un ordre dynastique et une stabilité interne, en neutralisant les rivalités lignagères et en associant étroitement les femmes à la régulation de la société. Loin d’avoir précipité un quelconque déclin, la matrilinéarité fut, dans ces cas, l’une des clefs de la résistance africaine pré-coloniale.
Une faille géopolitique exploitée par les puissances étrangères ?
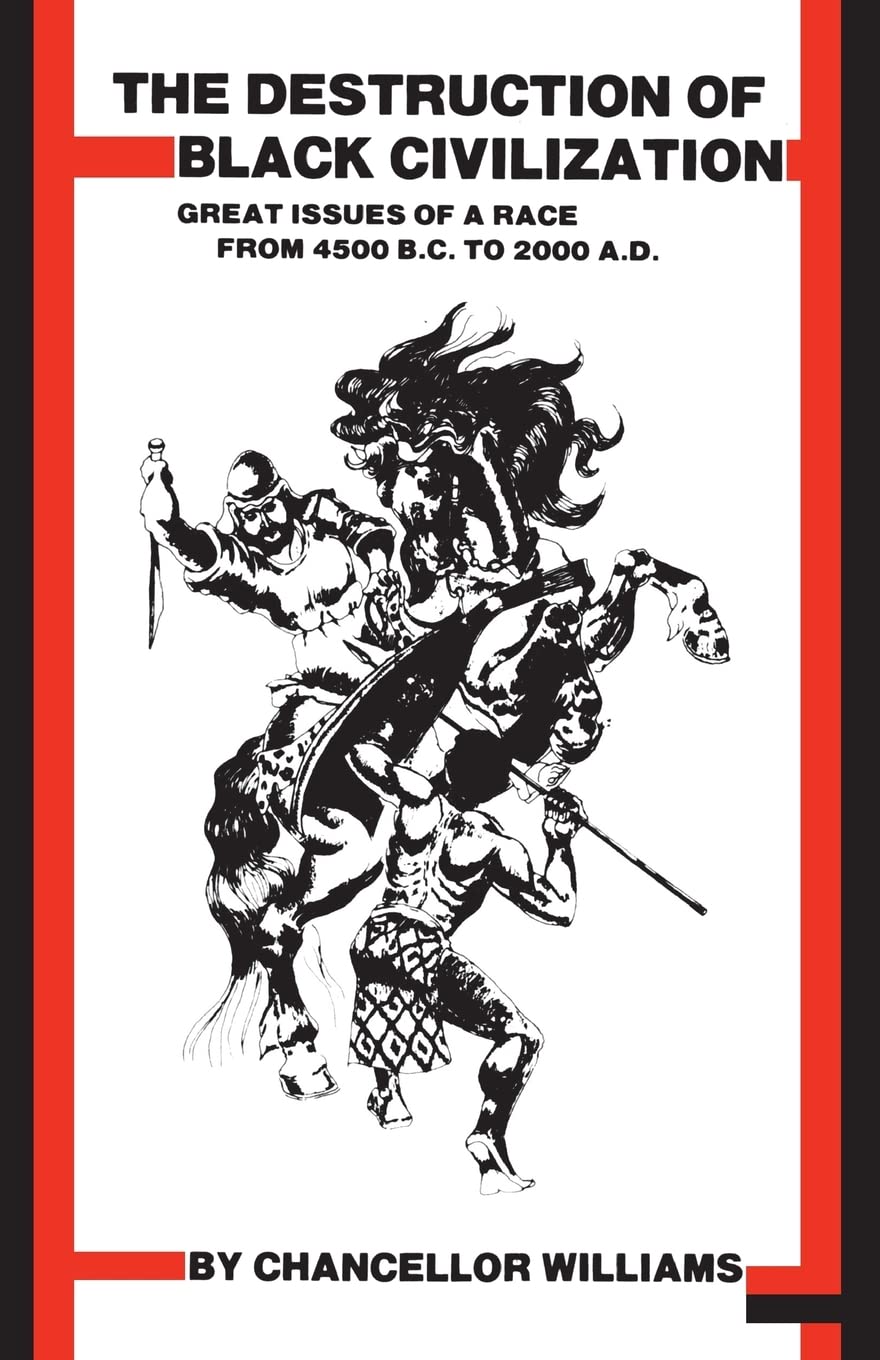
La thèse selon laquelle les structures matrilinéaires auraient favorisé l’infiltration politique d’éléments étrangers dans les sociétés africaines anciennes, notamment en Égypte, a été avancée avec vigueur par certains auteurs afrocentristes. Le plus emblématique d’entre eux reste Chancellor Williams, dont l’ouvrage majeur The Destruction of Black Civilization (1971) a influencé toute une génération de penseurs panafricanistes. Néanmoins, cette hypothèse, aussi stimulante soit-elle, appelle à une lecture critique, fondée sur les sources primaires et sur la réalité archéologique, loin des schémas idéologiques.
Dans The Destruction of Black Civilization, Chancellor Williams avance l’idée que les systèmes matrilinéaires de succession auraient, à terme, ouvert les portes du pouvoir à des étrangers. En particulier en Égypte, où, selon lui, des élites non africaines (venues d’Asie, de la Méditerranée ou plus tard de Grèce) auraient acquis une légitimité politique en épousant des femmes issues de lignées royales africaines.
Selon Williams, cette stratégie matrimoniale aurait permis à des groupes exogènes, initialement sans pouvoir, d’infiltrer les structures de commandement, puis d’en modifier les fondements culturels et religieux. La succession par la mère (lorsqu’elle était pratiquée) aurait ainsi été exploitée comme un cheval de Troie dynastique, les enfants nés de ces unions étant désormais considérés comme membres à part entière du lignage royal africain, et donc éligibles à la souveraineté.
L’auteur voit dans cette dynamique le point de bascule d’un effondrement civilisationnel progressif : remplacement des élites noires par des dynasties métissées ou étrangères, abandon progressif des cultes traditionnels au profit de cosmogonies exogènes, glissement d’un pouvoir partagé vers une concentration patriarcale, conforme aux modèles d’Asie Mineure ou du monde hellénistique.
Cette thèse culmine dans l’idée que l’Égypte ancienne aurait été défigurée de l’intérieur : non par la défaite militaire seule, mais par un processus d’acculturation douce, opéré au cœur même du foyer dynastique par le biais du lit conjugal. Williams conclut que cette « hospitalité généalogique » aurait miné la résistance de l’Afrique pharaonique aux envahisseurs extérieurs.
Aussi séduisante soit-elle d’un point de vue narratif, cette hypothèse repose sur des bases historiographiquement fragiles, et mérite d’être interrogée avec la rigueur que commande l’analyse des sociétés anciennes.
D’abord, il convient de rappeler que la matrilinéarité n’équivaut pas à un pouvoir matriarcal, ni à un automatisme de transmission politique. La désignation des souverains dans l’Égypte ancienne relevait d’une logique plus complexe, souvent sacralisée par le clergé (notamment celui d’Amon à Thèbes), et arbitrée par des coalitions d’élites, bien plus que par une simple ligne maternelle. Les cas de transmission du trône par l’intermédiaire d’épouses royales existent, mais restent exceptionnels, et ne permettent pas de conclure à une structure uniformément matrilinéaire.
Ensuite, les mariages entre pharaons et femmes d’origine étrangère sont avérés dans certains contextes, notamment à l’époque ptolémaïque ou pendant les XXIIe et XXVe dynasties, mais jamais sans forte négociation rituelle, militaire ou diplomatique. Ces alliances relevaient davantage de logiques stratégiques ponctuelles que d’un phénomène systémique de remplacement culturel. Par ailleurs, les épouses étrangères ne bénéficiaient pas systématiquement d’un statut de reine-mère légitimante : le rang dans la hiérarchie des femmes du harem royal comptait davantage que l’origine ethnique.
Plus fondamentalement, la chute des grandes civilisations africaines ne peut se réduire à un facteur dynastique unique. Dans le cas égyptien, la combinaison de facteurs militaires (invasions assyriennes, perses, puis gréco-romaines), climatiques (aridification du delta), économiques (affaiblissement des circuits nilotiques), et religieux (crise du système des temples) ont joué un rôle déterminant. Réduire cet effondrement à un prétendu relâchement lignager revient à négliger la complexité des dynamiques impériales.
Enfin, la thèse de Chancellor Williams suppose une homogénéité culturelle des structures africaines, alors que la diversité des systèmes lignagers (matrilinéaires, patrilinéaires, bilinéaires) en Afrique contredit toute généralisation. Des empires centralisés comme le Mali ou le Kanem-Bornou, totalement patrilinéaires, ont eux aussi connu des formes d’infiltration ou de déstabilisation par des alliances extérieures. Cela démontre que le vecteur d’effondrement n’est pas tant la nature du lignage que l’ampleur de la pression extérieure combinée aux fragilités internes.
En conclusion, la matrilinéarité n’apparaît pas comme une faille géopolitique en soi, mais comme une modalité de transmission du pouvoir parmi d’autres, parfaitement fonctionnelle dans son contexte africain originel. Les exemples égyptiens doivent être lus avec prudence, car les glissements dynastiques n’y sont jamais attribuables à un seul facteur, encore moins à une supposée naïveté lignagère. L’histoire africaine invite ici à la nuance, à l’interrogation des sources, et au refus des lectures mono-causales.
La matrilinéarité n’a pas empêché la résistance (preuves historiques)
À rebours des thèses critiques qui imputeraient à la matrilinéarité une faiblesse structurelle ayant contribué à l’effondrement des civilisations africaines, l’examen des faits historiques met au contraire en évidence que les sociétés organisées autour de la filiation maternelle ont souvent été parmi les plus résilientes. À la croisée de la politique, de la guerre et de la transmission culturelle, la matrilinéarité a non seulement structuré les identités collectives, mais elle a aussi servi de socle à la résistance armée et mémorielle face aux puissances étrangères.
Le cas le plus emblématique reste celui de Yaa Asantewaa, reine-mère des Ashanti (Asantehemaa), qui mena, à plus de 60 ans, la guerre de 1900 contre les Britanniques. Dans un contexte d’expansion coloniale brutale, où l’administration britannique cherchait à s’emparer du trône d’or royal (Sika Dwa Kofi), symbole sacré de la souveraineté ashanti, c’est Yaa Asantewaa qui convoqua les chefs et mobilisa les forces armées du royaume.
Son autorité ne relevait pas d’un charisme isolé, mais d’un statut politique ancré dans la structure matrilinéaire du pouvoir asante : la désignation du roi (Asantehene) dépendait de l’approbation de la reine-mère, détentrice de la lignée royale maternelle. C’est en tant que gardienne de cette légitimité que Yaa Asantewaa prit les armes, démontrant que la matrilinéarité pouvait être le socle d’une autorité militaire et politique effective, même en contexte de conflit frontal.
Le royaume du Dahomey fournit un autre exemple probant. Si sa structure politique était mixte (patrilinéarité dynastique, mais grande influence des femmes au palais), les reines-mères (Kpojito) y exerçaient un pouvoir parallèle, à la fois mystique et politique. Elles étaient à la tête des sociétés initiatiques féminines, jouaient un rôle central dans la nomination des rois et dans la diplomatie, et pouvaient arbitrer les grandes orientations du royaume. À cela s’ajoutaient les fameuses « Amazones du Dahomey », corps militaire féminin d’élite, dont l’existence même contredit le stéréotype d’une matrilinéarité incompatible avec la guerre ou le pouvoir.
Ces cas prouvent que la présence de structures matrilinéaires ou de co-pouvoirs féminins ne fut pas un frein à l’initiative stratégique, mais bien un levier de résistance.
Si la matrilinéarité ne fut pas toujours visible dans les appareils d’État, elle joua un rôle capital dans la survie des cultures africaines transplantées dans les Amériques, notamment dans le contexte esclavagiste, où les hommes étaient souvent séparés de leur progéniture, voire éliminés.
En contexte créole (Haïti, Brésil, Antilles), les femmes noires furent les premières vectrices de la continuité identitaire. Porteuses des langues, des chants, des rites, des croyances et des savoirs médicinaux, elles assurèrent la transmission culturelle au sein de familles déstructurées par la plantation. Dans des sociétés esclavagistes où le nom du père était effacé ou rendu inaccessible, la filiation maternelle devenait le seul socle stable d’identification. Cette réalité donna naissance à des modèles familiaux matrifocaux (dominés par la mère) et parfois matrilinéaires de fait.
À Haïti, le rôle des mères dans la transmission du vodou et dans l’encadrement des communautés marronnes est bien documenté. Au Brésil, dans les quilombos comme celui de Palmares, des cheffes de clan ont été identifiées comme les garantes des rituels de fertilité et de cohésion communautaire. Dans les îles anglophones, le « mother clan » se maintient jusque dans les pratiques linguistiques créoles, où l’identité d’un individu est souvent exprimée en lien avec sa mère plutôt que son père.
Cette résistance silencieuse de la matrilinéarité dans les contextes les plus brutaux de l’histoire noire témoigne de sa force d’ancrage. Loin d’avoir facilité la domination, elle a protégé la mémoire, favorisé la reconstruction sociale et permis la continuité symbolique des diasporas africaines.
Ainsi, loin de constituer une tare structurelle, la matrilinéarité apparaît, dans de nombreux cas, comme une force d’organisation, de cohésion et de résistance. Que ce soit dans les royaumes africains précités ou dans les sociétés noires de la diaspora, elle fut l’un des ressorts invisibles de la survie et de la dignité face à l’effondrement, à l’invasion et à la déshumanisation. La preuve historique, lorsqu’elle est libérée de toute idéologie contemporaine, invalide donc la thèse d’une responsabilité directe ou indirecte de la matrilinéarité dans la chute des sociétés africaines.
Les sociétés patriarcales africaines n’ont pas évité la colonisation
Si certains contempteurs modernes des sociétés matrilinéaires africaines avancent qu’elles auraient facilité l’infiltration ou la décadence politique, encore faudrait-il démontrer que les sociétés africaines à structure patriarcale auraient mieux résisté à la domination étrangère. Or, l’analyse historique infirme cette hypothèse simpliste : les grands royaumes ou empires patrilinéaires du continent ont, eux aussi, succombé aux effets conjugués des traites, des guerres d’usure et de la pénétration coloniale. La structuration lignagère ne saurait, à elle seule, expliquer ni la résistance, ni l’effondrement.
Les empires du Sahel central et occidental (tels que le Ghana médiéval, le Mali, le Songhaï, ou plus tard les États musulmans du Soudan, du Kanem-Bornou et du Fouta Djalon) se caractérisent tous par une organisation politique strictement patriarcale, à l’image du droit musulman importé par les élites islamisées.
Dans ces sociétés, la transmission du pouvoir repose exclusivement sur la lignée paternelle, selon une logique patrilinéaire et parfois même agnatique stricte (préférence pour la succession entre frères avant les fils, dans certains cas). L’exercice du pouvoir y est foncièrement masculinisé, les femmes étant écartées de la sphère publique et politique, en conformité avec l’ordre islamique. La fonction royale (mansa, mai, almami) est considérée comme l’apanage des hommes issus de lignées précises, validées par une ascendance patriarcale vérifiée.
Or, malgré l’impressionnante organisation militaire, fiscale et religieuse de ces États, aucun n’échappa aux dynamiques de déclin, qu’elles soient internes (luttes de succession, divisions ethniques, révoltes religieuses) ou externes (pression commerciale européenne sur les côtes, infiltration par les confréries ou les trafiquants d’esclaves). L’empire du Songhaï, pourtant à son apogée sous Askia Mohammed (1493-1528), est anéanti en 1591 par une armée marocaine, bien que le Maroc n’ait ni supériorité technologique durable, ni ancrage territorial dans la région. Ce choc révèle surtout la fragilité logistique et la surcentralisation militaire, non un problème de filiation.
Au XIXe siècle, les royaumes musulmans du Sahel islamisé ne purent contenir l’expansion coloniale française, malgré leur organisation patriarcale rigide. Le sultanat de Sokoto, fondé par Ousmane dan Fodio en 1804, sombra dans l’orbite britannique à la fin du siècle. Le Fouta Toro, islamisé et patrilinéaire, fut annexé par Faidherbe dès les années 1860.
Le royaume du Kongo, établi au XIVe siècle et formellement chrétien à partir du XVIe siècle, présente un cas significatif d’organisation patrilinéaire complexe, mais incapable de résister aux dynamiques de fragmentation et d’acculturation.
Le système de succession kongolais, bien que flexible dans ses premières phases, fut progressivement réduit à une transmission agnatique entre parents masculins. Avec l’influence portugaise croissante à partir de 1483 (arrivée de Diogo Cão), ce royaume adopte des modèles européens de royauté chrétienne, renforçant la logique patriarcale et dynastique. L’élite convertie cherche à mimer les structures monarchiques ibériques, jusqu’à s’enfermer dans un modèle autoritaire sur fond de clientélisme colonial.
La conséquence en fut une fragilité accrue du pouvoir central : les querelles dynastiques, souvent attisées par les Portugais eux-mêmes, menèrent à des guerres de succession récurrentes. En 1665, le roi António I est vaincu et décapité par les troupes portugaises lors de la bataille d’Ambuila, scellant l’affaiblissement définitif du royaume. Par la suite, le Kongo sombra dans une anarchie politique prolongée, chaque prétendant s’alliant tantôt à Lisbonne, tantôt à Luanda, tantôt à des factions esclavagistes africaines.
La structure patriarcale n’empêcha ni les mariages diplomatiques orientés, ni les compromissions esclavagistes, ni l’émergence de souverains fantômes, vassaux des intérêts portugais. L’État kongolais devint ainsi l’un des plus grands pourvoyeurs d’esclaves de la façade atlantique entre le XVIe et le XVIIIe siècle, non par faiblesse matrilinéaire, mais par instrumentalisation de sa centralité patriarcale à des fins commerciales étrangères.
Ces exemples révèlent avec clarté que les sociétés africaines patriarcales ne furent pas plus immunisées que les autres face à l’effondrement géopolitique ou à l’ingérence étrangère. Si leur organisation différait des sociétés matrilinéaires, elles ne bénéficièrent pas d’un avantage comparatif durable face aux défis du temps. En vérité, ce ne sont pas les systèmes de filiation qui expliquent la résistance ou la chute des civilisations africaines, mais un faisceau de facteurs stratégiques, économiques, écologiques et militaires.
L’effondrement africain : une lecture multi-factorielle
À ceux qui cherchent une cause unique, voire idéologique, à l’effondrement des grandes civilisations africaines, l’histoire impose une réponse nuancée. Ni la structure matrilinéaire, ni la structure patrilinéaire n’ont été les causes premières de la désagrégation politique du continent. La vérité historique se situe dans l’analyse systémique des dynamiques endogènes et exogènes qui, conjuguées, ont sapé les fondements des sociétés africaines. Une lecture rigoureuse impose donc d’élargir le cadre d’analyse.
Au fil des siècles, de nombreux royaumes africains, quelle que soit leur structuration lignagère, furent confrontés à des conflits internes récurrents. Ces conflits, souvent issus de rivalités dynastiques ou de contestation du pouvoir central par les périphéries, ont généré une fragmentation politique chronique.
L’exemple de l’empire du Mali, qui se morcela dès la fin du XIVe siècle en provinces autonomes sous l’effet des ambitions locales, est éloquent. De même, le royaume Lunda, bien que matrilinéaire, sombra dans une crise de succession dès le XVIIIe siècle, non en raison de son système de filiation, mais du fait de l’impossibilité de contenir les logiques de clan et les ambitions régionales.
Dans le monde mandingue ou dans l’Afrique des Grands Lacs, les guerres endogènes entre groupes lignagers rivaux ont fragilisé les structures politiques, miné les dynamiques commerciales internes, et favorisé les interventions étrangèressous prétexte de médiation ou d’alliance.
L’échec des mécanismes de succession (qu’ils soient matrilinéaires ou patrilinéaires) réside donc moins dans leur nature que dans l’absence d’un cadre fédérateur capable de canaliser les ambitions. Ce n’est pas la matrice, mais sa gestion politique qui détermine la stabilité.
À partir du XVe siècle, l’Afrique devient progressivement un théâtre d’interventions extérieures, qui déséquilibrent profondément ses structures internes. Trois axes de prédation s’imposent :
- La traite transsaharienne, orchestrée par les élites musulmanes du Nord, qui dépeuple les régions subsahariennes depuis le IXe siècle.
- La traite orientale, centrée sur les ports swahilis et le golfe d’Aden, qui alimente les marchés d’Arabie, d’Iran et de l’Inde.
- La traite atlantique, enfin, qui devient massive dès le XVIIe siècle, avec l’implication directe des puissances européennes (Portugal, Espagne, France, Angleterre, Pays-Bas).
Ces traites n’auraient pu prospérer sans l’implication active de pouvoirs africains (patriarcaux comme matrilinéaires) qui monnayèrent des captifs contre des armes, des tissus ou de l’alcool. Cette complicité stratégique, motivée par des intérêts à court terme, a favorisé une érosion du capital humain et des savoirs endogènes, tout en accroissant la dépendance économique à l’égard de circuits extérieurs.
Au XIXe siècle, ce déséquilibre est aggravé par l’intervention armée directe des puissances européennes, dotées de supériorité technique (fusils à répétition, canons, vapeurs fluviaux), logistique (réseaux coloniaux) et scientifique (cartographie, médecine tropicale). Les royaumes africains, souvent divisés et rivaux, ne purent faire front.
Le choc colonial fut total. Ni les chefferies patrilinéaires du Sahel, ni les royautés matrilinéaires du Ghana ou du Congo ne purent opposer une résistance durable. L’effondrement fut continental et systémique.
Dans cette perspective, il convient de replacer à sa juste place le débat sur les systèmes de filiation. Le matrilinéariat, tout comme le patriarcat, n’a jamais constitué un rempart absolu ni une faille insurmontable. Ces structures étaient des instruments d’organisation sociale, non des moteurs d’expansion ou de décadence.
La résilience des sociétés africaines ne dépendait pas de la ligne maternelle ou paternelle, mais de leur capacité à forger des alliances stratégiques, à assurer la continuité des institutions malgré les successions, et à préserver l’unité territoriale face aux menaces. Or, ces trois piliers ont été ébranlés par l’individualisme lignager, les guerres locales et l’absence de vision pan-africaine concertée.
En somme, la structure lignagère n’est ni coupable ni salvatrice. Elle ne fut qu’un cadre parmi d’autres, que les hommes (rois, chefs, guerriers, commerçants, traîtres parfois) ont su mobiliser ou trahir. L’histoire ne juge pas les modèles culturels sur des principes abstraits, mais sur leur efficacité historique. Et dans cette histoire, c’est la division, plus que la filiation, qui a ouvert la voie aux prédateurs.
Une fausse question, un vrai révélateur
À l’issue de cette analyse, une certitude s’impose : accuser les sociétés matrilinéaires d’avoir provoqué la chute de l’Afrique relève d’un anachronisme intellectuel et d’une lecture profondément erronée des dynamiques historiques. Il ne s’agit là que d’un faux procès, souvent instruit depuis des positions idéologiques ; qu’elles soient patriarcales d’inspiration occidentale, ou afro-centrées mais historiquement infondées.
Les sociétés matrilinéaires africaines n’ont pas été les moteurs de l’effondrement : elles en furent les témoins, parfois les gardiennes, parfois les victimes. À Ashanti, au Dahomey, chez les Baluba, elles ont permis la cohésion lignagère, la continuité symbolique, et l’intégration des femmes dans l’ordre politique, dans des proportions inconnues de la plupart des civilisations européennes contemporaines.
Ce que l’histoire coloniale et postcoloniale a altéré, ce n’est pas seulement la souveraineté territoriale des royaumes africains, mais aussi la lecture que nous avons de leurs fondements sociaux. Le matrilinéariat, mal compris, a souvent été assimilé à une faiblesse, à tort. En réalité, cette structure exprime une autre manière de concevoir la parenté, le pouvoir et la transmission. Elle ne saurait être évaluée avec les grilles d’analyse d’un monde qui lui est historiquement étranger.
Il convient donc de dépasser le débat stérile entre patriarcat et matriarcat, pour aborder ce que l’Afrique précoloniale nous enseigne réellement : la plasticité des formes politiques, la diversité des régimes d’autorité, et la capacité d’innover au sein de structures lignagères spécifiques, sans pour autant fonder l’ensemble d’un pouvoir sur un seul sexe ou une seule lignée.
En définitive, la chute de l’Afrique ne saurait être imputée à un facteur isolé, et certainement pas à un mode de filiation. L’agrégation de causes endogènes (conflits internes, rivalités dynastiques, fragmentations politiques) et exogènes (traites, colonisation, domination économique) est seule à même de rendre compte du recul civilisationnel qui s’est produit au XIXe siècle.
Ce qu’il faut aujourd’hui, ce n’est pas réécrire le passé à la lumière de nos débats contemporains, mais replacer les faits dans leur contexte, avec rigueur, méthode et souci de vérité. La question des sociétés matrilinéaires, au lieu de servir de bouc émissaire, devrait être étudiée pour ce qu’elle révèle des logiques africaines traditionnelles, de leurs subtilités comme de leurs limites.
À l’idéologie, opposons la connaissance. À l’opinion, substituons l’analyse. L’Afrique ne tombera pas une seconde fois si elle commence par comprendre ce qu’elle fut réellement ; et non ce qu’on voudrait qu’elle ait été.
Bibliographie
- Arhin, Kwame. The Political and Military Roles of Akan Women. Legon: Institute of African Studies, University of Ghana, 1991.
- Allman, Jean Marie. The Quills of the Porcupine: Asante Nationalism in an Emergent Ghana. Madison: University of Wisconsin Press, 1993.
- McCaskie, T. C. State and Society in Pre-colonial Asante. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
- Williams, Chancellor. The Destruction of Black Civilization: Great Issues of a Race from 4500 B.C. to 2000 A.D.Chicago: Third World Press, 1971.
- Oxford Research Encyclopedias – African History. “Asante Queen Mothers and Power.” 2019.
- Study.com. « Ashanti Tribe: History, People & Culture.«
- Dangerous Women Project. “Yaa Asantewaa.” University of Edinburgh, 2016.
Sommaire

