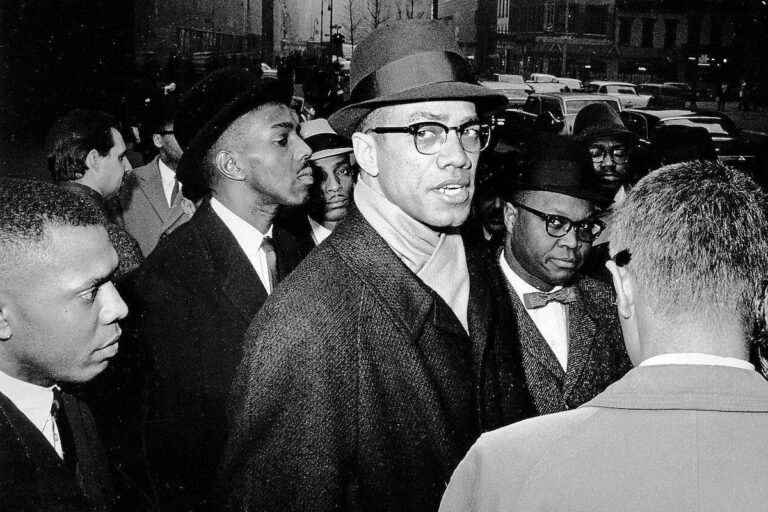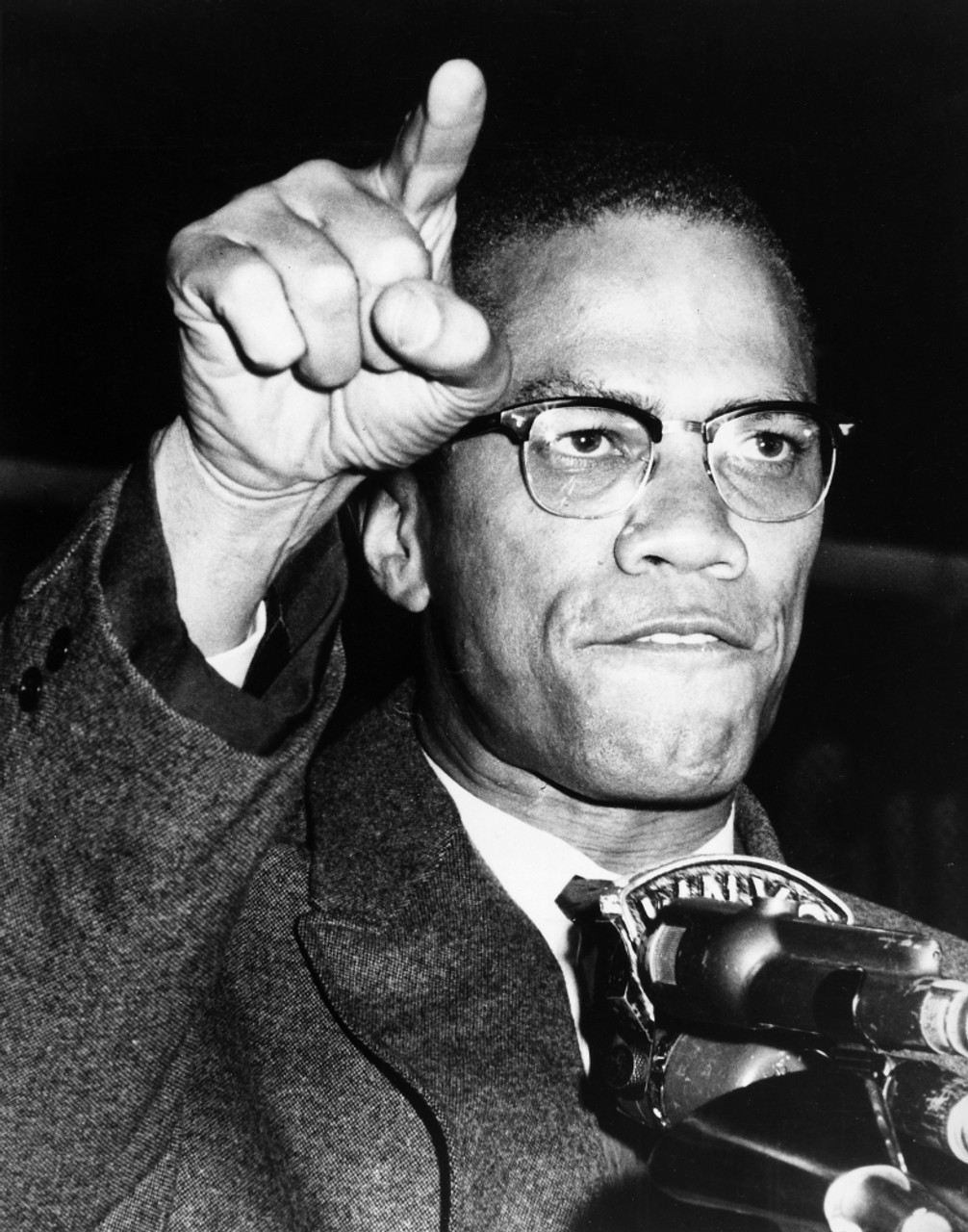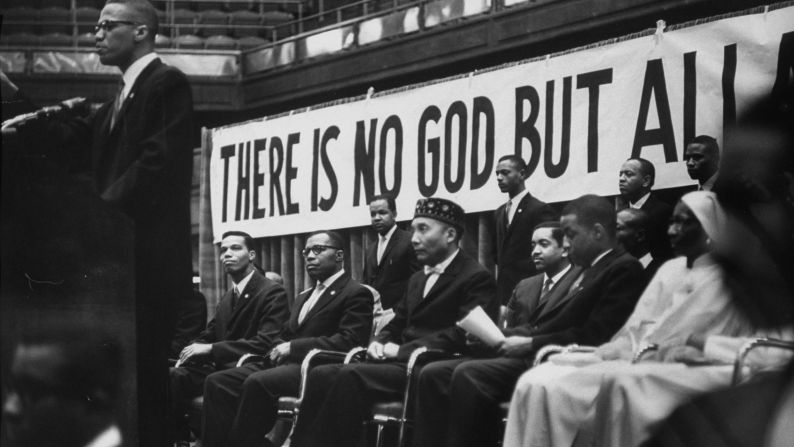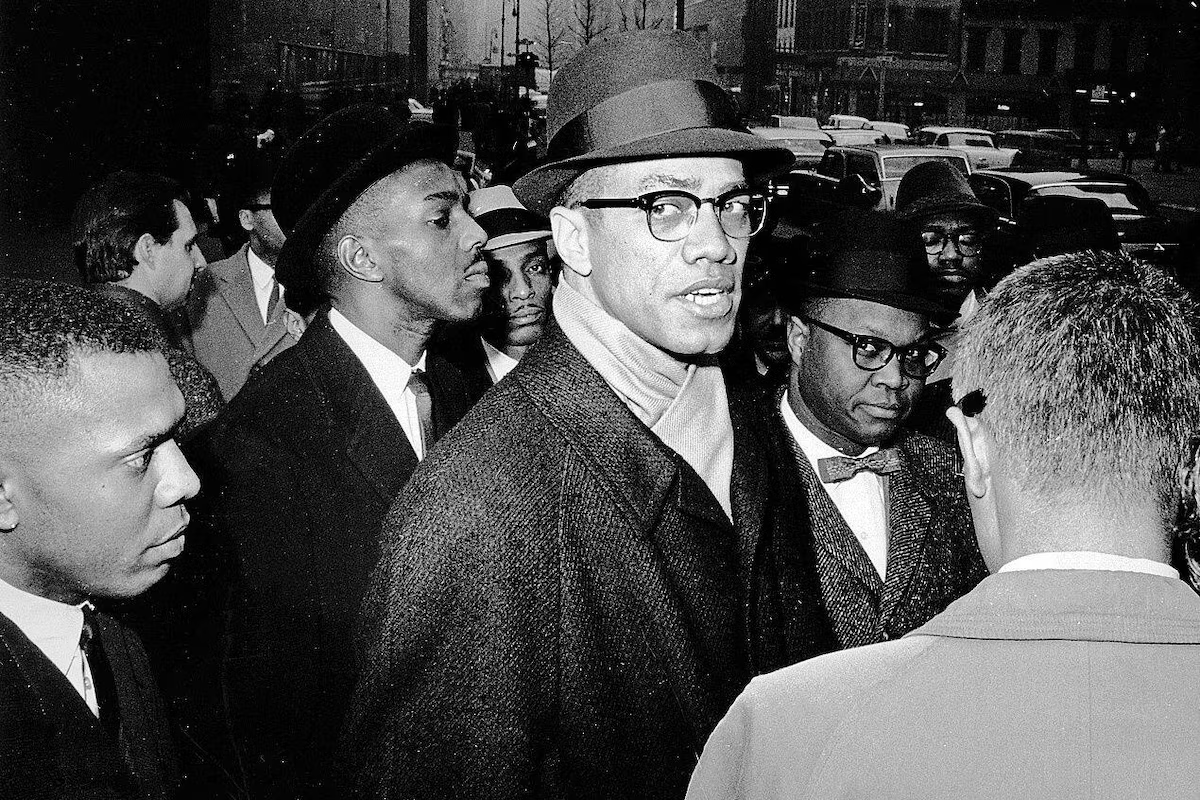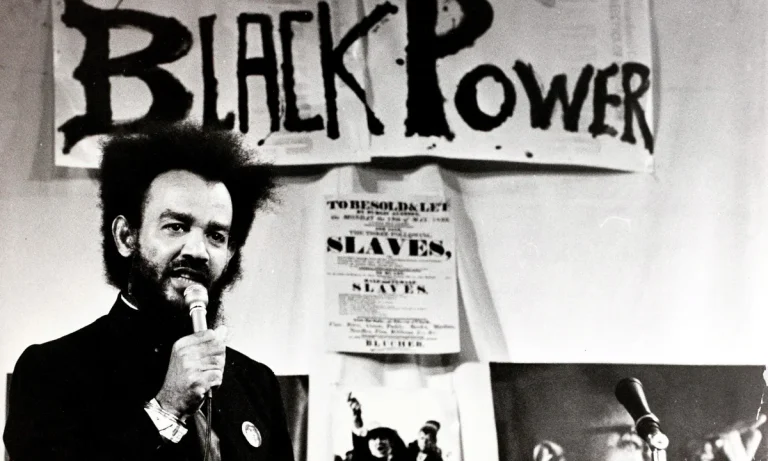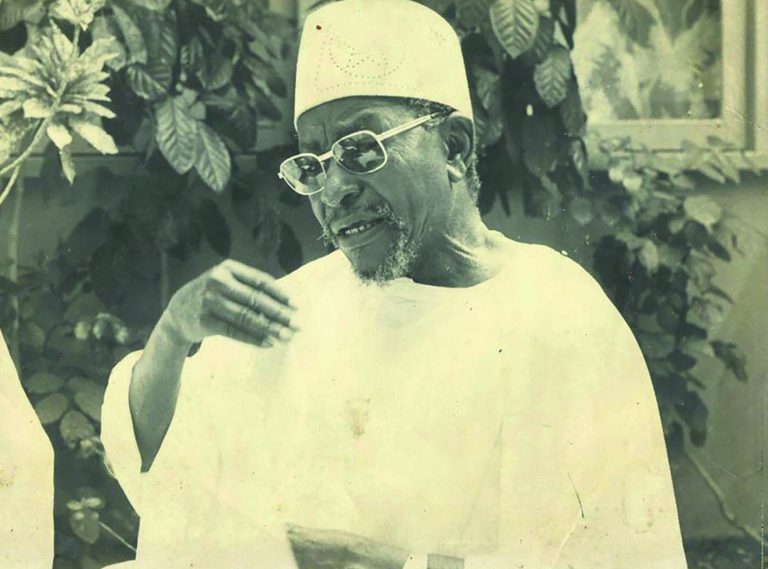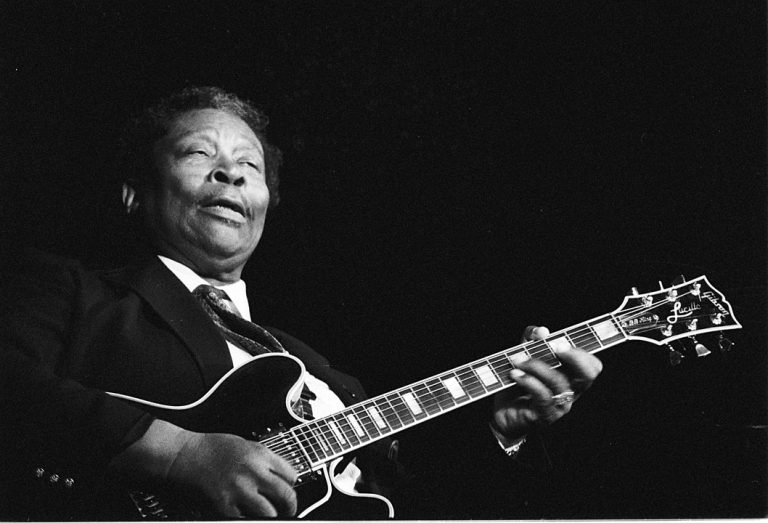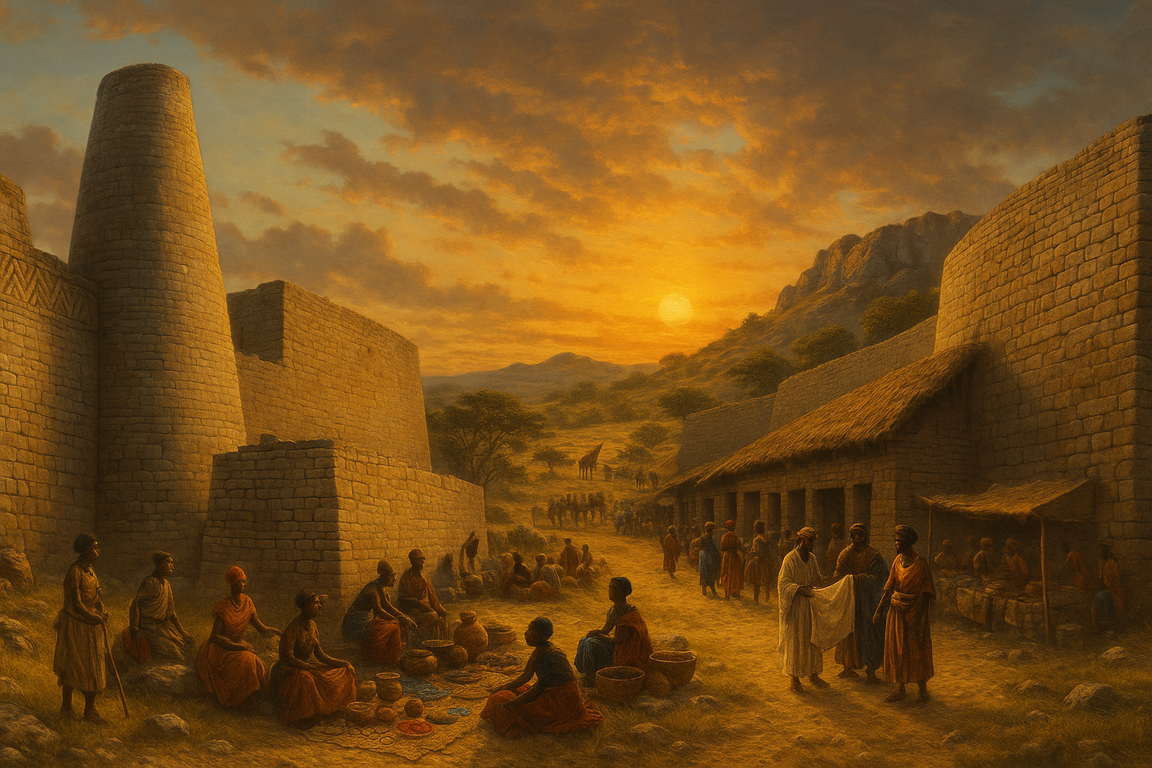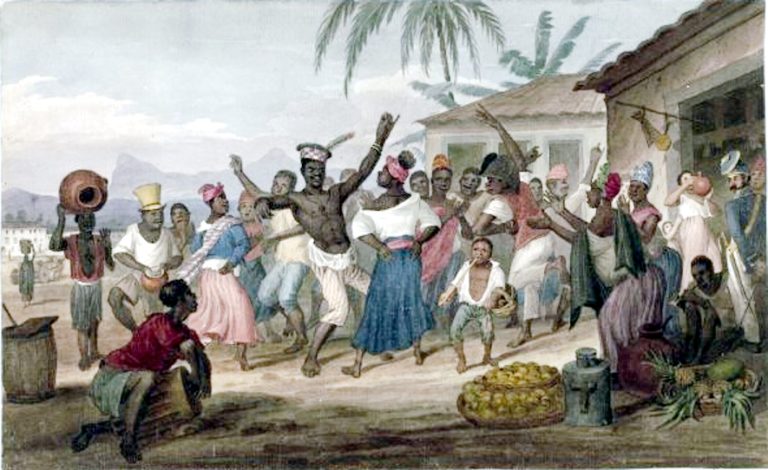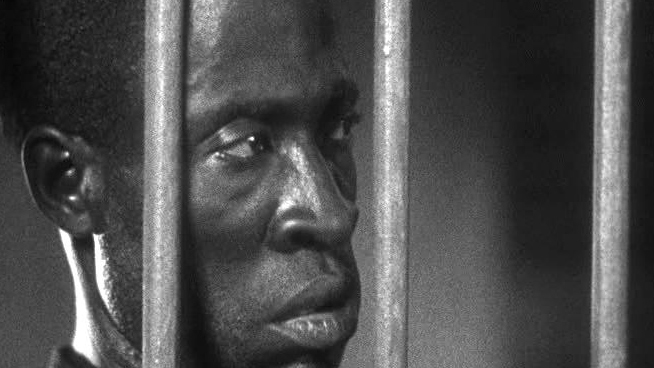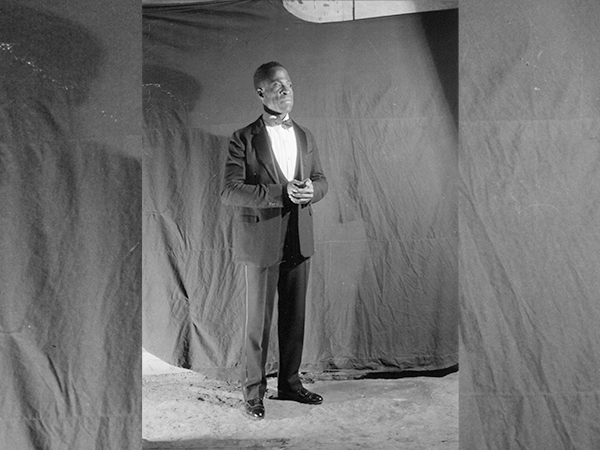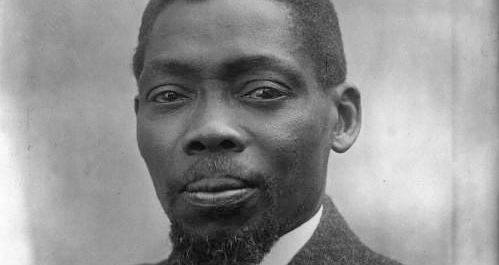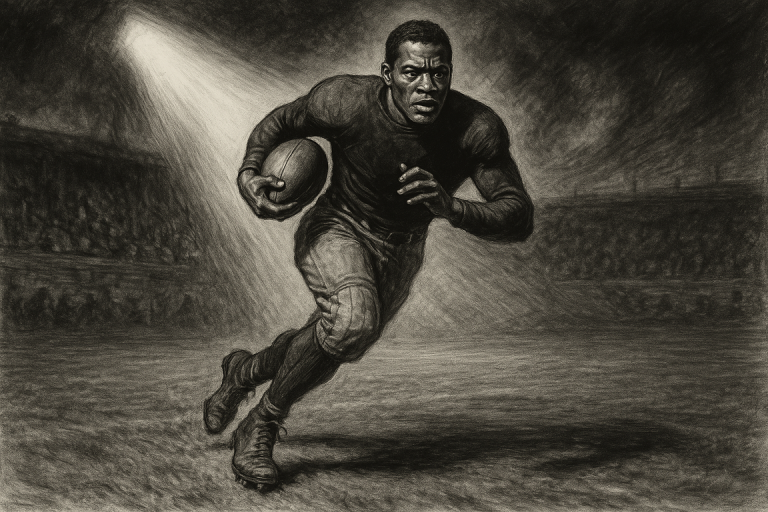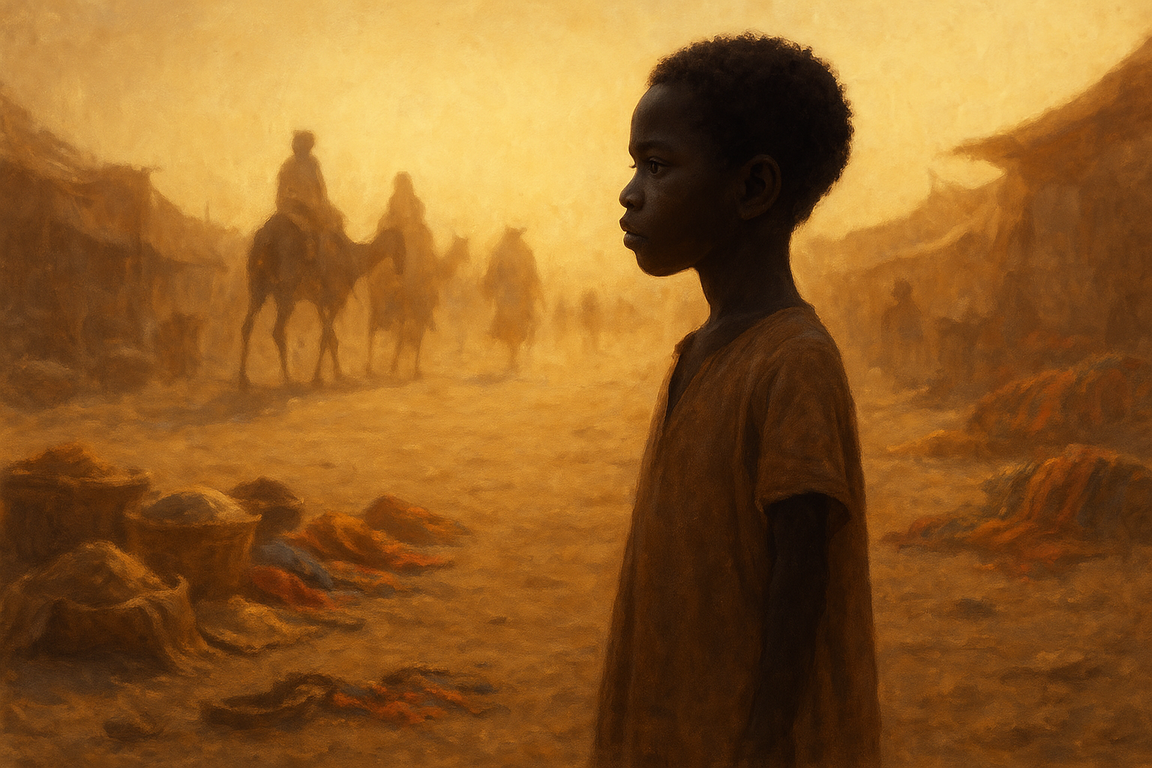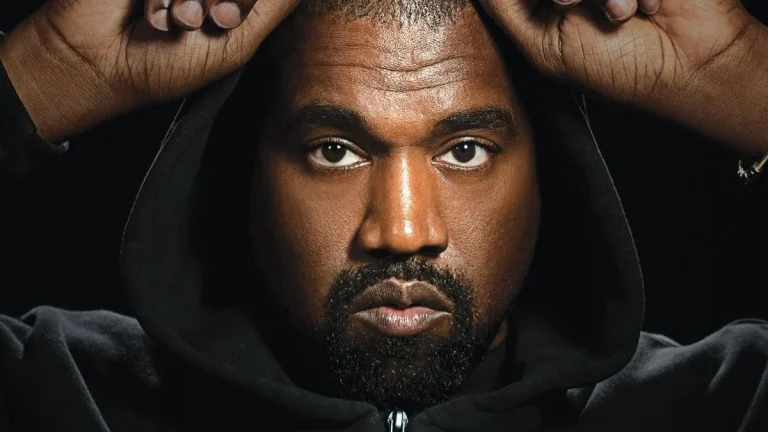L’Histoire appelant l’Histoire, nous vous proposons « The Ballot or the Bullet » (« le bulletin de vote ou la balle », en français), un discours public prononcé le 3 avril 1964 à l’Église méthodiste de Cory à Cleveland, par Malcolm X. Des mots puissants qui sont un véritable appel à ce que la communauté noire exerce judicieusement son droit de vote.
Catherine Flon, l’aiguille de la liberté
Arcahaie, 18 mai 1803. L’air est lourd, la tension vive. Dans un silence fébrile, une femme s’affaire à recoudre ce que son parrain, Jean-Jacques Dessalines, vient de déchirer : le drapeau tricolore français. Il a arraché le blanc (symbole de l’oppresseur) et lui tend les bandes rouge et bleue. Elle coud. Et en cousant, elle tisse plus qu’un étendard : elle donne un visage à la nation à naître. Son nom est Catherine Flon.

Une femme dans l’ombre des géants
Parmi les grandes figures de la Révolution haïtienne, l’histoire a surtout retenu des noms masculins : Toussaint Louverture, stratège emblématique de la première phase insurrectionnelle ; Jean-Jacques Dessalines, le général devenu empereur, artisan de l’indépendance ; ou encore Alexandre Pétion, promoteur d’une République créole post-révolutionnaire1.
À leurs côtés, les femmes ont été longtemps reléguées au second plan, réduites à des rôles symboliques ou anecdotiques. Quelques noms émergent pourtant dans la mémoire populaire : Cécile Fatiman2, la prêtresse du Bois Caïman ; Dédée Bazile3, surnommée Défilée la Folle, qui recueillit le corps de Dessalines. Mais l’une des plus célèbres, bien que souvent cantonnée à une fonction domestique, est Catherine Flon.
Née le 2 décembre 1772 à Arcahaie4, dans la région côtière du Sud-Ouest de Saint-Domingue, Catherine Flon grandit dans une famille impliquée dans le commerce de textiles avec la métropole française. Elle apprend très tôt les arts de la couture, une compétence valorisée mais strictement encadrée dans une société coloniale où les femmes, noires ou métisses, étaient souvent cantonnées à des métiers subalternes.
Si la documentation précise fait défaut (comme pour la plupart des femmes de cette époque) les sources s’accordent à dire qu’elle possédait son propre atelier et formait des apprenties, ce qui dénote un certain degré d’autonomie économique et sociale.
Plus significatif encore : Catherine Flon est la filleule de Jean-Jacques Dessalines, homme de guerre né esclave, devenu l’un des chefs militaires les plus redoutés de l’insurrection haïtienne. Dans le monde afro-créole de Saint-Domingue, la filiation par le baptême, ou marennaj, revêtait une importance quasi familiale. Elle liait les individus par des serments de protection, de loyauté et d’éducation.
Cette relation symbolique confère à Flon une position singulière. Elle n’est pas seulement proche du pouvoir, mais inscrite dans un cercle politique restreint, au cœur de la lutte pour l’indépendance. À une époque où l’accès des femmes à la parole publique est limité, son rôle dans les événements de 1803 traduit une forme d’engagement implicite, mais déterminant.
Dans ce contexte, la couture ne saurait être réduite à un acte décoratif ou ménager. Elle devient un instrument d’expression et de subversion. À travers le fil et l’aiguille, Flon participe à une œuvre de recomposition symbolique : elle raccommode ce que l’oppression avait fracturé, elle donne forme à une identité nationale naissante.
Sa figure illustre ainsi la capacité des femmes à inscrire leur action dans la trame historique, même lorsque celle-ci les relègue à des marges invisibles. En cela, Catherine Flon n’est pas une exception, mais le symbole d’un effacement plus large qu’il convient de réhabiliter.
1803 : L’acte de couture comme geste politique
Le 18 mai 1803, les chefs militaires de l’armée indigène se réunissent à Arcahaie, au nord de Port-au-Prince, afin de sceller l’unité entre les différentes factions de l’insurrection haïtienne face aux troupes napoléoniennes. Cette rencontre stratégique, connue sous le nom de Congrès d’Arcahaie, marque une étape décisive dans la construction d’une identité politique propre, distincte à la fois du modèle colonial et du paradigme républicain français.
C’est au cours de ce congrès que Jean-Jacques Dessalines, figure militaire et politique centrale de l’indépendance haïtienne, aurait accompli un geste symbolique fort : la déchirure du drapeau tricolore français, dont il ôta la bande blanche ; interprétée comme l’incarnation de la domination coloniale.
Les deux bandes restantes, le bleu et le rouge, sont confiées à Catherine Flon, sa filleule, afin qu’elle les assemble pour créer un nouveau drapeau. Ce drapeau deviendra le symbole de la nouvelle entité politique en formation, appelée à se libérer de l’autorité de la France.
L’intervention de Flon ne doit pas être réduite à un acte artisanal ou décoratif.
Elle s’inscrit dans une gestuelle politique : le fil et l’aiguille, instruments de l’ordre domestique, deviennent ici des outils de refondation nationale. Dans ce geste, c’est une rupture qui s’opère : rupture avec la métropole, mais aussi recomposition d’un projet collectif à partir des fragments de l’ancien ordre.
Selon une interprétation postérieure mais largement intégrée dans l’imaginaire haïtien, le bleu représenterait les Noirs, et le rouge les Mulâtres. En cousant les deux couleurs, Flon symbolise l’unité raciale et sociale autour d’un objectif commun : la souveraineté.
Cette lecture, bien que née a posteriori, a permis d’inscrire le geste de Flon dans une mythologie républicaine haïtienne, destinée à renforcer la cohésion nationale et à réhabiliter le rôle des femmes dans la fondation de l’État.
L’importance de cet acte ne réside pas uniquement dans sa réalité factuelle ; les historiens s’accordent à dire que des drapeaux bleu et rouge circulaient déjà parmi les troupes révolutionnaires avant la rencontre d’Arcahaie. Certains groupes l’utilisaient même pour revendiquer les principes de la Révolution française (égalité, liberté, fraternité), sans pour autant viser une rupture totale avec la France.
Cependant, la légende autour du drapeau cousu par Catherine Flon acquiert une valeur performative. Elle transforme un événement politique en mythe fondateur, donnant un visage, un geste, une scène à la naissance symbolique d’Haïti. Et dans ce cadre, la présence d’une femme, artisan du lien et du tissu national, introduit une dimension inclusive qui dépasse les récits exclusivement militaires.
Histoire ou légende ?
Le rôle attribué à Catherine Flon dans la création du premier drapeau haïtien appartient à la mémoire révolutionnaire autant qu’à l’histoire documentée. Selon le récit populaire, elle aurait cousu le drapeau bleu et rouge à la demande de Dessalines lors du congrès d’Arcahaie, en mai 1803. Cependant, cette version des faits ne repose sur aucun témoignage direct ni sur une source contemporaine de l’événement.
Des éléments historiques suggèrent que des drapeaux bicolores circulaient déjà parmi les insurgés bien avant 1803, notamment sous le commandement de Toussaint Louverture. Ces étendards, inspirés des couleurs de la Révolution française, étaient parfois utilisés non pas pour proclamer une indépendance, mais pour revendiquer l’application de la loi d’abolition de 17945, votée par la Convention nationale.
Ainsi, plusieurs historiens, dont Philippe Girard, considèrent que le mythe du drapeau cousu par Flon à Arcahaie pourrait être une reconstruction a posteriori, élaborée dans une logique de symbolisation nationale.
Pour autant, le caractère incertain de l’épisode ne diminue pas sa portée symbolique. L’histoire des nations se constitue souvent à travers des récits fondateurs, qui condensent des valeurs, des tensions et des idéaux dans une scène accessible à la mémoire collective.
Le geste de Catherine Flon, qu’il soit ou non historiquement exact, fonctionne comme une métaphore structurante :
- Il exprime l’unité raciale et politique entre Noirs et Mulâtres dans un contexte de guerre d’indépendance.
- Il introduit une figure féminine agissante dans un récit largement masculinisé.
- Il matérialise, dans un acte simple, l’avènement d’un État souverain, détaché de ses racines coloniales.
Autrement dit, le mythe de Flon ne dit pas nécessairement “ce qui s’est passé”, mais ce que la nation haïtienne a voulu retenir et transmettre : un geste fondateur, un symbole de cohésion, et un espace symbolique ouvert à la participation des femmes dans la création de la République.

La figure de Catherine Flon occupe une place singulière dans l’histoire de la Révolution haïtienne. Si sa participation directe à la création du drapeau national reste entourée d’incertitudes historiques, la portée symbolique de son geste dépasse la factualité.
Elle incarne une mémoire collective dans laquelle l’acte de coudre devient un acte de fondation. En liant les couleurs bleu et rouge, elle matérialise à la fois la rupture avec l’ordre colonial et la volonté d’unité au sein d’un peuple encore divisé par ses origines et ses statuts.
Plus encore, Catherine Flon représente l’introduction d’une figure féminine active dans un récit révolutionnaire dominé par les hommes. Elle rappelle que l’histoire nationale ne se construit pas uniquement sur les champs de bataille, mais aussi dans les marges, les ateliers, les gestes simples et durables.
En ce sens, qu’elle ait réellement cousu le premier drapeau ou non importe moins que ce que sa légende dit de la société haïtienne : un besoin de cohésion, une reconnaissance différée des femmes dans la lutte, et un attachement profond à des symboles chargés de sens.
Aujourd’hui encore, la mémoire de Catherine Flon continue d’irriguer la vie politique, culturelle et identitaire d’Haïti, rappelant que dans toute révolution, les héros de l’ombre sont souvent ceux qui donnent forme au visible.
Sources
- Cécile Accilien, Jessica Adams, Elmide Méléance (dir.), Revolutionary Freedoms: A History of Survival, Strength and Imagination in Haiti, Caribbean Studies Press, 2006.
- Philippe R. Girard, « Birth of a Nation: The Creation of the Haitian Flag and Haiti’s French Revolutionary Heritage », Journal of Haitian Studies, Vol. 15, n°1/2, 2009, pp. 138–141.
- Holidays, Festivals, and Celebrations of the World Dictionary, Omnigraphics, 2015 (dir. H. Henderson).
- The Louverture Project, entrée “Catherine Flon” : louvertureproject.org
- Remember Haiti Exhibit, John Carter Brown Library, section “Race and Slavery”.
- Warrior Women: Women and Armed Resistance Throughout the Diaspora (site archivé).
Notes de bas de page
- Révolution haïtienne (1791–1804) : Insurrection des esclaves contre le système colonial français à Saint-Domingue. Elle aboutit à la première abolition réussie de l’esclavage et à la création d’un État noir indépendant. ↩︎
- Cécile Fatiman : Prêtresse vaudoue et figure mythique du Bois Caïman, elle aurait co-présidé la cérémonie de révolte des esclaves avec Boukman en 1791. ↩︎
- Dédée Bazile (Défilée la Folle) : Femme du peuple qui aurait recueilli le corps mutilé de Dessalines après son assassinat en 1806 et lui aurait donné une sépulture digne. ↩︎
- Arcahaie : Ville située au nord-ouest de Port-au-Prince, considérée comme le berceau symbolique du drapeau haïtien. Le Congrès d’Arcahaie s’y serait tenu en mai 1803. ↩︎
- Loi du 4 février 1794 : Décret de la Convention nationale française abolissant l’esclavage dans les colonies. Elle fut partiellement appliquée à Saint-Domingue avant d’être annulée sous Napoléon. ↩︎
Sommaire
Michael X, révolutionnaire noir et tragédie caribéenne
De Londres à Port of Spain, Michael X a traversé les années 60 en prônant l’émancipation noire et en flirtant avec la controverse. Tour à tour activiste, figure culturelle, fugitif puis condamné à mort, son destin fulgurant continue d’interroger. Que reste-t-il du révolutionnaire radical soutenu par John Lennon ?
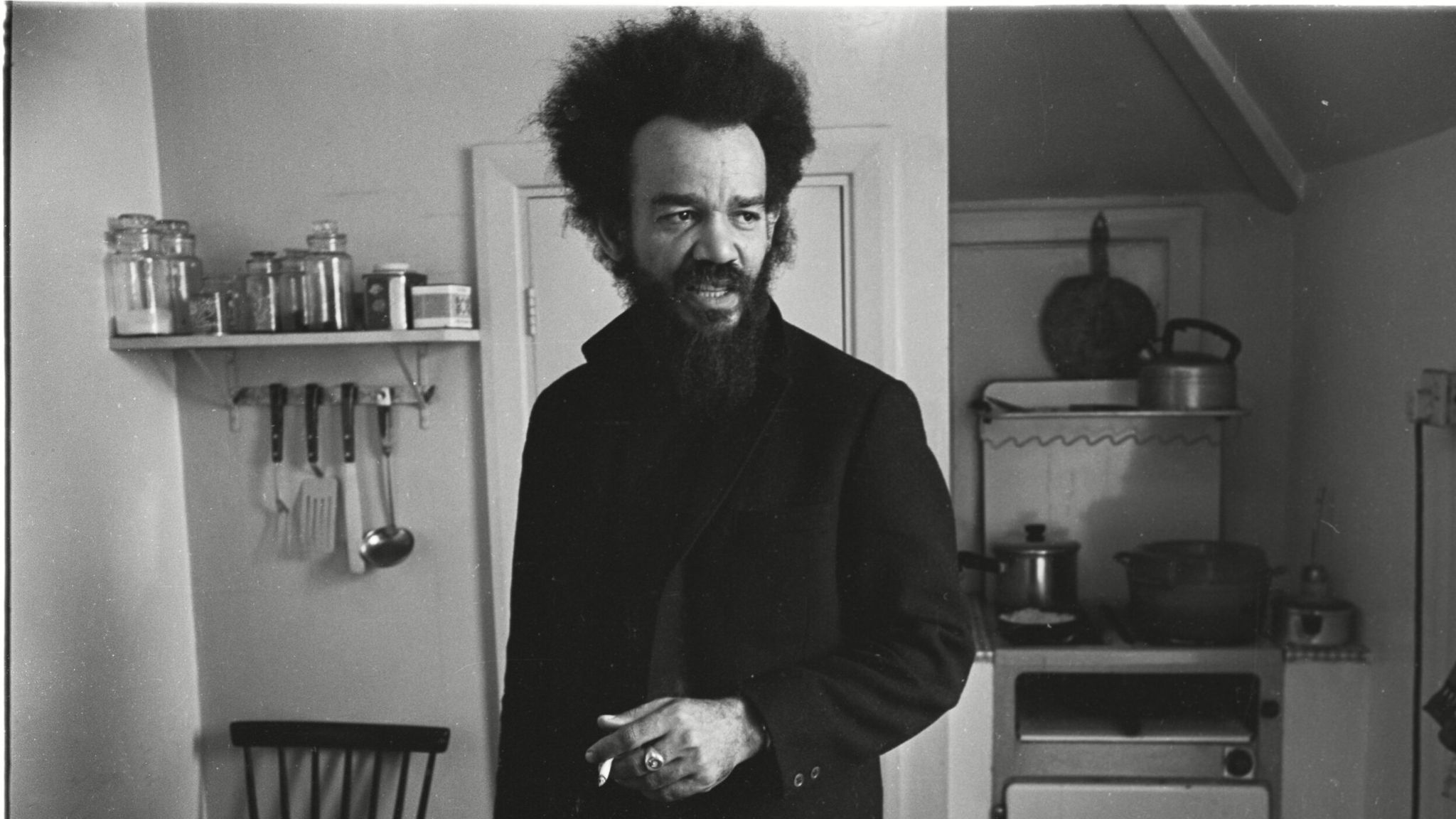
Il portait plusieurs noms, comme on porte plusieurs vies. Michael X. Michael Abdul Malik. Honnêtement, même lui semblait ne plus trop savoir lequel le définissait le mieux.
Il était né à Trinidad, sur les terres chaudes d’un empire qui ne disait plus son nom, mais dont les lois coloniales modelaient encore les corps et les esprits. Il finirait pendu, dans une prison de Port of Spain, accusé de meurtre. Entre-temps, il avait été poète de rue, militant, figure du Black Power britannique, escroc présumé, mystique autoproclamé, parrain d’un ghetto et ami de John Lennon.
Son parcours n’a rien d’un récit linéaire. Il est tout en creux, en tensions, en contradictions.
À Londres, dans les années 60, il fut à la fois la voix d’une colère noire et la proie d’un système judiciaire encore imprégné de racisme institutionnel.
À Trinidad, il tenta de rejouer la révolution sous les palmiers, avant que les corps ne s’accumulent et que les soutiens ne se désagrègent.
Michael X est l’un de ces personnages que l’Histoire n’aime pas trop raconter. Trop provocateur pour être sanctifié. Trop complexe pour être effacé. Il ne s’est jamais contenté de protester : il voulait subvertir, choquer, déconstruire l’Angleterre de l’intérieur.
Et dans cette tentative, il est passé du statut de symbole à celui de paria.
Dans le Londres post-colonial, il incarna pendant quelques années l’orgueil noir dans un monde blanc.
Mais que reste-t-il aujourd’hui de cet homme ? Une silhouette dans un film. Un nom de code dans les archives. Un collier d’esclave en guise de manifeste.
Michael X n’a pas seulement traversé son époque. Il l’a bousculée, jusqu’à s’y briser.
I. Un homme de son temps : entre exil et quête d’identité

A. Origines caribéennes et jeunesse agitée
Trinidad, 1933. L’île est encore une colonie britannique, et les enfants n’y naissent pas libres : ils naissent classés.
Michael de Freitas voit le jour dans une société traversée par les hiérarchies raciales, sociales, linguistiques.
Son père est barbadien, sa mère portugaise. Une combinaison peu orthodoxe dans les rues de Belmont, et surtout, une métissage ambigu, qui le place à la marge des clivages communautaires. Trop noir pour être blanc, trop blanc pour être noir.
Il grandit avec cette dissonance tatouée sur la peau.
Très tôt, il comprend qu’il devra inventer sa propre place. Il observe les colons, les juges, les policiers ; tous blancs. Il comprend que la langue de l’autorité est l’anglais d’Oxford. Alors il l’imite. Il le perfectionne. Il le retourne contre eux.
À l’adolescence, c’est le départ. Direction : Londres.
Il quitte les Caraïbes avec un rêve de grandeur, mais découvre, comme tant d’autres migrants venus du Commonwealth, la réalité brutale de la métropole racialisée.
Londres ne l’accueille pas comme un sujet de l’Empire, mais comme un intrus.
Dans les années 50, il survit comme portier de boîte de nuit, videur, chauffeur. Mais c’est dans l’univers souterrain des trafics immobiliers qu’il se fait un nom. Aux côtés de Peter Rachman, figure sulfureuse du logement insalubre à Notting Hill, il devient un homme de main, habile et menaçant.
Déjà, son regard détonne : brillant, tranchant, insaisissable. Il n’est pas encore Michael X. Mais il se prépare.
B. La rencontre avec Malcolm X et la naissance d’un militant
C’est Malcolm X qui va l’embraser.
Lorsque le leader afro-américain débarque à Londres en février 1965, Michael est encore Michael de Freitas, figure trouble du West End. Mais dans les mots de Malcolm, il entend quelque chose qu’aucun discours britannique ne lui avait jamais offert :
la dignité noire, sans compromis.
Ce n’est pas seulement une rencontre. C’est une révélation. Quelques jours plus tard, Malcolm X est assassiné à New York. Michael en fait un serment de vie.
Il change de nom. Il devient Michael Abdul Malik, puis Michael X. L’X est un hommage ; mais aussi une énigme, une provocation. Il efface son nom colonial, rejette la logique de transmission esclavagiste. Et il adopte le lexique enflammé du Black Power américain, qu’il adapte à la réalité britannique.
Mais l’Angleterre n’est pas Harlem. Elle n’a ni Martin Luther King, ni Rosa Parks, ni Nation of Islam. Elle a la Reine, Scotland Yard, la BBC.
Michael X, désormais, va déranger.
II. L’essor du militantisme noir au Royaume-Uni
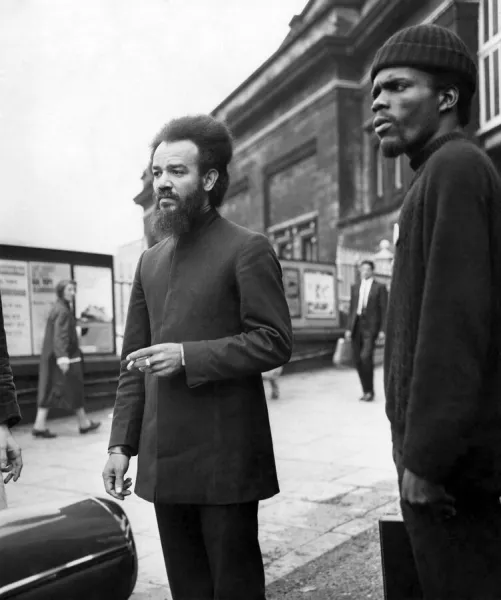
A. Le paysage racial britannique dans les années 60
Londres, années 60. On l’imagine libre, moderne, vibrante. Mais pour les Afro-Caribéens arrivés des colonies, la capitale britannique est surtout un labyrinthe de refus.
Pas de panneaux « Whites Only », mais des frontières invisibles dans les rues, les pubs, les écoles. Pas de lois ségrégationnistes, mais des discriminations quotidiennes, acceptées, normalisées, presque polies.
L’emploi, le logement, l’éducation, la police : chaque institution est une barrière.
À la fin des années 50, les émeutes de Notting Hill (1958) explosent comme un coup de tonnerre : jeunes Blancs, encouragés par les discours xénophobes des groupes fascisants, attaquent les immigrés noirs. Pendant plusieurs nuits, les pavés du quartier vibrent sous les cris et les coups. La réponse de l’État ? Minimale. Silencieuse.
C’est dans ce vide, entre colère et abandon, que Michael X va trouver sa voix. L’Angleterre ne lui donne pas d’espace ? Il en crée un. Il ne veut pas seulement dénoncer le racisme : il veut en faire un combat politique radical, un discours de libération noire, ancré dans la réalité britannique.
B. La Racial Adjustment Action Society et la Black House
En 1965, il fonde la Racial Adjustment Action Society (RAAS), un acronyme piquant pour un projet sérieux. C’est l’un des premiers mouvements noirs radicaux en Angleterre, bien avant la British Black Panther Party. L’objectif ? Rééduquer les jeunes Noirs, défendre leurs droits, déracialiser la société par la confrontation.
Mais Michael X ne se contente pas de créer une organisation : il crée un lieu. À Notting Hill, il fonde la Black House, un espace communautaire, politique, spirituel, artistique. On y croise des militants, des boxeurs, des artistes, des poètes. On y discute révolte, on y organise des conférences, on y vit entre Noirs, pour les Noirs.
Le projet séduit. Il dérange aussi.
Il reçoit le soutien de personnalités internationales : John Lennon et Yoko Ono, Muhammad Ali, Jean-Paul Sartre ; tous voient en Michael X une sorte de miroir du moment révolutionnaire mondial. Mais à l’intérieur même de la Black House, les accusations de dérives se multiplient : autoritarisme, intimidation, dérives financières.
Le discours se durcit. Les caméras s’installent. Scotland Yard s’approche.
Le procès pour incitation à la haine raciale en 1967 marque un tournant. Michael X devient le premier homme en Angleterre poursuivi sous la nouvelle loi sur les discours haineux. Pour ses partisans, il est un pionnier de la liberté d’expression noire. Pour ses adversaires, un agitateur dangereux.
Dans la presse, il est tour à tour prophète et charlatan. Dans les rues, il est adulé ou conspué.
Mais il est, surtout, devenu visible. Et cela, en soi, est une révolution.
III. L’homme traqué : controverses, fuites et chutes

A. Procès et scandales
Les figures radicales attirent la lumière ; jusqu’à ce qu’elle les brûle.
À la fin des années 60, Michael X est partout. Il parle haut, il dénonce fort, il dérange beaucoup.
Ses apparitions publiques sont théâtrales, son phrasé tranchant. Il incarne à lui seul un nouveau type d’homme noir britannique : fièrement africain, violemment anticolonial, délibérément provocateur.
Mais cette visibilité a un prix.
En 1967, il est inculpé sous le Race Relations Act, tout juste adopté. Motif : avoir déclaré que « les Noirs devraient tuer les Blancs pour être libres. » Le contexte est ignoré. Le ton est retenu. Le couperet tombe. Pour la presse blanche, il devient une caricature de révolutionnaire. Pour la police, un cas d’école.
Ce procès, hautement médiatisé, fait de lui le premier Britannique condamné pour incitation à la haine raciale. Ironie historique : ce texte de loi, censé protéger les minorités du racisme, est utilisé pour faire taire l’un des rares Noirs à s’exprimer contre l’ordre colonial.
La Black House, autrefois sanctuaire, devient un piège. Les services secrets la surveillent. Les dissensions internes éclatent. Certains parlent d’intimidations. D’autres de manipulation. Un jour, Michael fait placer un collier d’esclave autour du cou d’un jeune blanc, censé symboliser l’inversion des rôles. La presse en fait ses gros titres. L’opinion bascule.
Cerné, Michael X prend la fuite.
B. L’exil à Trinidad et la spirale meurtrière
En 1970, il retourne à Trinidad, comme on retourne au point de départ. Mais ce n’est plus le jeune de Freitas. C’est un homme en cavale. Un prophète en exil. Là-bas, il veut tout recommencer. Il fonde une nouvelle « Black House », dans un style plus mystique, plus rural, presque sectaire. Il parle de retour aux sources, d’autosuffisance, d’élévation.
Mais la communauté s’enferme. Les tensions montent. La paranoïa s’installe.
En 1972, deux corps sont découverts :
- Gale Benson, une militante britannique blanche, compagne d’un proche de Michael, retrouvée enterrée vivante.
- Joseph Skerritt, ancien associé, abattu pour des raisons obscures.
Michael X est arrêté. Le mythe s’effondre.
Le procès a lieu à Port of Spain, capitale de Trinidad-et-Tobago. Les journaux, cette fois, ne parlent plus d’activisme, mais de culte, de folie, de sang. Le révolutionnaire est devenu criminel. En 1975, il est condamné à mort et pendu. Jusqu’au bout, il nie avoir commandité les meurtres.
Mais plus personne ne l’écoute.
IV. Héritage, rumeurs et mémoire fragmentée
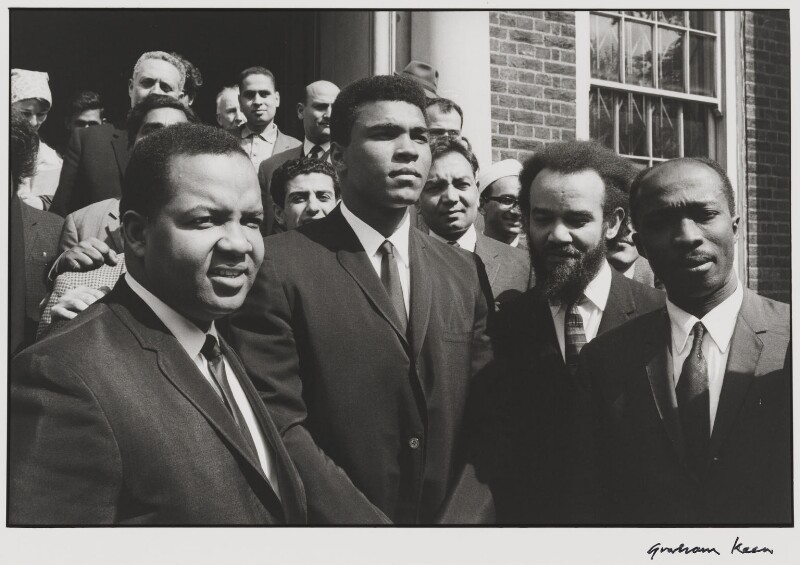
A. Activiste ou imposteur ?
Aujourd’hui encore, le nom de Michael X divise.
Pour certains, il fut un opportuniste, un imposteur charismatique surfant sur la vague du Black Power pour asseoir une autorité personnelle. Pour d’autres, un précurseur oublié, brisé par l’hostilité d’un système qui ne voulait pas voir un homme noir détenir autant de pouvoir médiatique et politique en Grande-Bretagne.
Des figures comme Darcus Howe ou Stokely Carmichael ont reconnu en lui un frère de lutte, même si sa trajectoire ne fut ni linéaire, ni irréprochable. Il incarna à sa manière la colère d’une génération qui n’acceptait plus de se taire, de se fondre, de demander timidement une place à la table.
Ses soutiens d’hier (Lennon, Yoko Ono, Muhammad Ali) se sont murés dans le silence après sa chute. La presse l’a relégué dans les marges. Et pourtant, des voix persistent à défendre la nécessité de sa parole, sinon de ses actes.
Car Michael X n’a jamais été un pur. Il fut un homme de chair et de contradiction.
Mais dans son tumulte, il a forcé l’Angleterre à regarder son miroir colonial.
B. Un personnage de fiction ?
Le destin de Michael X est si romanesque qu’il hante encore les écrans et les pages.
Dans le film The Bank Job (2008), il est évoqué comme un homme dangereux, au cœur d’un complot mêlant gangsters et services secrets. Certains le disent instrumentalisé par le MI6, d’autres surveillé de près par la CIA, en raison de ses liens avec des figures panafricanistes radicales.
Mais les archives officielles restent classifiées jusqu’en 2054.
Jusque-là, nous sommes condamnés à naviguer entre témoignages contradictoires, fantasmes révolutionnaires et récits fragmentaires. Michael X flotte entre la figure du militant abattu et celle du gourou dévoyé.
Dans les livres, il est un chapitre.
Dans la mémoire noire britannique, un fantôme.
Dans l’histoire officielle, un oubli.
Que faire d’un homme comme Michael X ?
Il ne rentre dans aucune case. Pas assez consensuel pour être commémoré. Trop important pour être effacé. Son destin éclaire autant qu’il dérange. Il révèle les limites de nos récits, les fragilités de nos mythes, la violence des exils postcoloniaux.
À travers lui, c’est une question qui nous est posée :
comment fabrique-t-on les héros noirs ? À quelles conditions les célèbre-t-on ? Et à quelles fautes les condamne-t-on à disparaître ?
Michael X ne fut ni un ange ni un monstre. Il fut un homme de son époque, une époque de feu et de fractures.
Son histoire, entre révolution noire et tragédie caribéenne, mérite d’être relue non pour l’absoudre, mais pour comprendre ; ce que signifie, encore aujourd’hui, être libre, noir et inacceptable.
Sources
- Michael X: Hustler, Revolutionary, Outlaw, The Floor Magazine, 2022.
- Michael X and the Black House, BBC Archive, [bbc.co.uk].
- Michael X, article Wikipédia, [en.wikipedia.org/wiki/Michael_X].
- Témoignages de contemporains recueillis dans :
- Black Britain: A Photographic History, Paul Gilroy, 2007.
- Voices of the Windrush Generation, David Matthews, 2018.
Sommaire
Les neuf degrés de la vie selon la tradition peule
La tradition peule décrit la vie humaine comme un chemin initiatique en neuf degrés, où l’homme devient progressivement porteur et transmetteur de la sagesse ancestrale.
Le grand voyage de l’Homme selon la tradition Peule
En 1960, devant l’Assemblée générale de l’UNESCO, Amadou Hampâté Bâ s’élevait en défenseur des sagesses africaines oubliées. Dans cet esprit, un enseignement fondamental, transmis dans les sociétés peules, rappelle que la vie humaine est rythmée par neuf degrés d’initiation.
Un chemin de l’enfance vers la vieillesse, conçu non comme une simple succession d’âges, mais comme une école progressive de l’âme.
L’Homme : tout et rien selon la tradition peule

Dans la tradition spirituelle peule, l’être humain est un paradoxe vivant.
Tout, car il est éclairé par une étincelle de la force créatrice. Chaque homme, chaque femme porte en son essence un fragment de la puissance divine, une énergie originelle qui le relie au grand Tout. Cette part sacrée n’est pas une abstraction : elle confère à l’humain la capacité de comprendre, de créer, d’aimer, et surtout de se transcender.
Rien, car dès sa naissance dans la matière, l’homme est entravé par la lourdeur de son propre corps, par les désirs, par la peur, par l’ignorance.
La tradition peule compare cette condition humaine à une fièvre incessante : une chaleur maladive qui trouble la vision, altère le jugement, détourne l’homme de son origine divine.
Ainsi, la vie est un chemin d’éveil :
- D’abord engourdi, l’homme doit peu à peu vaincre l’inertie de sa nature matérielle.
- Chaque étape de l’existence est une lutte pour reconquérir la clarté intérieure, pour rallumer la flamme d’où il provient.
Ce combat n’est pas un affrontement brutal, mais une ascension lente, rythmée par des cycles précis (les « neuf degrés ») et par l’exigence d’un travail constant sur soi.
Ne pas progresser, c’est reculer. Dans cet enseignement, la vie humaine n’est jamais statique :
Elle est mouvement, initiation, transformation permanente.
À travers cette double définition (tout et rien), la philosophie peule affirme une vision profondément spirituelle mais aussi rigoureusement exigeante de la condition humaine.
Être né homme, ce n’est pas un aboutissement : c’est seulement recevoir la chance de devenir pleinement humain.
Le premier cycle : l’apprentissage fondamental (0-21 ans)
Dans la vision peule de l’existence humaine, les vingt-et-une premières années de vie constituent un cycle déterminant, où l’être humain reçoit les fondations de son être spirituel, social et intellectuel. Ce cycle est divisé en trois étapes de sept ans, chacune correspondant à un degré d’initiation.
De 0 à 7 ans : l’école de la mère

Au commencement, l’enfant est tout entier plongé dans l’univers maternel.
La mère n’est pas seulement la source de nourriture et de soin : elle est l’interprète du monde.
Tout ce que l’enfant voit, entend, ou expérimente doit passer par la médiation maternelle :
- Est-ce vrai ce que m’a dit mon père ?
- Dois-je croire ce que j’ai vu chez le voisin ?
- Est-il bon de faire ceci ou cela ?
La mère détient l’autorité sacrée sur la vérité, car elle est la gardienne première du savoir et de la morale. Dans cet âge tendre, l’esprit de l’enfant est malléable ; c’est le moment où l’on grave les premières lignes sur la tablette de son âme.
De 7 à 14 ans : l’école du dehors
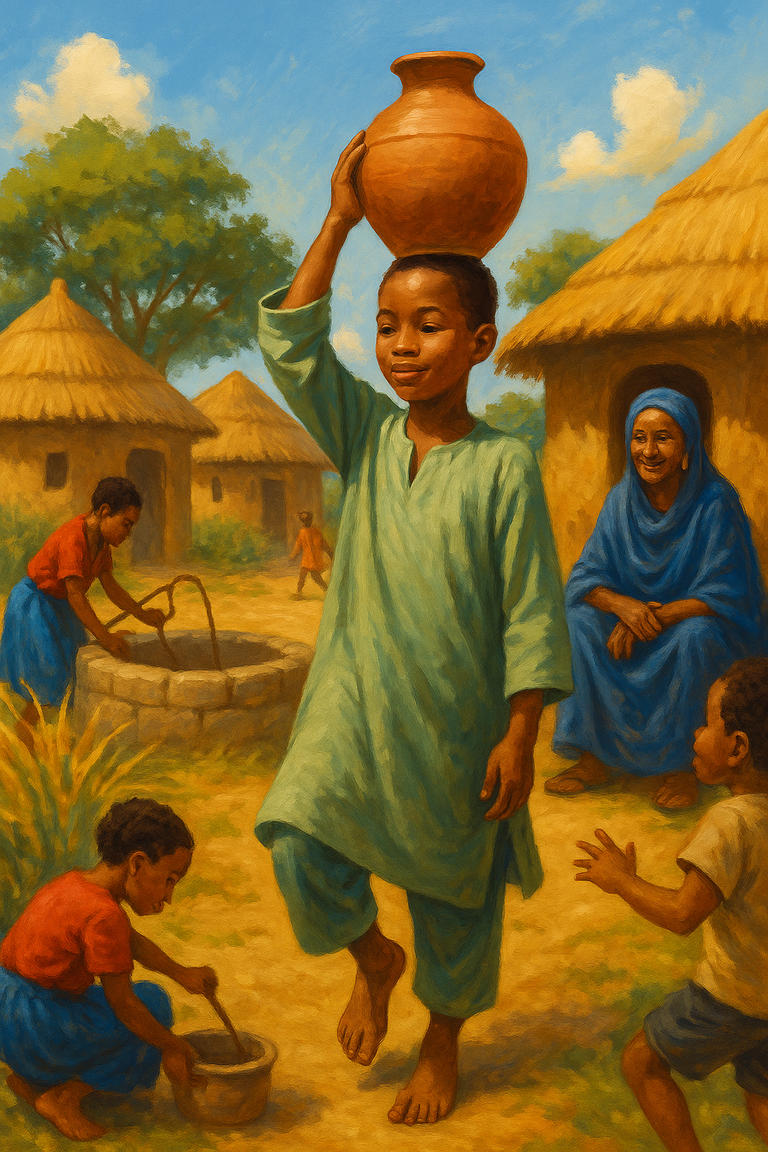
À partir de sept ans, l’enfant s’ouvre au dehors.
L’univers s’élargit : camarades, maîtres, travaux domestiques ou villageois deviennent autant d’écoles parallèles.
Dans la tradition peule, tout est enseignement :
- Puiser de l’eau au puits enseigne la discipline.
- Jouer apprend la coopération ou la ruse.
- Écouter les anciens transmet des valeurs invisibles.
Cependant, même en pleine découverte, l’enfant continue de revenir consulter sa mère. Il ne se fie pas encore totalement à ce qu’il apprend au dehors sans l’aval de celle qui fut sa première lumière. Ce va-et-vient constant entre curiosité et sécurité fonde l’équilibre du jeune esprit.
De 14 à 21 ans : l’affirmation individuelle
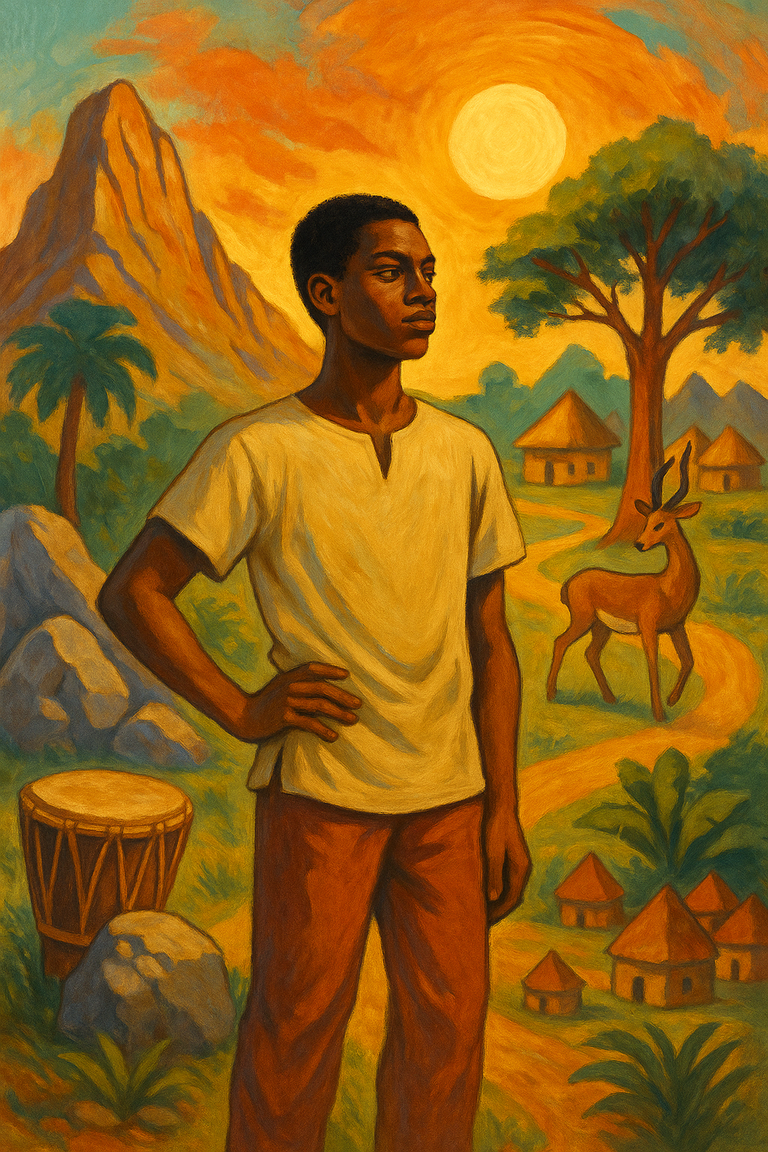
À quatorze ans, l’adolescent entre dans une phase de rupture progressive.
Il commence à opposer ses propres raisonnements à ceux de ses éducateurs.
Il discute, il questionne, parfois même il conteste sa mère ; preuve qu’il devient un être pensant, non plus seulement un être recevant.
À cet âge, la tradition exige que l’adolescent soit exposé à la connaissance des quatre règnes :
- Minéral (la terre, les pierres, les montagnes)
- Végétal (les arbres, les plantes, les cycles agricoles)
- Animal (les créatures mobiles, les esprits de la chasse)
- Humain (les structures sociales, les alliances, les conflits)
Ce premier cycle, long et progressif, forge un être partiellement éveillé, prêt à entamer l’ascension vers les vérités supérieures de l’existence.
À 21 ans, il a achevé son premier tour d’horizon de la vie terrestre, mais il n’est encore qu’un apprenti de l’Être.
Le deuxième cycle : affermir son être (21-42 ans)
Dans la tradition peule, le chemin de la maturité ne s’achève pas avec la simple acquisition de savoirs. Une fois le premier cycle de la vie bouclé à 21 ans, débute une phase plus exigeante : celle de l’approfondissement de l’être, où l’on ne se contente plus d’apprendre, mais où l’on doit comprendre, assimiler, et éprouver la valeur de chaque enseignement.
Approfondissement

De 21 à 42 ans, l’homme refait un second parcours initiatique, mais cette fois, de manière intérieure.
- Ce qu’il a appris des règnes minéral, végétal, animal et humain n’est plus seulement observé : il doit être éprouvé.
- Les vérités transmises doivent être testées par l’expérience, confrontées à l’épreuve du réel.
- L’individu doit se purger des illusions, vaincre l’orgueil naissant, tempérer l’exubérance de la jeunesse.
Cette période est marquée par une exigence de profondeur et de patience : il ne suffit plus de connaître ; il faut mériter son savoir par la sagesse.
Comme une plante qui a fleuri, l’homme doit maintenant enraciner ses vertus, afin que la tempête des épreuves ne l’arrache pas.
42 ans : l’âge du droit de parole

Ce n’est qu’à l’issue de ce long cheminement, à 42 ans, que l’homme est autorisé à prendre la parole publique.
Ce droit n’est pas une simple récompense d’âge biologique :
- Il atteste que l’individu a consolidé son être intérieur.
- Il peut désormais enseigner sans flatterie, conseiller sans orgueil, arbitrer sans colère.
À partir de 42 ans, il est considéré comme un sage en devenir, un pilier de la communauté dont la parole, pesée et mûrie, peut servir de guide aux plus jeunes et soutenir l’ordre collectif.
La tradition peule affirme ainsi que la parole est un fruit tardif : elle doit être mûrie dans le silence, nourrie par la vie, filtrée par la conscience.
Le troisième cycle : la transmission suprême (42-63 ans)
Dans la conception peule du chemin de vie, l’acquisition du savoir n’a de sens que s’il est redonné. Après 42 ans, l’homme n’appartient plus à lui-même : il devient une source.
Le devoir de transmission
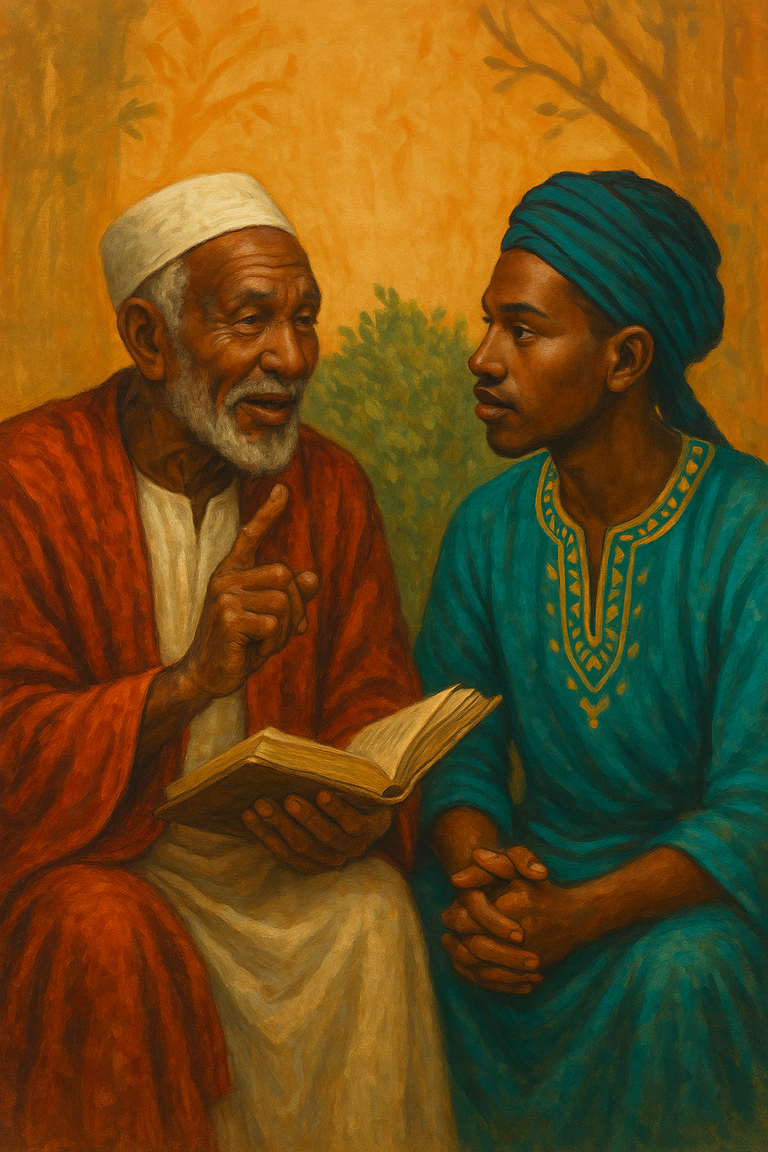
Entre 42 et 63 ans, la sagesse acquise ne doit plus être gardée en silence :
- Il faut enseigner, corriger, guider ceux qui, plus jeunes, parcourent encore leur propre montée initiatique.
- Chaque conseil, chaque arbitrage, chaque récit devient un acte sacré de transmission.
- L’homme, mûri par deux cycles de 21 ans, doit désormais féconder la société de son expérience, tout comme les anciens l’ont fécondé jadis.
Dans cette phase, le silence n’est plus vertu : il devient au contraire un manquement si l’expérience n’est pas partagée.
Le vieillard peul n’est pas seulement un vieux : il est un jardinier de mémoire, responsable de la continuité des savoirs et des valeurs.
À 63 ans : l’honneur du retrait

À 63 ans, la mission sociale est accomplie. On dit alors de l’homme qu’il est « hors du parc », selon une belle métaphore pastorale :
- Comme un ancien taureau libéré de l’enclos, il n’a plus d’obligations communautaires strictes.
- Il reste une référence morale, honorée pour son parcours, mais il n’est plus sommé de rendre compte ni d’enseigner activement.
La société peule reconnaît dans ce retrait non pas une perte, mais une consécration :
le sage entre dans une autre dimension de l’existence, faite de contemplation, de bénédiction silencieuse et, parfois, de préparation spirituelle pour la grande traversée finale.
Ainsi se clôt, en majesté, le triple cycle de la vie humaine selon la tradition peule : naissance, affirmation, transmission. Trois temps pour une seule quête : réaliser la plénitude de l’être.
Devenir pleinement homme
Pour la sagesse peule, vivre, ce n’est pas seulement avancer dans le temps ; c’est gravir patiemment les degrés de son propre être.
Chaque étape de vie (de l’enfance sous l’aile maternelle à l’âge d’or de la transmission) forme un apprentissage sacré, destiné à reconnecter l’homme à son origine divine.
Le Peul traditionnel ne mesure pas une vie à sa durée, mais à la qualité de la conscience que l’homme a su cultiver à travers elle.
L’ultime honneur n’est pas d’avoir existé longtemps, mais d’avoir su enseigner, élever, préserver.
Et peut-être, comme l’enseignaient les anciens, de quitter ce monde en laissant plus de lumière qu’on n’en avait trouvé.
Source principale :
Documentaire d’Ange Casta, Un certain regard, diffusé sur la première chaîne française, le 7 septembre 1969.
Sommaire
Amadou Hampâté Bâ, gardien de la tradition orale africaine
Amadou Hampâté Bâ, écrivain, ethnologue et sage africain, a consacré sa vie à sauver de l’oubli les traditions orales d’Afrique de l’Ouest. De Bandiagara à l’UNESCO, il incarna l’exigence d’une mémoire vivante face aux silences de l’Histoire. Portrait d’un passeur de civilisations.
UNESCO, 1960.
Un silence solennel règne dans l’enceinte de l’Assemblée générale. Les représentants du monde entier, réunis pour discuter de l’avenir de la culture, tendent l’oreille vers un orateur peu ordinaire.
Amadou Hampâté Bâ, vêtu d’un boubou clair, s’avance, serein. Le visage empreint d’une sagesse calme, il déclame d’une voix grave, avec la lenteur méditative des griots :
« En Afrique, quand un vieillard meurt, c’est une bibliothèque qui brûle. »
La phrase, simple en apparence, fend l’atmosphère diplomatique comme une onde.
En quelques mots, Hampâté Bâ rappelle au monde que l’Afrique, souvent jugée par l’Occident à travers le prisme déformant de l’écrit, possède depuis des siècles ses propres trésors de savoirs, transmis de bouche à oreille, de génération en génération.
Il ne s’agit pas simplement d’une nostalgie, mais d’une alerte : chaque perte humaine non consignée signifie l’effacement d’histoires, de traditions, de sciences et de spiritualités irremplaçables.
À travers cette déclaration devenue proverbiale, Amadou Hampâté Bâ ne défend pas seulement la tradition orale africaine ; il s’érige en gardien d’une mémoire universelle, en passe de disparaître sous les assauts de la modernité brutale et de l’oubli.
Son œuvre, son engagement, ses combats trouveront dans cette scène un symbole éclatant : faire parler l’Afrique, non pour figer un passé idéalisé, mais pour affirmer que la transmission des savoirs est le fondement de toute civilisation vivante.
D’une école coranique à l’administration coloniale

Né autour de 1901 à Bandiagara, au cœur du pays dogon, Amadou Hampâté Bâ est d’emblée un enfant du carrefour africain. Fils d’une lignée peule prestigieuse, il grandit dans une mosaïque culturelle où l’islam soufi, la tradition orale, et les premiers balbutiements de la colonisation française s’entrelacent.
Sa prime éducation est celle de l’oralité : il fréquente l’école coranique dirigée par Tierno Bokar1, maître spirituel de la confrérie tidjaniyya. C’est là qu’il apprend non seulement les préceptes religieux, mais surtout l’art de l’écoute, de la mémoire et du récit. Chez Bokar, le savoir n’est pas un stock à accumuler mais une lumière intérieure à cultiver.
Cependant, l’administration coloniale impose à l’adolescent une autre voie : l’école française. Arraché aux enseignements traditionnels, il découvre à Djenné, puis à Kati, les rudiments d’une culture écrite qui ignore tout de la richesse orale africaine. Ce passage forcé n’éteint pas son âme d’apprenti-griot ; au contraire, il nourrit une conscience aiguë du clivage entre deux mondes.
Refusant l’école normale de Gorée, pépinière des élites coloniales dociles, Amadou Hampâté Bâ est puni : il est affecté comme « écrivain temporaire » à Ouagadougou. Commence alors une vie de fonctionnaire précaire, ballotté de ville en ville, mais surtout d’observateur attentif d’une Afrique qui résiste, s’adapte et souffre sous l’autorité française.
Déjà, dans ses notes prises à la hâte et ses cahiers dissimulés, germe l’idée qui guidera son œuvre entière : sauver les voix oubliées avant qu’elles ne sombrent dans l’abîme du silence.
Sauvegarder la mémoire orale
Dès les années 1940, grâce à l’appui du grand naturaliste Théodore Monod, Amadou Hampâté Bâ rejoint l’Institut Français d’Afrique Noire (IFAN)2 à Dakar. Il y inaugure une œuvre discrète mais décisive : collecter, transcrire et analyser les traditions orales de l’Afrique de l’Ouest. Dans un monde académique encore dominé par des visions eurocentrées, son travail est une révolution silencieuse.
L’Afrique, disait-il, ne s’écrit pas, elle se parle.
Convaincu que les griots, les maîtres de l’initiation et les conteurs détiennent des trésors historiques équivalents aux archives européennes, il sillonne savanes et villages, armé d’une patience infinie. Pendant quinze ans, il recueille épopées peules, récits de filiation, traités de savoirs spirituels, qu’il compare et vérifie avec une rigueur scientifique rare à l’époque pour l’oralité.
En 1960, année des indépendances, son expertise le propulse sur la scène internationale. À l’UNESCO, où il représente le Mali nouvellement libre, il plaide pour la reconnaissance officielle de l’oralité comme patrimoine universel. Son cri (« En Afrique, un vieillard qui meurt, c’est une bibliothèque qui brûle ») devient un aphorisme mondial, rappelant aux jeunes nations que leur passé vivant mérite autant d’attention que les temples ou manuscrits figés.
Entre 1962 et 1970, membre du Conseil exécutif de l’UNESCO, il participe activement à l’élaboration d’une transcription unifiée des langues africaines, étape capitale pour ancrer les traditions orales dans la modernité sans les trahir.
Pour Hampâté Bâ, défendre l’oralité n’est pas un geste nostalgique : c’est une stratégie de souveraineté intellectuelle. Sans la mémoire de leurs ancêtres, affirmait-il, les Africains risquaient de devenir des « étrangers sur leur propre terre« .
L’écrivain, le penseur et l’héritage

Dans les années 1970, Amadou Hampâté Bâ abandonne toute fonction diplomatique pour se consacrer entièrement à l’écriture. Il n’écrit pas pour dominer, ni pour séduire : il écrit pour transmettre, comme on passe un flambeau avant qu’il ne s’éteigne. Chaque mot, chaque page est pour lui un acte de fidélité envers ses maîtres spirituels, ses ancêtres et les voix anonymes de l’Afrique intérieure.
L’Étrange Destin de Wangrin (1973) révèle au monde son immense talent littéraire. Dans ce roman basé sur des faits réels, il brosse le portrait d’un Africain rusé naviguant entre les pièges de la colonisation française. Subtil, drôle, amer aussi, Wangrin est à l’image de l’Afrique coloniale : résistante, contrainte, mais jamais vaincue.
À travers ses récits initiatiques (Kaïdara, Petit Bodiel), ses essais philosophiques (Aspect de la civilisation africaine) et ses mémoires monumentaux (Amkoullel, l’enfant peul, Oui, mon commandant !), Hampâté Bâ tisse une fresque humaniste et spirituelle. Il réconcilie l’Afrique des contes et celle de la pensée, démontre que la tradition orale peut atteindre des sommets de complexité philosophique insoupçonnés.
À sa mort, en 1991 à Abidjan, il laisse une œuvre foisonnante mais aussi un chantier inachevé : préserver, valoriser, enseigner les héritages africains hors des schémas imposés par l’histoire coloniale.
Aujourd’hui, sa pensée résonne plus que jamais. Face aux défis de l’effacement culturel, de la mondialisation uniformisante, Amadou Hampâté Bâ continue d’enseigner une leçon précieuse :
« Le passé n’est pas un fardeau, mais un socle vivant pour inventer l’avenir. »

Source
- Encyclopædia Universalis, article « Amadou Hampâté Bâ ».
- Hampâté Bâ, Amadou. Amkoullel, l’enfant peul. Paris, Julliard, 1991.
- Hampâté Bâ, Amadou. L’Étrange Destin de Wangrin. Paris, Union Générale d’Éditions, 1973.
- Heckmann, Hélène. « Amadou Hampâté Bâ et la récolte des traditions orales », Journal des Africanistes, 1993.
- UNESCO, Discours d’Amadou Hampâté Bâ, 1960, archives sonores.
Notes de bas de page
- Tierno Bokar, marabout tidjane malien (1875-1939), maître spirituel d’Amadou Hampâté Bâ, a inspiré de nombreux écrits sur la tolérance religieuse et la transmission du savoir oral. ↩︎
- IFAN (Institut français d’Afrique noire), fondé en 1936 à Dakar par Théodore Monod, fut un centre pionnier dans la recherche ethnologique et l’étude des cultures africaines traditionnelles. ↩︎
Sommaire
De Marius Cultier à Kassav’ : la Philharmonie de Paris fait vibrer la mémoire caribéenne
Du 15 au 18 mai 2025, la Philharmonie de Paris célèbre la musique et la culture de la Caraïbe, avec des hommages vibrants à Marius Cultier, Sélène Saint-Aimé, Anthony Joseph et Kassav’.
À Paris, pendant quatre jours, les murs de la Philharmonie ne résonneront pas de symphonies européennes classiques. Ils vibreront aux rythmes du bèlè, du gwoka, du jazz créole et du zouk. Ils raconteront une autre histoire : celle d’une diaspora caribéenne insoumise, inventive, flamboyante.
Du 15 au 18 mai 2025, la Grande Salle Pierre Boulez et la Cité de la musique accueilleront un programme exceptionnel, où se croisent mémoires vives et métissages assumés.
Un hommage à la hauteur de figures légendaires : Marius Cultier, Sélène Saint-Aimé, Anthony Joseph et Kassav’.
Un appel à la mémoire, mais aussi à la création.
Jeudi 15 mai : Hommage à Marius Cultier, météore martiniquais

Né à Fort-de-France en 1942 et disparu en 1985, Marius Cultier fut bien plus qu’un pianiste : un passeur de mondes, un inventeur de sons, un poète des Caraïbes.
Entre jazz, biguine, musiques latines et expérimentations sonores, il a façonné un style incandescent, en avance sur son temps.
Pour lui rendre hommage, David Donatien, percussionniste et directeur artistique du projet, orchestre une grande soirée entouré d’artistes majeurs :
- Ralph Thamar,
- Tony Chasseur,
- Kareen Guiock Thuram (chant),
- Alain Jean-Marie,
- Mario Canonge,
- Grégory Privat,
- Thierry Vaton (pianos),
- Ludovic Louis (trompette),
- Irving Acao (saxophone),
- Grégory Louis (batterie)
- et Rody Cereyon (basse).
Un hommage vibrant à un créateur météorique, dont l’aura illumine encore la jeune scène créole.
📅 Jeudi 15 mai – 20h
📍 Salle des concerts – Cité de la musique
Samedi 17 et dimanche 18 mai : Sélène Saint-Aimé et la poésie créole

Dans l’univers du jazz contemporain, Sélène Saint-Aimé fait figure d’étoile montante.
Contrebassiste, chanteuse et compositrice, elle tisse une musique profondément métissée, aux racines caribéennes assumées.
À travers son projet Creole Songs, elle revisite les répertoires de la Louisiane, des Antilles et de la Réunion, faisant jaillir une voix libre, poétique, habitée.
Son jazz est une odyssée identitaire, nourrie par l’histoire, la mémoire et la vibration du monde créole.
📅 Samedi 17 mai – 18h (1re représentation)
📅 Dimanche 18 mai – 16h (2e représentation)
📍 Amphithéâtre – Cité de la musique
Samedi 17 mai (soir) : Anthony Joseph, la parole en feu

Anthony Joseph est un incendiaire de scène.
Poète, romancier, chanteur, il fusionne spoken word, free jazz, dub et héritages caribéens dans une exploration sonore sans frontières.
Avec Roger Raspail et Dave Okumu, il imagine The Caribbean is Everywhere, une performance habitée, où la créolité n’est pas une nostalgie mais une force de rupture.
À travers ses textes brûlants et ses improvisations musicales, Anthony Joseph fait de chaque concert une traversée des imaginaires insurgés.
📅 Samedi 17 mai – 20h
📍 Salle des concerts – Cité de la musique
4. Dimanche 18 mai : Portrait d’Haïti ; musique, poésie et mémoire

À 16h, l’artiste Célimène Daudet et le photographe Corentin Fohlen proposent un voyage sensible à travers Haïti.
À partir de son album Haïti mon amour, Célimène Daudet fait dialoguer le piano, la poésie créole et les images de son île natale.
Entre compositions de Ludovic Lamothe, Justin Élie ou Saintonge, poèmes et photographies contemporaines, Portrait d’Haïti est une traversée intime et politique de l’âme haïtienne.
Un moment suspendu, où musique, histoire et résistance se répondent en miroir.
📅 Dimanche 18 mai – 16h
📍 Le Studio – Philharmonie de Paris
Dimanche 18 mai : Kassav’, l’éternelle traversée
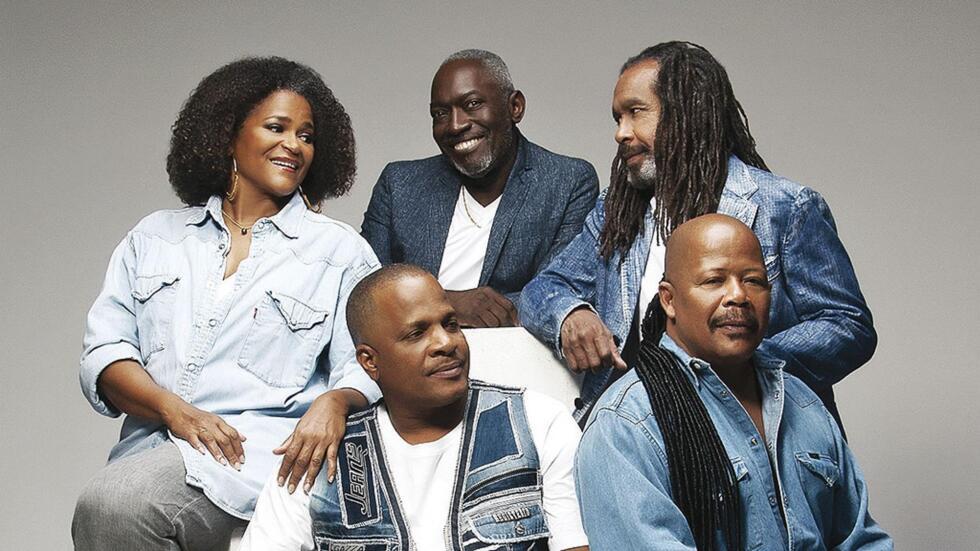
Kassav’, c’est la révolution du zouk.
Le groupe fondé en 1979 par Jacob Desvarieux, Georges et Pierre-Édouard Décimus a propulsé la Guadeloupe et la Martinique sur la carte du monde musical.
Des Antilles à l’Afrique, du Japon à l’URSS, Kassav’ a fait danser les foules et a ouvert une voie pour toutes les musiques créoles modernes.
Le concert du 18 mai sera un hommage vibrant à Jacob Desvarieux, disparu en 2021, mais dont l’esprit continue d’irriguer les sons et les coeurs.
Plus qu’un concert : une communion, une fête de la mémoire vivante.
📅 Dimanche 18 mai – 20h
📍 Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie
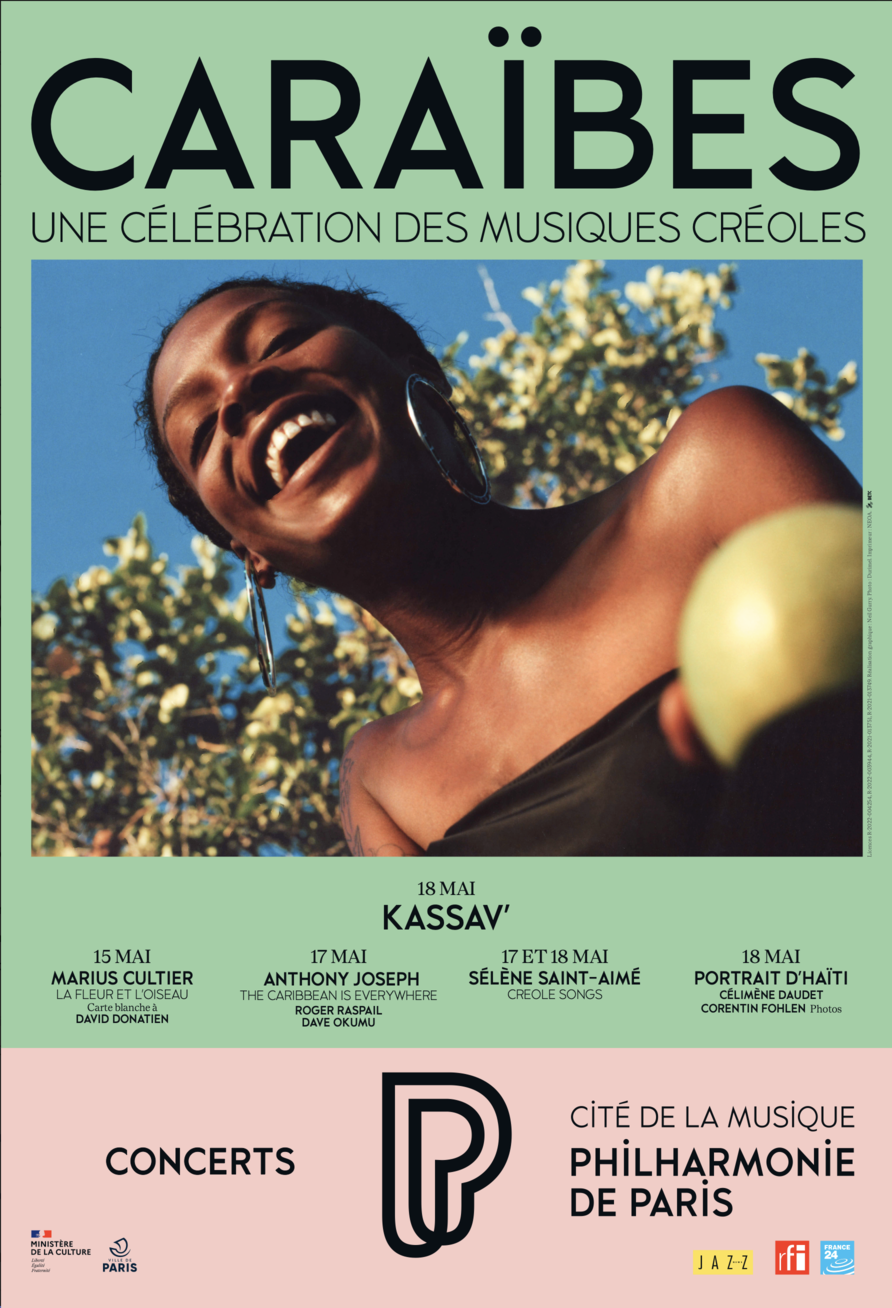
À travers ces quatre jours, la Philharmonie invite à une autre écoute du monde : une écoute créole, diasporique, inextinguible.
Un monde de brassages, de luttes et de résiliences, porté par la puissance des musiques caribéennes.
Un monde où la mémoire est rythme, où l’avenir est en chantier, et où chaque note raconte l’histoire d’un peuple debout.
Sommaire
Le « Code noir », ce fantôme juridique en voie d’abolition
Alors que la France commémore l’abolition de l’esclavage, une anomalie historique ressurgit : le Code noir, texte fondateur de l’esclavage colonial, n’a jamais été formellement abrogé. Interpellé à l’Assemblée, François Bayrou promet de réparer cet oubli symbolique en engageant une abrogation officielle. Un geste fort pour aligner enfin mémoire et légalité.
Bayrou promet la fin du Code noir : quand la République soigne ses oublis
3 mai 2025, Assemblée nationale. Dans l’hémicycle tendu des Questions au gouvernement, un député soulève une anomalie troublante, presque irréelle : le « Code noir », cet édit royal du XVIIᵉ siècle qui légiférait sur l’esclavage dans les colonies françaises, n’aurait jamais été formellement abrogé.
Face à l’assemblée, François Bayrou, Premier ministre, se lève. Sa voix, habituellement posée, trahit une certaine stupeur :
« Grâce à votre question, je découvre cette réalité juridique que j’ignorais absolument. »
Dans un moment de gravité rare, il s’engage : un texte sera présenté pour enfin acter, symboliquement mais nécessairement, l’abolition du Code noir.
Ainsi, sous les ors de la République, un fragment oublié d’une histoire douloureuse remonte à la surface. Car derrière la technicité législative, c’est la mémoire de millions d’hommes et de femmes réduits en esclavage qui réclame justice et reconnaissance.
Pourquoi, en 2025, la France doit-elle encore solder les héritages juridiques du colonialisme ? Comment un texte aussi chargé de violence a-t-il pu survivre silencieusement dans l’ombre des grands récits nationaux ?
Nofi explore l’histoire, l’oubli, et l’enjeu politique autour du « Code noir » ; ce fantôme du passé que la République cherche enfin à exorciser.
Organiser l’esclavage colonial



À la fin du XVIIᵉ siècle, alors que la France étend son empire colonial aux Antilles (Saint-Domingue, Martinique, Guadeloupe), l’économie sucrière impose un besoin crucial de main-d’œuvre.
Face à cette réalité économique, Jean-Baptiste Colbert, ministre de Louis XIV, élabore en 1685 une ordonnance destinée à réguler juridiquement l’esclavage dans les colonies françaises1.
Le Code noir, tel qu’il sera connu, vise officiellement à :
- Encadrer la traite et la possession d’esclaves noirs.
- Normaliser les rapports entre colons, esclaves et administration royale.
- Maintenir l’ordre social tout en s’assurant de la conversion catholique des captifs.
Les esclaves y sont définis explicitement comme des « biens meubles » : ils peuvent être achetés, vendus, transmis par héritage au même titre qu’un objet ou une parcelle de terre.
- L’article 44 est sans ambiguïté :
« Déclarons les esclaves être meubles. »
La violence physique est légalisée et encadrée :
- Les maîtres sont autorisés à infliger des punitions corporelles, des marquages au fer, des mutilations (notamment la coupe d’oreilles pour tentative de fuite).
- Cependant, l’assassinat d’un esclave est théoriquement passible de sanction, non par humanisme, mais pour protéger la valeur économique du « bien ».
La dimension religieuse est également essentielle :
- Les maîtres ont l’obligation de baptiser leurs esclaves et de leur imposer la foi catholique.
- Toute pratique de religions africaines, ou tout culte autre que celui de l’Église catholique, est strictement interdit et réprimé.
Ce corpus de soixante articles constitue ainsi une institutionnalisation de l’esclavage par l’État français :
- Il ne se contente pas de tolérer la traite ; il la légitime juridiquement,
- Et il construit une hiérarchie raciale officiellement reconnue.
Plus qu’une simple loi coloniale, le Code noir symbolise l’organisation rationnelle d’un système d’exploitation humaine, placé au cœur du projet colonial français.
une abolition incomplète

La fin du XVIIIᵉ siècle bouleverse l’ordre établi en Europe et dans ses colonies. Sous l’impulsion des idées des Lumières et de la Révolution française, la question de l’esclavage, jusqu’alors considérée comme un fait naturel de l’économie coloniale, entre enfin dans le débat public.
En 17942, dans un contexte d’agitation révolutionnaire en métropole et de révoltes massives d’esclaves à Saint-Domingue (notamment la célèbre insurrection menée par Toussaint Louverture), la Convention nationale adopte le décret du 4 février 1794, proclamant :
« L’esclavage est aboli dans toutes les colonies françaises. »
Pour la première fois, une nation occidentale abolit juridiquement l’esclavage sur l’ensemble de son empire colonial. Cependant, cette abolition est aussi fragile que l’équilibre politique révolutionnaire lui-même :
- La mise en œuvre est inégale : certaines colonies tardent à appliquer la loi.
- L’abolition est perçue davantage comme une mesure stratégique pour conserver les colonies que comme une véritable reconnaissance des droits des esclaves.
À peine quelques années plus tard, Napoléon Bonaparte, devenu Premier Consul, rétablit l’esclavage par la loi du 20 mai 18023.
- Cette décision cynique vise à restaurer la prospérité économique des colonies sucrières des Antilles, alors en crise.
- Napoléon affirme que l’égalité raciale est incompatible avec les intérêts économiques de l’Empire colonial.
Le Code noir reprend alors vigueur, renforçant l’ordre esclavagiste et provoquant des soulèvements dramatiques, notamment en Guadeloupe et en Guyane.
Il faut attendre la Deuxième République, en avril 18484, pour que l’esclavage soit aboli de manière irrévocable dans les colonies françaises.
- Le décret est impulsé par Victor Schœlcher, fervent abolitionniste et sous-secrétaire d’État à la Marine et aux Colonies.
Le texte proclame :
« Nulle terre française ne peut porter d’esclaves. »
Cependant, un paradoxe demeure :
- Si l’esclavage est bien interdit,
- Le « Code noir », comme texte juridique, n’est jamais expressément abrogé.
Cette lacune législative, laissée dans l’ombre, va traverser les siècles jusqu’à ressurgir de manière spectaculaire en 2025.
Pourquoi l’absence d’abrogation dérange ?


Au lendemain de l’abolition de 1848, l’urgence est à la reconstruction des colonies et à la redéfinition du travail libre.
- La France abolit l’esclavage, mais elle ne prend pas soin de nettoyer ses textes fondateurs.
- Résultat : le Code noir, bien que rendu inapplicable par la suppression légale de l’esclavage, n’est jamais explicitement abrogé.
Ce silence administratif, probablement perçu à l’époque comme anecdotique, prend aujourd’hui une signification symbolique majeure :
- Le fait qu’un texte asservissant des millions d’êtres humains reste inscrit dans l’arsenal juridique national constitue une forme d’oubli, voire de déni.
- Il témoigne d’une hésitation historique à pleinement assumer le passé colonial et esclavagiste.
La persistance du Code noir dans les archives juridiques françaises alimente, au XXIᵉ siècle, des revendications mémorielles de plus en plus fortes :
- Descendants d’esclaves,
- Intellectuels,
- Associations antiracistes,
- Historiens engagés dans un travail de reconnaissance des traumatismes collectifs.
Pour eux, l’absence d’abrogation formelle n’est pas une simple bizarrerie juridique :
- C’est un symptôme profond d’un retard dans le travail de mémoire.
- C’est le reflet d’une République qui a célébré ses idéaux sans toujours réparer ses propres blessures historiques.
Aujourd’hui, abolir officiellement le Code noir, même purement symbolique d’un point de vue juridique, a une portée immense :
- Cela revient à affirmer hautement que la France ne tolère plus dans ses textes fondamentaux aucun vestige d’un système inhumain.
- C’est réconcilier les principes de liberté, d’égalité et de fraternité avec la réalité historique.
Car au-delà du droit, il s’agit d’une question de dignité, de mémoire réparatrice, et d’un geste politique pour bâtir une histoire commune plus lucide.
La promesse de François Bayrou

Le 13 mai 2025, à l’Assemblée nationale, le député Laurent Panifous5 (groupe LIOT) interpelle solennellement le Premier ministre François Bayrou.
Dans une atmosphère tendue, il rappelle une évidence dérangeante : malgré l’abolition de l’esclavage en 1848, le « Code noir » n’a jamais été abrogé par un acte formel.
Dans un geste rare, Bayrou reconnaît publiquement cet oubli :
« Si le Code noir n’a pas été aboli en 1848, il faut qu’il le soit. 6»
À cet instant, l’émotion dépasse le simple débat juridique.
Il est question de réconciliation morale entre la République et son histoire coloniale.
Face à l’Assemblée, François Bayrou s’engage :
- Un texte législatif sera présenté dans les semaines suivantes,
- Afin d’acter officiellement l’abolition du Code noir,
- Et de réaffirmer les valeurs fondamentales de dignité humaine.
Le Premier ministre espère un vote unanime, dépassant les clivages politiques habituels.
Il ne s’agit plus simplement d’amender un vieux texte : il s’agit de purger le droit français d’une souillure historique, pour aligner définitivement mémoire et législation.
En choisissant de traiter ce dossier avec urgence et solennité, le gouvernement français adresse :
- Un hommage tardif aux millions de victimes de l’esclavage colonial,
- Un geste de justice mémorielle envers leurs descendants,
- Et une affirmation claire que la République ne peut tolérer aucune trace, même symbolique, d’oppression codifiée.
Ainsi, l’abolition formelle du Code noir deviendra un acte politique fondateur pour une France contemporaine pleinement consciente de ses héritages ; et prête à les assumer.
Abolir un texte, ce n’est pas abolir un passé.
En décidant enfin d’abroger formellement le « Code noir », la France ne corrige pas seulement une lacune administrative ; elle accomplit un geste symbolique essentiel : reconnaître que le droit aussi peut porter les cicatrices de l’histoire.
Ce long oubli, devenu visible en 2025, rappelle que la mémoire n’est jamais définitivement acquise.
Elle exige vigilance, engagement, et parfois des actes tardifs mais nécessaires pour réconcilier les principes fondateurs de la République avec les réalités complexes de son passé colonial.
Le « Code noir » n’est plus appliqué depuis longtemps, certes.
Mais son ombre persistante illustre combien le droit et la mémoire sont intimement liés : ce que l’on n’efface pas juridiquement continue d’exister dans l’imaginaire collectif.
Effacer un texte infâme, c’est proclamer que la dignité humaine ne tolère aucun compromis, ni dans les faits, ni dans les mots.
Car l’histoire ne s’efface pas, mais elle peut être réparée, pas à pas, mot après mot.
Sources
- Archives publiques : Ordonnance de 1685 dite « Code noir », consultée via Légifrance (version historique).
- Sala-Molins, Louis. Le Code noir ou le calvaire de Canaan. Presses Universitaires de France, 1987.
- Schoelcher, Victor. Abolition de l’esclavage : écrits historiques (1848). Paris, Librairie générale française, 1998.
- Débats parlementaires de l’Assemblée nationale, séance du 13 mai 2025, intervention de Laurent Panifous et réponse du Premier ministre François Bayrou.
Notes
- Ordonnance de mars 1685, dite Code noir, promulguée sous Louis XIV pour réglementer l’esclavage dans les colonies françaises. Source : Archives nationales, section Colonies, dossier Code noir. ↩︎
- Décret du 4 février 1794, Convention nationale : « La Convention nationale déclare l’abolition de l’esclavage dans toutes les colonies. » Débats et décrets révolutionnaires, tome XVII. ↩︎
- Loi du 20 mai 1802, sous Napoléon Bonaparte : restauration officielle de l’esclavage dans les colonies françaises. Texte consultable sur Gallica (BnF). ↩︎
- Décret du 27 avril 1848, signé par Victor Schœlcher : abolition définitive de l’esclavage dans les territoires coloniaux français. Archives nationales, fonds Colonies XIXᵉ siècle. ↩︎
- Intervention de Laurent Panifous, Assemblée nationale, séance du 13 mai 2025 : « La France n’a jamais formellement abrogé le Code noir. » Journal Officiel de l’Assemblée nationale, QAG. ↩︎
- Déclaration de François Bayrou, Premier ministre, séance du 13 mai 2025 : « Si le Code noir n’a pas été aboli, il doit l’être, pour réconcilier la République avec son histoire. » Journal Officiel de l’Assemblée nationale, QAG. ↩︎
Sommaire
B.B. King, l’incarnation intemporelle du Blues
B.B. King, enfant du Mississippi et légende du Blues, a transcendé ses racines rurales pour devenir une icône mondiale. À travers ses collaborations audacieuses et son jeu unique, il a porté la voix du Blues sur toutes les scènes du monde, transformant chaque note en une émotion universelle. Retour sur l’itinéraire hors du commun du « King of the Blues ».
Né le 16 septembre 1925 dans le Mississippi rural, Riley B. King, plus tard connu sous le nom de B.B. King, incarne à lui seul l’ascension du Blues de ses racines modestes aux scènes internationales les plus prestigieuses.
Élevé dans l’univers rude des plantations du Sud, il grandit entre travail de la terre et chants gospel, avant de révolutionner la musique populaire au XXᵉ siècle.
Plus qu’un simple guitariste virtuose, B.B. King a su forger une esthétique unique, marquée par l’expressivité de son jeu et la profondeur émotionnelle de sa voix.
À travers ses collaborations, ses innovations et son insatiable curiosité musicale, il est devenu l’un des pères fondateurs du Blues moderne, influence majeure du rock, du jazz et de la soul.
I. Aux origines : Blues, église et premiers combats
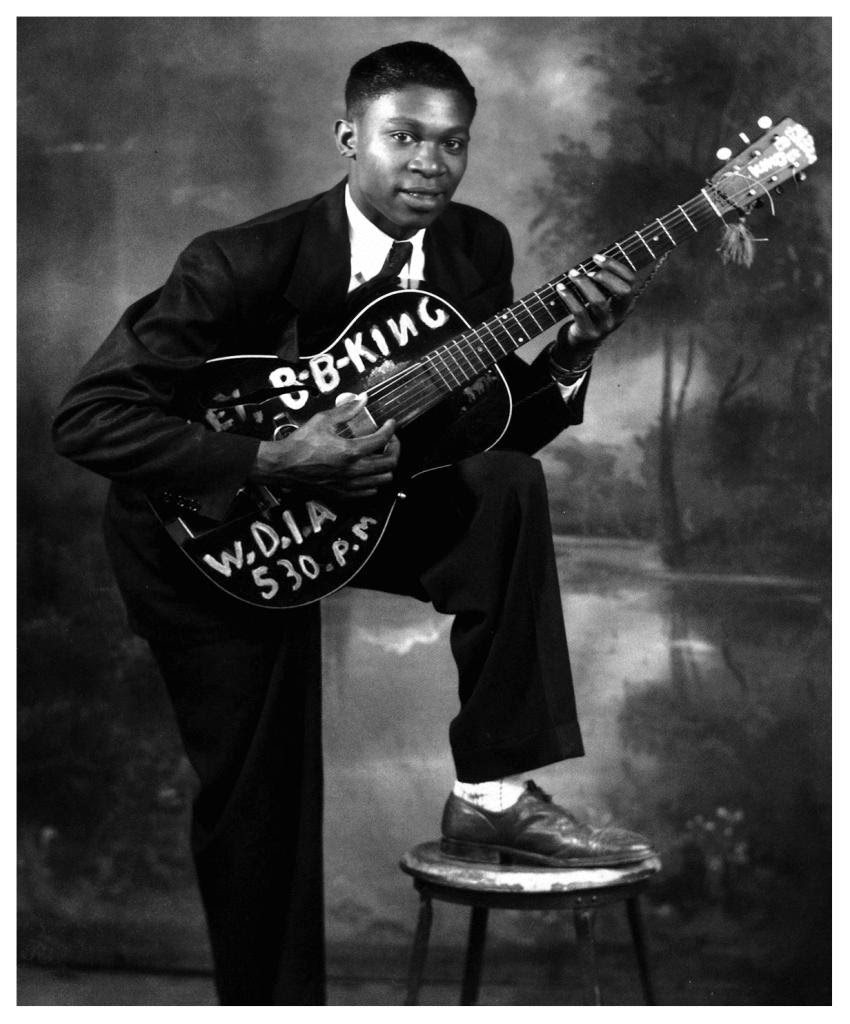
Un enfant du Sud rural
Né en 1925 à Itta Bena, dans le Delta du Mississippi, Riley B. King grandit dans une Amérique rurale marquée par la ségrégation raciale et la pauvreté extrême.
Orphelin de père dès son plus jeune âge, il est confié à sa grand-mère maternelle après le remariage et le décès prématuré de sa mère.
Comme beaucoup d’enfants noirs du Sud profond, son premier contact avec la musique se fait dans l’église baptiste de Kilmichael.
- Là, au sein des chœurs paroissiaux, il découvre la force spirituelle du gospel, où le chant collectif devient une forme d’expression et de résistance face aux injustices du quotidien.
- Ces premières expériences imprègnent profondément son style : mélange de ferveur religieuse, de plaintes douloureuses et d’espérance vibrante.
À douze ans, il obtient sa première guitare pour quelques dollars, souvent racontée comme un bien aussi précieux qu’un trésor familial.
- Il rejoint alors le Famous St John’s Quartet, avec lequel il parcourt les églises rurales et participe à des émissions de radios locales, pionniers dans la diffusion de la musique noire.
Pourtant, la musique reste secondaire : pour survivre, il travaille dur comme conducteur de tracteur dans les plantations, répétant l’expérience commune à des millions d’Afro-Américains piégés dans un système économique quasi féodal.
Memphis, le tremplin décisif

Dans les années 1940, Riley King décide de tenter sa chance à Memphis, alors en pleine effervescence artistique.
- Ville frontière entre les traditions rurales du Delta et les influences urbaines modernes, Memphis est un laboratoire vivant du Blues, du R&B et bientôt du Rock’n’Roll.
Grâce à ses talents vocaux et son charisme naturel, il décroche un poste à la radio WDIA, la première station américaine à programmer majoritairement des artistes afro-américains.
- Il anime une émission sponsorisée par un élixir local pour le public noir, « Pepticon« , dans un créneau intitulé « King’s Spot« .
- C’est au micro que naît son surnom : de Beale Street Blues Boy (en référence à la célèbre rue animée de Memphis) il devient rapidement B.B. King, pseudonyme qui ne le quittera plus.
À Memphis, B.B. découvre également le Blues électrique grâce à T-Bone Walker, guitariste innovant de la scène texane.
- T-Bone n’est pas seulement un technicien hors pair : il introduit la guitare amplifiée dans le Blues, transformant son impact émotionnel et sa portée sonore.
- Séduit, B.B. décide que la guitare électrique deviendra son instrument de prédilection, un prolongement de sa voix intérieure.
C’est dans cette période formatrice que Riley B. King forge les éléments fondamentaux de son identité musicale :
- L’intensité émotionnelle du gospel,
- La liberté d’improvisation du Blues,
- Et l’électrification expressive de la guitare moderne.
Ces bases jetées, la légende de B.B. King commence réellement à s’écrire.
II. L’ascension : du succès local à la reconnaissance mondiale
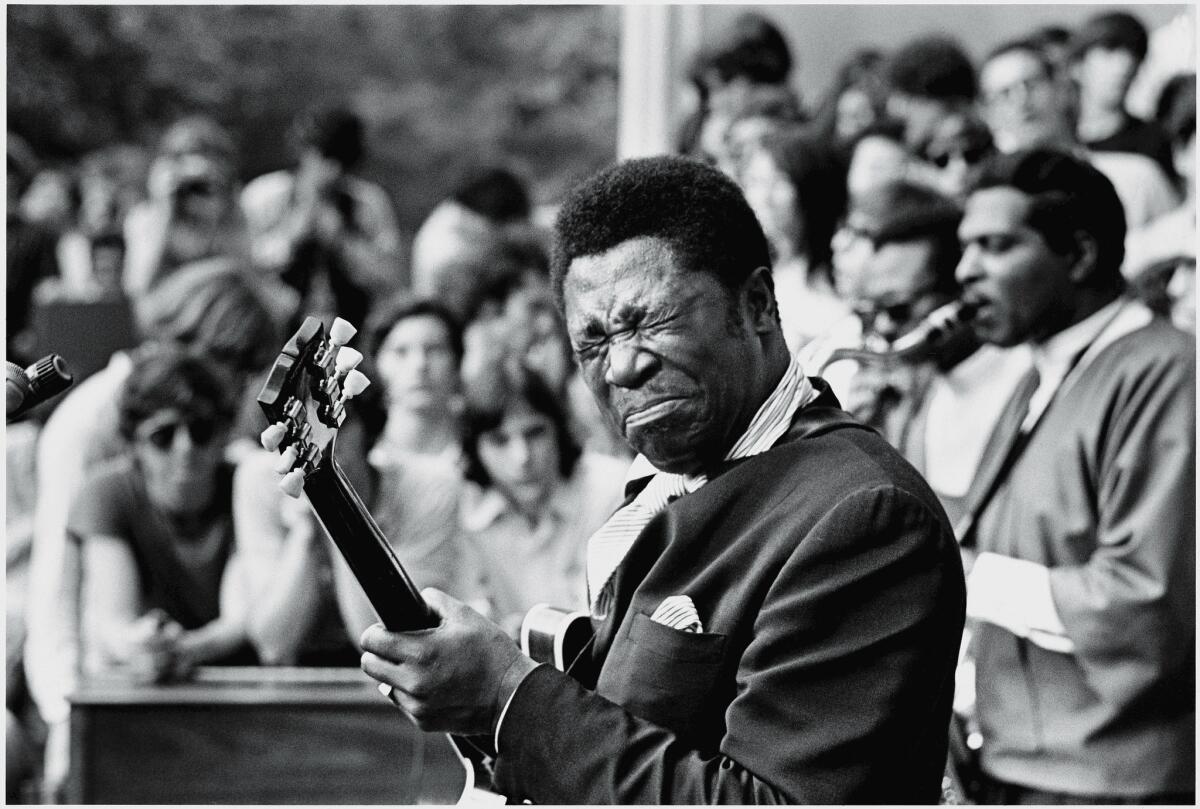
Premiers succès et structuration artistique
Malgré son talent évident, les débuts discographiques de B.B. King sont hésitants.
Repéré par Sam Phillips, futur fondateur du mythique label Sun Records, il commence à enregistrer au sein de petites compagnies locales comme Bullet Records puis RPM Records.
Ses premiers singles, bien que techniquement solides, peinent à percer un marché déjà saturé de talents dans le Sud des États-Unis.
Refusant de se laisser abattre, B.B. adopte une stratégie payante :
- Il monte un véritable orchestre de dix musiciens, une rareté pour un jeune bluesman.
- Ce big band est dirigé par Millard Lee, pianiste et arrangeur respecté, qui apporte rigueur et richesse harmonique aux prestations du groupe.
Cette combinaison entre le feeling brut du Delta Blues et la sophistication des arrangements de type jazz devient la marque de fabrique du « son B.B. King ».
Le tournant majeur arrive en 1952 avec « 3 O’Clock Blues« , un morceau enregistré dans des conditions rudimentaires à Memphis.
- Le titre, un blues lent et poignant, grimpe rapidement à la première place du Billboard R&B, où il reste pendant plusieurs semaines.
- Le succès est fulgurant : B.B. entame une tournée nationale, parcourant les clubs, les salles communautaires noires et les grandes scènes du circuit chitlin’ (le réseau des salles accueillant les artistes afro-américains sous la ségrégation).
Le Blues, encore perçu à l’époque comme un genre régional ou marginal, commence à conquérir les scènes populaires américaines.
B.B. King, par son style accessible, son charisme et son jeu de guitare novateur, s’impose comme l’un de ses plus brillants ambassadeurs.
L’affirmation d’une légende
En 1956, à l’apogée de son succès sur le marché afro-américain, B.B. King fonde son propre label, Blues Boys Kingdom, basé à Memphis.
- Cette initiative rare pour l’époque lui permet non seulement de produire ses propres titres, mais aussi de soutenir jeunes talents noirs, leur offrant une visibilité hors des circuits dominés par les maisons de disques blanches.
En parallèle, il signe un contrat de plus grande envergure avec ABC-Paramount Records, ce qui lui donne accès à des moyens de production plus importants et à un rayonnement national.
Le sommet de cette première période est atteint avec l’enregistrement, en 1964, de « Live at the Regal« , capté au Regal Theater de Chicago.
- Cet album, considéré comme l’un des plus grands enregistrements live de l’histoire du Blues, saisit toute l’énergie, l’émotion et l’interaction entre B.B. King et son public.
- Le jeu de guitare percussif, les solos vibrants, et la voix poignante du chanteur atteignent ici une perfection qui fera école pour les décennies suivantes.
À partir de la fin des années 1960, l’ouverture du Blues à un public blanc modifie profondément le paysage musical américain.
- Le British Blues Boom, porté par des groupes comme les Rolling Stones ou Cream, rend hommage aux pionniers afro-américains.
- Lors de leur tournée américaine en 1969, les Rolling Stones invitent B.B. King en première partie, lui permettant d’accéder aux plus grandes scènes et de toucher un nouveau public jeune, majoritairement blanc.
Dès lors, B.B. King transcende les barrières raciales et générationnelles, devenant l’icône universelle du Blues.
Son influence se fait sentir non seulement chez les musiciens de blues, mais aussi chez ceux du rock, du funk et même de la pop.
III. Héritages, collaborations et longévité

Réinvention constante
Contrairement à beaucoup d’artistes de sa génération, B.B. King refusa obstinément d’être enfermé dans une image nostalgique du Blues.
- Il comprit très tôt que pour assurer la survie du genre, il fallait savoir évoluer sans renier ses racines.
Dès les années 1970, il s’ouvre à des collaborations inattendues :
- Il joue aux côtés de rockeurs blancs comme Eric Clapton, Gary Moore, The Rolling Stones, participant à élargir le public du Blues hors du cercle afro-américain traditionnel.
- En 1988, son duo avec U2 sur le titre « When Love Comes to Town« introduit sa musique auprès d’une génération plus jeune, sensible aux ponts entre rock, pop et tradition blues.
B.B. King incarne une figure de transmission : il passe le relais tout en restant une autorité vivante.
- Lorsqu’il partage la scène avec Clapton sur l’album « Riding with the King« (2000), c’est à la fois une célébration du passé et un acte de renaissance du Blues.
Son style reste inimitable :
- Lucille, sa guitare fétiche (dont il a fait une véritable légende après un incendie de salle de danse), produit un son soyeux, où chaque note semble « chanter » plutôt que résonner.
- B.B. privilégie la pure expressivité à la virtuosité gratuite : ses bends caractéristiques, ses vibratos amples et sa retenue élégante font de chaque solo un écho émotionnel, presque vocal.
À cela s’ajoute sa voix chaude, grainée par l’âge, capable d’évoquer tour à tour la douleur, l’espoir ou la résignation, avec une sincérité rare.
Une icône honorée de son vivant
Conscient de son statut de légende vivante, B.B. King entreprend en 2006 une tournée d’adieux ambitieuse.
- Il commence au Royaume-Uni, puis poursuit en Suisse, au Brésil, et en France ; où il est fait citoyen d’honneur de Cognac lors du festival Blues Passion.
- En hommage, une rue est baptisée à son nom, signe d’un attachement profond entre le public français et ce géant du Blues.
Pourtant, fidèle à son âme de musicien nomade, B.B. King ne peut véritablement quitter la scène.
- Même diminué par le diabète (une maladie qui le ronge depuis vingt ans) il continue d’enchaîner les représentations, refusant de céder au déclin.
- Chaque concert devient un acte de transmission et de résistance, une preuve que le Blues est plus qu’un genre : c’est une manière d’être au monde.
Le 14 mai 2015, B.B. King s’éteint paisiblement à Las Vegas, à l’âge de 89 ans.
Son décès provoque une vague mondiale d’émotion, des fans anonymes aux plus grands artistes contemporains, tous saluant l’héritage colossal de cet homme qui avait su transformer la douleur d’un peuple en un langage musical universel.
B.B. King n’a pas simplement démocratisé le Blues :
- Il lui a donné un visage humain,
- Une profondeur émotionnelle inégalée,
- Et une dignité universelle qui continue d’inspirer toutes les générations.
Sources
- Wald, Elijah, Escaping the Delta: Robert Johnson and the Invention of the Blues, HarperCollins, 2004.
- Guralnick, Peter, Feel Like Going Home: Portraits in Blues and Rock ‘n’ Roll, Back Bay Books, 1999.
- Santelli, Robert, The Big Book of Blues: A Biographical Encyclopedia, Penguin, 2001.
Sommaire
13 mai 1888, la Loi d’or abolit l’esclavage au Brésil
Le 13 mai 1888, l’Empire du Brésil tournait officiellement une page sombre de son histoire en adoptant la Lei Áurea (« Loi d’or » en portugais), un décret radical abolissant l’esclavage sans condition. Mais derrière ce texte historique, une réalité complexe persiste encore aujourd’hui.
Steve Fogue, du succès fintech à l’immobilier d’avant-garde au Cameroun
Visionnaire et bâtisseur, Steve Fogue, ancien cofondateur de la fintech Particeep, dévoile à Douala la Tour Ciel Business Center, un hub d’affaires de 5 000 m² situé au carrefour Antenne Kotto. Plus qu’un immeuble, ce centre de nouvelle génération conjugue innovation, ancrage local et ouverture internationale, symbole d’une Afrique entrepreneuriale, souveraine et ambitieuse.
De Particeep à Fogiprom : le parcours d’un bâtisseur

À Douala, où il voit le jour en 1985, Steve Fogue comprend très tôt que l’avenir ne s’hérite pas, il se construit. Dans un contexte africain où les opportunités restent inégalement réparties, il grandit avec une double conviction : l’éducation comme clé d’émancipation, l’entrepreneuriat comme levier de transformation.
Après l’École des Ponts ParisTech, l’un des établissements d’ingénierie les plus prestigieux de France, il entame une carrière dans la finance classique, d’abord chez HSBC puis à la Société Générale. Il y affine sa maîtrise des marchés et des besoins structurels des entreprises. Mais l’envie d’innover et de créer son propre impact s’impose rapidement.
En 2013, il fonde Particeep, anticipant la digitalisation inéluctable des services financiers en France. La fintech s’impose comme un acteur clé, équipant de grands groupes (Crédit Agricole, Crédit du Nord, Nexity, Metlife, Wakam, Suravenir). Son modèle (modulaire, scalable, intégré sans rupture dans les systèmes existants) séduit et propulse l’entreprise parmi les plus prometteuses du secteur.
Avec une croissance annuelle de plus de 80 %, une rentabilité opérationnelle dépassant 200 % et une cinquantaine de collaborateurs, Particeep atteint sa maturité. En 2022, son rachat par Sopra Steria et Kereis consacre cette réussite et ouvre un nouveau cycle.
Mais pour Steve Fogue, le succès ne se résume pas aux parts de marché ou aux chiffres d’affaires. Il se mesure à l’impact laissé dans le temps et dans les territoires. Cet héritage, il choisit de l’ancrer en Afrique, et d’abord au Cameroun, son pays natal.
Dès 2017, il crée Fivenso, un fonds d’investissement privé qui amorce ses ambitions africaines. En 2022, il fonde Fogiprom, sa société de promotion immobilière, avec un objectif clair : développer des infrastructures modernes, élégantes, durables et adaptées aux besoins réels des entreprises et des populations urbaines.
Fogiprom n’est pas un promoteur comme les autres : c’est un laboratoire d’idées, qui conçoit l’immobilier comme un levier de développement territorial et de transformation économique. C’est dans cette logique qu’émerge la Tour Ciel, un hub d’affaires de nouvelle génération à Douala.
À travers ce projet, Steve Fogue incarne cette nouvelle génération de leaders issus de la diaspora : formés à l’international, mais profondément attachés à leurs racines. Pour lui, investir au Cameroun n’est pas un geste nostalgique, mais un choix stratégique. C’est un acte de foi dans la capacité du continent à bâtir ses propres modèles et à ériger ses propres symboles de réussite.
Tour Ciel : un centre d’affaires à visage humain

À première vue, c’est un immeuble. Mais à y regarder de plus près, la Tour Ciel est un manifeste : une nouvelle vision de l’entreprise et du vivre-ensemble professionnel. Érigée au carrefour Antenne Kotto, à proximité de la sous-préfecture du 5ᵉ arrondissement de Douala, cette structure de 5 000 m² n’est pas une simple construction, c’est une projection de la ville de demain.
La Tour Ciel s’élève sur huit étages, surmontés d’un rooftop panoramique, et dispose de deux niveaux de sous-sol pour un stationnement sécurisé. Dès le rez-de-chaussée, le ton est donné : une banque d’affaires, un espace d’accueil ouvert, des commerces connectés au quartier.
À l’intérieur, chaque mètre carré est pensé pour conjuguer flexibilité et performance :
- Bureaux privatifs et plateaux modulables de 40 à 350 m²
- Espaces commerciaux modernes
- Restaurants et rooftop lounge
- Coworking et bureaux partagés
- Salle de conférence high-tech et espaces événementiels
Plus qu’un bâtiment, la Tour Ciel est un écosystème urbain intégré. Un lieu où la productivité rencontre la convivialité, où l’économie se mêle à la culture, et où se dessine un mode de travail à la mesure des ambitions africaines du 21ᵉ siècle.
Un partenariat stratégique avec Regus, leader mondial du coworking
Dans sa volonté d’allier qualité, innovation et rayonnement international, Fogiprom a noué un partenariat stratégique avec Regus, leader mondial des espaces de travail flexibles. La Tour Ciel accueillera ainsi le tout premier centre Regus de dernière génération en Afrique centrale.
Installé sur deux niveaux (3ᵉ et 4ᵉ étages), ce centre de 1 300 m² proposera :
- des bureaux privatifs entièrement équipés,
- un espace de coworking moderne favorisant la collaboration,
- des salles de réunion connectées,
- des services de domiciliation professionnelle.
Ce partenariat inédit positionne la Tour Ciel comme une plateforme d’affaires de classe mondiale, au cœur d’une Afrique où les modes de travail évoluent rapidement : essor des start-ups, croissance des PME, recherche d’espaces hybrides et arrivée d’acteurs internationaux. Déjà implantés en Afrique du Sud, au Nigeria et au Kenya, les centres Regus ont contribué à la structuration de hubs économiques régionaux. Avec Douala, un nouveau chapitre s’ouvre, porté par un partenaire local visionnaire.
« Offrir un espace où se croisent efficacité professionnelle, élan créatif, instants de pause et services utiles : c’est la vision que nous portons », souligne Steve Fogue.
Côté technique, rien n’a été laissé au hasard. L’immeuble répond aux normes internationales de construction et intègre : climatisation centralisée, vidéosurveillance, détection incendie, fibre optique, groupe électrogène de secours et gestion intelligente de l’énergie. Avec ses vitrages réfléchissants, son isolation thermique et son éclairage LED, la Tour Ciel anticipe déjà les transitions énergétique et numérique de la région.
Mais au-delà de l’architecture, c’est une philosophie qui distingue la Tour Ciel. Elle refuse la froideur impersonnelle des tours occidentales. Elle valorise la lumière naturelle, le bois, les espaces de rencontre et les moments de convivialité. Elle s’adresse à des femmes et des hommes qui veulent travailler autrement : dans des conditions dignes, performantes et inspirantes.
La Tour Ciel n’est donc pas qu’un immeuble. C’est une déclaration d’intention. Le signal qu’en Afrique, les solutions n’ont pas besoin d’être importées : elles peuvent être pensées, conçues et bâties ici, par ses propres enfants, pour ses propres ambitions.
Une ambition locale portée par une vision globale

La Tour Ciel, solidement ancrée dans le sol de Kotto, regarde bien au-delà de l’horizon doualais. Elle incarne une idée forte : l’Afrique peut se bâtir avec ses propres ressources, ses talents et ses ambitions, tout en dialoguant d’égal à égal avec le reste du monde.
Ce projet emblématique repose sur une ingénierie financière audacieuse, reflet de l’expérience internationale de son concepteur. Fogiprom, société de promotion immobilière fondée par Steve Fogue, en assure la maîtrise d’ouvrage, de la conception architecturale au suivi du chantier. Derrière elle, Fivenso, fonds d’investissement stratégique également créé par Fogue, apporte les fonds propres initiaux, socle de crédibilité indispensable. Enfin, Afriland First Bank, première banque du Cameroun, complète le dispositif en jouant un rôle décisif dans la légitimation et le financement du projet.
Ce montage tripartite – diaspora, fonds privé, institution bancaire locale – est exemplaire. Il démontre que l’Afrique peut concevoir et financer des infrastructures majeures sans dépendre exclusivement de bailleurs étrangers.
Les impacts sont déjà visibles : architectes, ingénieurs, urbanistes et artisans camerounais mobilisés ; dizaines d’emplois créés ; économie de proximité redynamisée (commerces, services, transport). À terme, la Tour Ciel accueillera près de 850 professionnels, stimulant l’attractivité foncière et commerciale du quartier de Kotto-Bonamoussadi.
Au-delà des chiffres, c’est un modèle de gouvernance qui se dessine : un développement endogène, pensé par et pour les Africains, mais avec une exigence de standards mondiaux. C’est la signature de Steve Fogue : bâtir en Afrique, pour l’Afrique, avec les Africains.
La Tour Ciel n’est donc pas qu’un bâtiment intelligent. C’est une preuve de concept, peut-être le début d’un nouveau chapitre pour Douala et l’entrepreneuriat africain. En urbanisme, on parlerait d’amorceur de territoire : un édifice qui, par sa seule existence, stimule de nouvelles initiatives et redéfinit l’attractivité locale.
Le Cameroun, comme nombre de pays africains en pleine urbanisation, souffre d’un manque criant d’infrastructures professionnelles modernes. Les entreprises locales et étrangères peinent à trouver des espaces adaptés à leur croissance. C’est à ce vide que répond Steve Fogue :
« La Tour Ciel répond à un besoin essentiel : doter le Cameroun d’espaces d’affaires dignes de son ambition. »
En regroupant en un seul lieu bureaux, coworking, commerces, restauration, salles de conférence et espaces événementiels, la Tour Ciel crée un pôle attractif pour toutes les générations d’entrepreneurs : de la startup tech au bureau de représentation d’un groupe international. Sa configuration modulaire et sa programmation hybride favorisent rencontres, synergies et innovation.
Des workshops, séminaires, rencontres investisseurs-entrepreneurs ou lancements de produits s’y tiendront toute l’année. Le rooftop panoramique et la salle de conférence high-tech offriront des conditions optimales pour l’animation économique locale. Les jeunes pousses y croiseront des acteurs établis, dans une dynamique de mentorat, de réseautage stratégique et de croissance partagée.
En offrant une infrastructure professionnelle aux normes internationales, la Tour Ciel renforce l’attractivité de Douala auprès des entreprises en quête de siège régional en Afrique centrale. Elle place la capitale économique du Cameroun sur la carte des grands hubs africains, aux côtés d’Abidjan, Nairobi ou Johannesburg.
Et ce n’est qu’un début. Car la Tour Ciel n’est pas seulement un signal fort : c’est un prototype reproductible. Steve Fogue l’imagine comme le premier maillon d’une série de projets structurants, portés par les mêmes principes : innovation, durabilité et inclusion économique.
Un modèle pour l’Afrique qui innove
Steve Fogue ne se contente pas de bâtir des immeubles : il érige des ponts. Des passerelles entre les talents africains dispersés dans le monde et le continent qui les a vus naître. Avec la Tour Ciel, il incarne cette nouvelle génération d’entrepreneurs panafricains qui ne demandent plus la permission d’exister ; mais qui prennent place, construisent, innovent, en s’appuyant sur leur propre vision, leurs ressources et leur foi en l’avenir africain.
En mobilisant ses fonds propres via Fivenso et en s’associant à des partenaires locaux comme Afriland First Bank, Steve Fogue donne l’exemple d’un modèle afro-responsable de financement. Ici, pas de dépendance aux bailleurs internationaux, pas de projets sous tutelle : la Tour Ciel est née d’une alliance entre la diaspora et les compétences locales, prouvant que l’Afrique peut se financer elle-même lorsqu’elle croit en ses projets.
Ce type d’initiative revalorise le rôle stratégique de la diaspora africaine : non plus simple main-d’œuvre expatriée, mais investisseur lucide, porteur de projets structurants, acteur à part entière du développement continental.
« Il est temps que l’Afrique développe ses propres hubs d’affaires. Qu’on construise ici ce que d’autres cherchent ailleurs. »
Ce n’est pas qu’un slogan, mais un manifeste. L’Afrique a les idées, les talents, l’énergie démographique, la créativité et le génie entrepreneurial. Ce qui manquait souvent, c’étaient des lieux à la hauteur de cette ambition. La Tour Ciel arrive comme une réponse, presque comme une évidence.
Douala n’est pas une exception. De Dakar à Kigali, de Lagos à Nairobi, les métropoles africaines cherchent à structurer leurs écosystèmes d’affaires. En ce sens, la Tour Ciel n’est pas un point final : c’est un prototype reproductible. Un modèle qui repose sur trois piliers :
- Intégration des usages : un bâtiment où l’on peut travailler, réseauter, se former, se détendre.
- Ancrage local : chaque partie du projet, des matériaux à la main-d’œuvre, valorise les savoir-faire du territoire.
- Ambition globale : design contemporain, normes internationales, connectivité optimale. On ne bâtit plus pour rattraper un retard, mais pour inspirer l’avenir.
À travers cette démarche, Steve Fogue démontre que l’immobilier d’affaires peut devenir un levier d’autonomisation économique et un accélérateur de progrès. Le développement africain ne doit pas venir uniquement d’ailleurs : il peut, et doit, être porté par ceux qui aiment ce continent, y vivent ou y reviennent pour le bâtir de leurs mains.
La Tour Ciel, ce n’est pas seulement 5 000 m² de béton et de verre. C’est un appel à rêver grand, une preuve tangible que l’Afrique peut produire des infrastructures de classe mondiale, pensées par ses enfants pour répondre à ses propres besoins.
En élevant ce bâtiment, Steve Fogue élève aussi le regard que les Africains portent sur eux-mêmes. Il rappelle que l’ambition est un droit, que la modernité n’est pas réservée aux capitales occidentales, et que l’excellence peut (et doit) avoir un accent africain.
Sources :
- Fivenso (Interview Steve Fogué, 2023) fivenso.com
- Cameroon CEO cameroonceo.com
- Plaquette Tour Ciel – Fogiprom;
- Lebledparle – Douala Grand Mall lebledparle.com
- Cameroon Intelligence Report act.is
- Go Africa Online – coworking Douala goafricaonline.com
Blaise Diagne, entre fidélité républicaine et désillusion coloniale
Premier Africain noir élu député en France, Blaise Diagne porta les espoirs d’une égalité républicaine au cœur de l’Empire colonial. Son parcours, entre conquête politique et ambiguïté historique, questionne encore aujourd’hui la mémoire française face à ses promesses inachevées.
Le paradoxe Blaise Diagne
Sur l’île de Gorée, balayée par les vents atlantiques, un jeune garçon gravissait en 1884 les marches d’une modeste école de missionnaires. Son nom à la naissance, Galaye M’Baye Diagne, serait bientôt effacé, remplacé par un prénom catholique : Blaise. En cet instant, dans l’insouciance de l’enfance, il ignorait encore que son destin s’écrirait loin des rivages africains.
Plus tard, vêtu de son uniforme d’élève modèle, il recevrait à Saint-Louis un prix d’excellence sous le regard approbateur de ses maîtres coloniaux. Une distinction apparemment anodine, mais qui, dans une Afrique en voie de colonisation brutale, valait comme un premier pas vers l’inimaginable : siéger, en homme noir, au cœur du pouvoir blanc.
Blaise Diagne, premier député africain noir à la Chambre des députés française, symbole d’une ascension que la République prétendait ouverte mais réservait encore à quelques rares élus.
Que reste-t-il aujourd’hui de ces trajectoires hybrides ? De ces hommes qui, croyant en l’universalisme français, furent souvent piégés par l’ambivalence de l’Empire ? Que disent-ils du rêve d’assimilation, de la conquête des droits, mais aussi du prix du silence et de la mémoire fracturée ?
À travers la figure complexe de Blaise Diagne, c’est toute une interrogation sur la loyauté, la reconnaissance et l’effacement qui surgit ; une question qui, un siècle plus tard, continue de résonner.
D’une île coloniale aux bancs de la République



Né le 13 octobre 1872 sur l’île de Gorée1, escale historique de la traite négrière puis laboratoire de l’assimilation française, Galaye M’Baye Diagne (futur Blaise Diagne) grandit entre deux mondes. Celui des traditions africaines, portées par ses parents lébou et manjaque, et celui, insistant, de l’école coloniale, des missionnaires, de l’éducation française comme unique horizon de réussite.
Très tôt, son adoption par la famille métisse Crespin de Saint-Louis l’arrache au destin commun des fils de pêcheurs. Rebaptisé « Blaise » par les Frères de Ploërmel2, il reçoit une instruction méthodique, imprégnée de morale républicaine autant que de préjugés coloniaux. Le jeune Blaise excelle : il apprend à lire, à écrire, à manier la rhétorique avec une aisance rare. Lors des distributions de prix, son nom résonne en écho aux slogans civilisateurs de l’époque.
Boursier du gouvernement français, il quitte le Sénégal pour poursuivre ses études à Aix-en-Provence. Là, loin des regards bienveillants de Gorée, il découvre une autre facette de la République : celle qui, tout en prônant l’égalité universelle, relègue encore les corps noirs à la marge, dans les salles de classe comme dans les rues.
Fragilisé par des problèmes de santé, Diagne interrompt ses études et revient en Afrique. Mais il ne rentre pas dans l’anonymat : en 1891, il réussit brillamment le concours de fonctionnaire des douanes, une voie royale pour les rares Africains pouvant prétendre à des postes d’autorité dans l’administration coloniale.
Son premier poste le mène au Dahomey, puis au Congo français, à La Réunion et enfin à Madagascar. Partout, il applique avec rigueur les lois d’un Empire dont il entend démontrer que l’égalité de principe n’est pas une chimère. À travers son parcours, Blaise Diagne incarne ce rêve de fusion entre la France et ses colonies : un rêve sincère, mais déjà semé d’ambiguïtés.
Car être un « modèle d’assimilé3 » lui offre des promotions, mais l’isole aussi de ceux qui, en Afrique, commencent à dénoncer la brutalité du système colonial. L’histoire est en marche, et Diagne, lui, s’avance, persuadé encore qu’à l’intérieur même des institutions, un homme noir peut conquérir respect et influence.
Le fonctionnaire devenu voix politique



En 1914, au moment où l’Europe s’embrase, Blaise Diagne franchit un seuil historique. En remportant l’élection législative du Sénégal, il devient le premier Africain noir élu député à la Chambre française. Ce n’est pas une simple victoire personnelle ; c’est un événement politique majeur. Jusqu’ici, seuls quelques métis ou notables assimilés avaient accédé à des responsabilités publiques sous la République. Avec Diagne, c’est un Africain « pur sang », comme disaient certains avec condescendance, qui entre au Palais Bourbon.
Surnommé « la voix de l’Afrique », Blaise Diagne impose sa stature dans une Assemblée souvent réticente à voir siéger un homme noir parmi ses membres. Dès ses premiers discours, il revendique pour les habitants des « Quatre Communes » (Dakar, Gorée, Saint-Louis et Rufisque) une citoyenneté pleine et entière. Plus question d’un statut d’exception, plus question d’être Français « par intermittence » selon les nécessités coloniales.
En 1916, grâce à son habileté politique, Diagne obtient un succès majeur : la loi conférant la citoyenneté française aux habitants des Quatre Communes sans qu’ils soient contraints d’abandonner leur statut personnel traditionnel. C’est un compromis subtil entre l’assimilation républicaine et la reconnaissance des spécificités africaines ; et une victoire éclatante dans un contexte profondément racialisé.
Dans les travées de l’Assemblée, Diagne n’est pas un simple orateur ; il est un stratège. S’alliant aux républicains-socialistes, puis aux indépendants, il navigue avec pragmatisme parmi les groupes politiques, tout en s’appuyant sur la franc-maçonnerie, réseau discret mais efficace qui lui ouvre certaines portes que sa couleur de peau aurait sinon fermées.
Pourtant, derrière les applaudissements officiels, la méfiance persiste. Ses adversaires l’accusent tantôt d’être trop loyal envers Paris, tantôt de fomenter en sous-main des revendications indigènes. Diagne évolue dans un équilibre périlleux : il doit sans cesse prouver qu’il est « suffisamment Français » pour siéger, mais aussi « suffisamment Africain » pour parler au nom des siens.
À chaque session parlementaire, à chaque allocution, Blaise Diagne avance sur une corde raide tendue entre reconnaissance et instrumentalisation. Son élection, son action, son image publique : tout, déjà, porte en germe les ambiguïtés qui entoureront plus tard sa mémoire.
Blaise Diagne et les troupes noires
Lorsque la Première Guerre mondiale s’enlise dans la boue et le sang des tranchées, la France impériale se tourne vers ses colonies. Le besoin de soldats est criant. En 1918, Georges Clemenceau nomme Blaise Diagne Haut Commissaire chargé du recrutement indigène ; un poste inédit qui lui confère un pouvoir considérable… mais aussi une lourde responsabilité.
Dans les villes et les villages d’Afrique-Occidentale française, Diagne entame une tournée sans précédent. Par ses discours vibrants, il promet la citoyenneté, la reconnaissance, l’honneur de participer pleinement à la défense de la « mère-patrie ». Il persuade, négocie, parfois supplie. Les jeunes hommes, séduits par l’idée d’une égalité promise ou poussés par la pression sociale, s’engagent en masse. Sous son impulsion, plus de 63 000 soldats sont levés en AOF4 et 14 000 en Afrique-Équatoriale française.
Mais cette réussite est ambiguë. Derrière les proclamations de dignité, la réalité du front est brutale. Les tirailleurs sénégalais sont souvent envoyés en première ligne, exposés aux pires conditions climatiques et aux assauts meurtriers, dans une indifférence parfois cynique des états-majors. Diagne lui-même, depuis la tribune parlementaire, dénonce en 1917 l’inhumanité avec laquelle les troupes noires sont utilisées : « c’est à un véritable massacre, sans utilité, hélas, qu’ils ont été voués », déclare-t-il avec une émotion retenue.
Le succès du recrutement n’efface donc pas l’ambiguïté morale de sa mission. En échange du sang versé, Diagne arrache aux autorités françaises une loi historique : la reconnaissance définitive de la citoyenneté française pour les originaires des Quatre Communes. Une victoire juridique, certes, mais obtenue au prix d’un pacte douloureux où la loyauté politique et le sacrifice militaire sont inextricablement liés.
Pour beaucoup, Blaise Diagne incarne ainsi la figure du médiateur, de celui qui ouvre des droits tout en assumant le poids des contradictions coloniales. Il restera durablement marqué par ce rôle complexe : célébré par certains comme un libérateur, critiqué par d’autres comme un agent du compromis avec l’ordre impérial.
Le crépuscule d’une fidélité blessée




À mesure que les années passent, l’éclat de Blaise Diagne commence à ternir. Si sa carrière politique semble solide (maire de Dakar, député réélu sans discontinuer), le monde autour de lui change. L’Afrique coloniale bruisse de nouvelles voix, plus radicales, plus impatientes. Une génération de militants, souvent marxistes ou nationalistes, dénonce désormais l’assimilation comme un piège, et l’attachement de Diagne à la République française comme une trahison.
Ses anciens partisans africains lui reprochent son refus de remettre en cause l’ordre colonial. Pour eux, obtenir des droits dans le cadre impérial ne suffit plus ; c’est l’édifice même de la domination qu’il faut abattre. Dans ce contexte bouillonnant, Blaise Diagne apparaît de plus en plus comme un homme du passé : fidèle à une République qui proclame l’égalité tout en l’entravant, loyal à un idéal que l’histoire est en train de fracturer.
Sur le plan personnel, Diagne n’est pas épargné non plus. Usé par les combats parlementaires, affaibli par la maladie (une tuberculose contractée dans les frimas parisiens), il continue pourtant d’assumer ses fonctions, fidèle à l’idée que l’intégration dans la République française est possible et souhaitable.
En 1931, il accède brièvement au poste de sous-secrétaire d’État aux Colonies dans les gouvernements Laval, une première pour un Africain. Mais ce titre, prestigieux en apparence, ne masque pas la réalité : ses marges d’action sont étroites, son influence réelle limitée. Diagne est un pion symbolique plus qu’un véritable acteur des décisions coloniales.
Le 11 mai 1934, Blaise Diagne s’éteint à Cambo-les-Bains5. Peu après, son corps est rapatrié à Dakar, où la population lui rend un hommage sincère. Pourtant, dans l’histoire officielle française, sa mémoire commence déjà à s’effacer, ensevelie sous les récits triomphalistes de l’Empire, incapable de célébrer sans gêne un pionnier noir qui avait voulu croire à la parole républicaine.
Ainsi s’achève la trajectoire d’un homme qui aura toute sa vie marché sur une ligne de crête : entre fidélité aux idéaux et désillusion face aux réalités du pouvoir.
Mémoire divisée d’un pionnier africain

Après sa mort, Blaise Diagne entre dans une étrange postérité, écartelée entre célébration locale et effacement national. Au Sénégal, son nom survit dans la mémoire collective : avenues, lycées, aéroport portent l’empreinte de celui qui fut le premier Africain à siéger dans la République française. Des bustes, érigés sur son île natale de Gorée, rappellent sa singularité et son ascension fulgurante.
Mais en France, sa mémoire est plus trouble, presque embarrassée. Dans les récits officiels de la Troisième République, il est souvent relégué au statut de curiosité historique : un « exemple réussi » de l’assimilation, rapidement éclipsé par les grandes figures métropolitaines. Rarement reconnu comme acteur politique de premier plan, il demeure aux marges d’une histoire nationale qui peine à intégrer ses enfants d’outre-mer dans son récit fondateur.
Parmi les historiens et les militants anticoloniaux du XXᵉ siècle, le jugement est également nuancé, parfois sévère. Diagne est vu par certains comme un agent fidèle du système colonial, ayant troqué l’égalité théorique contre un silence pratique sur les réalités de l’oppression. Pour d’autres, il incarne au contraire la complexité de l’époque : un homme qui a cru sincèrement dans les promesses républicaines et qui a, autant que possible, arraché des victoires pour ses compatriotes.
Son héritage, profondément ambivalent, reflète ainsi les tensions de son temps : entre espoir d’intégration et constat d’exclusion, entre promotion individuelle et immobilisme structurel.
À travers Blaise Diagne, c’est toute la difficulté d’évaluer les figures pionnières qui se révèle : comment juger ceux qui ont ouvert des brèches dans un monde fondamentalement hostile, mais au prix, parfois, de compromis impossibles à ignorer ?
Aujourd’hui, à l’heure où la France interroge de plus en plus son passé colonial, la figure de Blaise Diagne invite non à un jugement hâtif, mais à une réflexion plus ample sur les promesses trahies, les luttes silencieuses et les mémoires recomposées.
Sources
- Dominique Chathuant, L’émergence d’une élite politique noire dans la France du premier 20ᵉ siècle ?, Vingtième Siècle. Revue d’Histoire, n°101, Presses de Sciences Po, 2009.
- Iba Der Thiam, La révolution de 1914 au Sénégal : l’élection de Blaise Diagne, L’Harmattan Sénégal, 2014.
- Bruno Fuligni, Le retour de Blaise Diagne, Humanisme, Grand Orient de France, n°304, 2014.
- Chantal Antier-Renaud, Les soldats des colonies dans la Première Guerre mondiale, Éditions Ouest-France, 2008.
- Roger Little, Du nouveau sur le procès Blaise Diagne – René Maran, Cahiers d’études africaines, n°237, 2020.
Notes
- L’île de Gorée, située au large de Dakar (Sénégal), fut un important comptoir colonial et centre de la traite négrière entre le XVe et le XIXe siècle. À partir du XIXe siècle, elle devint un symbole de la présence française en Afrique de l’Ouest. ↩︎
- Les Frères de Ploërmel, ou Frères de l’Instruction chrétienne de Ploërmel, sont un ordre religieux catholique fondé en 1824 en Bretagne, engagé dans l’éducation des jeunes garçons, notamment dans les colonies françaises où ils contribuèrent à l’expansion de l’enseignement occidental. ↩︎
- Dans le contexte colonial français, un « assimilé » désignait un indigène ayant adopté les normes juridiques, culturelles et politiques françaises, bénéficiant ainsi (théoriquement) de droits civiques comparables à ceux des citoyens métropolitains, sans toujours échapper aux discriminations raciales. ↩︎
- L’Afrique-Occidentale française (AOF) était une fédération de huit colonies françaises en Afrique subsaharienne, créée en 1895. Elle comprenait notamment le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Soudan français (Mali) et la Guinée, et fut dissoute en 1958 à la veille des indépendances africaines. ↩︎
- Cambo-les-Bains, petite commune thermale des Pyrénées-Atlantiques en France, était réputée au début du XXᵉ siècle pour ses établissements de soins contre les maladies respiratoires, notamment la tuberculose. ↩︎
Sommaire
Fritz Pollard, le coureur qui défia la couleur
Premier Afro-Américain entraîneur en NFL, Fritz Pollard fut un pionnier du sport professionnel et un bâtisseur de liberté face à la ségrégation. Derrière ses exploits, une trajectoire oubliée, qui questionne aujourd’hui notre rapport à la mémoire, à l’injustice, et aux figures effacées de l’histoire américaine.
Fritz Pollard, premier entraîneur noir : victoire oubliée, mémoire retrouvée


Le vent glacé fouette les visages dans un petit stade du Midwest. Sur la pelouse inégale, des cris fusent, une rumeur monte des gradins clairsemés. En cet automne 1920, un jeune homme noir, mince mais déterminé, serre le cuir contre sa poitrine et s’élance, esquivant les plaquages comme un poisson dans l’eau. Chacun de ses pas semble une provocation vivante face à une société qui le voudrait invisible. Ce joueur, c’est Fritz Pollard, premier Afro-Américain à dominer les terrains d’un sport encore balbutiant : le football professionnel.
À l’époque, son talent est une offense. Sa simple présence, un défi. Peu nombreux sont ceux qui imaginent que cet homme, souvent insulté, parfois frappé, deviendra quelques mois plus tard le premier entraîneur noir de la National Football League.
Que reste-t-il aujourd’hui des pionniers noirs du sport américain ? Que nous disent-ils de la ténacité, de l’effacement orchestré, de la lente et douloureuse conquête de la reconnaissance ? À travers le parcours fulgurant (et trop longtemps oublié) de Fritz Pollard, se dessine l’éternelle bataille pour inscrire sa propre histoire dans un livre que d’autres croyaient pouvoir écrire seuls.
D’un Chicago ségrégué aux terrains d’ivoire
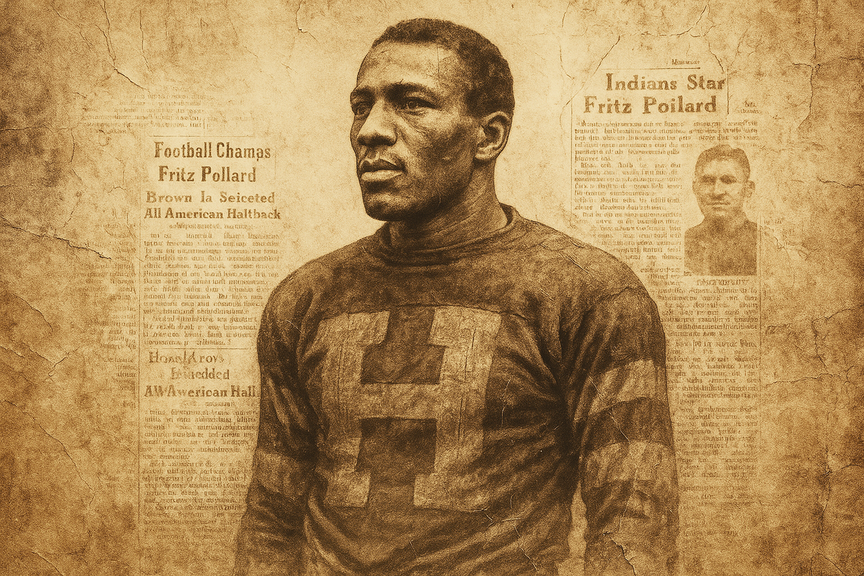
Né en 1894 dans un quartier populaire de Chicago, Fritz Pollard grandit dans une Amérique marquée par la ségrégation institutionnelle. Son père, John W. Pollard, ancien soldat de l’Union pendant la guerre de Sécession, incarne cette génération d’Afro-Américains pour qui la liberté était une conquête fragile, souvent trahie par la réalité sociale. La famille Pollard, modeste mais résiliente, transmet à Fritz une foi indéfectible dans le travail acharné et l’excellence.
À l’école secondaire de Lane Tech1, l’un des rares établissements publics de Chicago à accepter les élèves noirs, Fritz s’impose rapidement comme un athlète d’exception. Baseball, athlétisme, football : aucun sport ne lui résiste. Pourtant, derrière les succès, les humiliations sont constantes ; vestiaires refusés, regards méprisants, insultes anonymes venues des tribunes. Ce n’est pas seulement l’adversaire qu’il lui faut battre, mais un système tout entier.
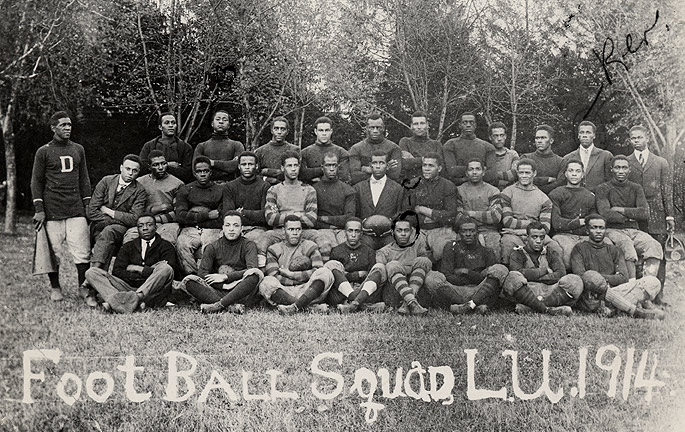
Son admission à Brown University2, prestigieuse Ivy League de la Nouvelle-Angleterre, relève presque de l’anomalie pour un jeune homme noir à cette époque. Il y étudie la chimie, mais c’est sur les terrains de football qu’il se fait un nom. En 1915 et 1916, il propulse les Brown Bears au sommet, participant notamment au mythique Rose Bowl. Sa rapidité, sa souplesse, sa capacité à déjouer les défenseurs médusent même les plus sceptiques. Walter Camp, le « père du football américain« , le décrit comme « l’un des plus grands coureurs que ces yeux aient jamais vu« .
En 1916, il devient le premier Afro-Américain à être nommé dans l’équipe All-America, la sélection des meilleurs joueurs universitaires du pays. Un honneur retentissant ; mais qui n’efface pas la réalité : lors des matchs, certaines équipes refusent de jouer contre Brown tant que Pollard est aligné. Parfois, il doit entrer sur le terrain escorté, sous les huées.
À chaque course, Fritz Pollard semble porter plus que le simple ballon : il emporte avec lui l’espoir d’une génération trop souvent reléguée aux marges. Sa traversée de l’Amérique blanche universitaire, s’il ouvre des brèches, révèle aussi l’étendue du chemin qu’il reste à parcourir.
Le joueur devenu stratège
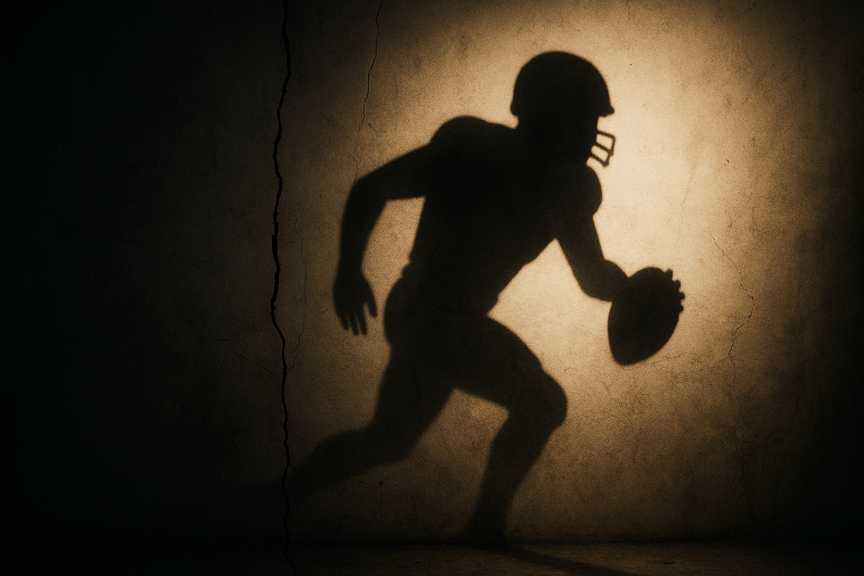
À la sortie de Brown University, alors que la Première Guerre mondiale ébranle encore le monde, Fritz Pollard entre dans un football professionnel à peine balbutiant ; et presque exclusivement blanc. En 1920, il rejoint les Akron Pros3, dans ce qui deviendra bientôt la National Football League (NFL). Il n’est pas seulement un joueur d’exception ; il est une anomalie vivante dans un championnat régi par les codes non écrits de la ségrégation.
À Akron, Pollard électrise le public. Rapide, imprévisible, il semble danser sur la pelouse, échappant aux défenseurs comme une ombre. Lors de la saison inaugurale, il conduit son équipe à la conquête du tout premier titre de l’histoire de la ligue. Ce triomphe aurait pu suffire à graver son nom dans le marbre. Mais dans l’Amérique des années 1920, les victoires d’un homme noir ne se célèbrent qu’à demi-mot.
L’année suivante, en 1921, Pollard brise une autre barrière : il devient le premier Afro-Américain entraîneur-chef d’une équipe professionnelle de football, les Akron Pros. Son double statut (joueur et coach) déstabilise un milieu qui le tolère sur le terrain mais rechigne à lui accorder une quelconque autorité. Certains de ses propres joueurs refusent de prendre leurs ordres d’un « colored », obligeant Pollard à diriger depuis les coulisses, souvent sans reconnaissance officielle.
Sa carrière professionnelle l’emmène ensuite dans diverses équipes : Milwaukee Badgers, Hammond Pros, Providence Steam Rollers… Partout, il doit conjuguer exploits sportifs et humiliations quotidiennes. À Milwaukee, il joue aux côtés de Paul Robeson, autre géant noir de son époque, dans des matches mythiques contre Jim Thorpe et son équipe des Oorang Indians. Mais la pression monte : en coulisse, les propriétaires blancs commencent à s’entendre pour « nettoyer » la ligue de ses joueurs noirs.
En 1926, sous une pression à peine dissimulée, la NFL ferme officieusement ses portes aux Afro-Américains. Pollard, ses compagnons noirs et leurs rêves sont brutalement écartés, sans déclaration officielle ni regret apparent.
Loin de s’effondrer, Fritz Pollard choisit une autre voie : celle de la création. Plutôt que de disparaître, il s’apprête à construire, à inventer de nouveaux terrains de jeu pour ceux qu’on refuse d’admettre.
L’expérience des Brown Bombers


Privé de ligue officielle, mais pas d’ambition, Fritz Pollard refuse de se laisser effacer. Dans l’Amérique des années 1930, en pleine Dépression, il se réinvente en bâtisseur. Il crée plusieurs équipes indépendantes composées exclusivement de joueurs afro-américains, défiant l’ordre racial établi par les circuits sportifs dominants.
La plus célèbre de ces équipes sera les Brown Bombers, fondée à New York. Ce nom n’est pas anodin : il évoque l’élan irrésistible, la force imprévisible, la fierté noire incarnée à la même époque par le boxeur Joe Louis, surnommé lui aussi « le Brown Bomber ». À travers ses équipes, Pollard offre bien plus que des matches de football : il construit des espaces d’affirmation, des lieux où les talents noirs peuvent s’exprimer pleinement, loin du mépris et de l’humiliation des ligues blanches.
Sous sa direction, les Brown Bombers sillonnent le pays, affrontant d’autres équipes noires, parfois aussi des équipes blanches prêtes à risquer l’affrontement. Les tournées sont éreintantes, les routes dangereuses : il faut contourner les hôtels qui refusent les joueurs noirs, improviser des vestiaires dans des entrepôts, jouer devant des publics parfois hostiles. Mais sur le terrain, Pollard et ses hommes livrent un spectacle inégalé, rappelant à chaque touchdown que la ségrégation n’éteint ni le talent ni la fierté.
L’expérience est éphémère : la Grande Dépression4, puis les bouleversements de la Seconde Guerre mondiale, fragilisent les ligues indépendantes. Mais l’initiative de Pollard laisse une empreinte : celle d’un refus radical de disparaître, celle d’une affirmation collective que l’exclusion ne saurait condamner à l’invisibilité.
Dans une Amérique qui peine à intégrer ses minorités dans l’imaginaire national, Fritz Pollard invente, bien avant l’heure, une autre manière d’exister dans l’espace public : par l’excellence, par la création autonome, et par la mémoire du combat.
Le crépuscule d’une étoile noire
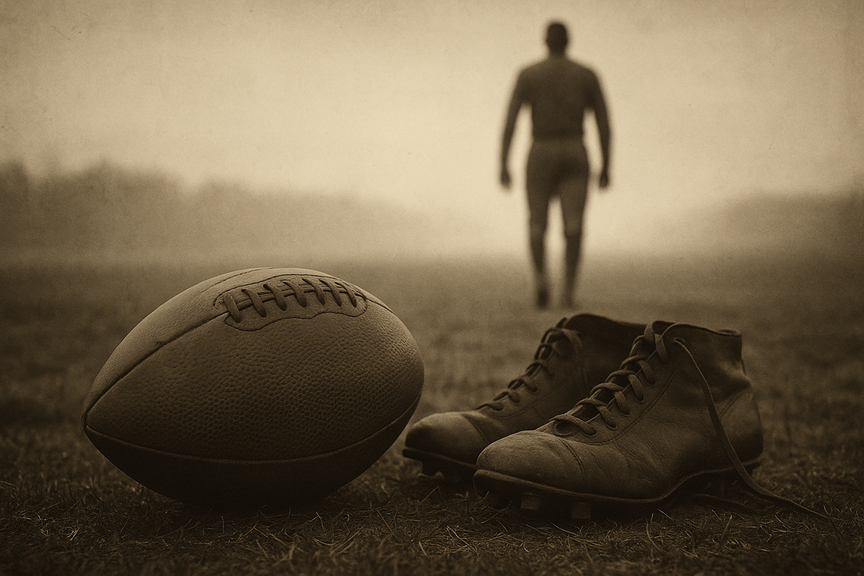
À mesure que les années passent, les projecteurs se détournent de Fritz Pollard. La NFL, de plus en plus institutionnalisée, persiste dans son exclusion officieuse des joueurs noirs, et les équipes indépendantes, déjà fragiles, succombent sous le poids de la crise économique. Le terrain qui avait été son royaume se dérobe sous ses pas. Pourtant, Pollard refuse de se laisser réduire au silence.
Dans les années 1930, il se lance dans d’autres aventures, portant toujours la même ambition : exister par la création. À New York, il fonde le New York Independent News, l’un des premiers tabloïds afro-américains de la ville. Dans ses colonnes, il dénonce sans détour les discriminations raciales, défend les droits civiques, et offre une voix aux laissés-pour-compte. À son apogée, le journal atteint près de 35 000 exemplaires hebdomadaires, un chiffre impressionnant pour un média noir dans une Amérique encore fracturée.
Parallèlement, Pollard diversifie ses activités : agent artistique, conseiller fiscal, producteur de musique et de cinéma ; il produit même Rockin’ the Blues en 1956, réunissant sur scène quelques-unes des figures montantes du rhythm and blues. Toujours, l’idée reste la même : créer des espaces où l’expression noire est libre et valorisée.
Mais derrière ces réussites discrètes, un constat s’impose : dans le grand récit national, Fritz Pollard disparaît peu à peu. Les nouvelles générations de sportifs ignorent son nom. L’institution NFL, qu’il avait contribué à bâtir, ne célèbre pas son héritage. Son exclusion n’a pas été réparée ; elle a été naturalisée, comme tant d’autres silences de l’histoire.
À sa mort en 1986, Fritz Pollard laisse derrière lui l’empreinte d’une étoile brillante mais obscurcie, un destin exemplaire mais trop souvent éclipsé par la mémoire officielle.
Sources
- John M. Carroll, Fritz Pollard: Pioneer in Racial Advancement, University of Illinois Press, 1998.
- David Maraniss, Path Lit by Lightning: The Life of Jim Thorpe, Simon & Schuster, 2022. (Pour le contexte NFL et le traitement des joueurs racisés).
- Charles K. Ross, Outside the Lines: African Americans and the Integration of the National Football League, New York University Press, 1999.
- Alan M. Klein, Growing the Game: The Globalization of Major League Baseball, Yale University Press, 2006. (Pour des éléments comparatifs sur la mémoire raciale dans le sport américain).
- Patrick B. Miller et David K. Wiggins (dir.), Sport and the Color Line: Black Athletes and Race Relations in Twentieth-Century America, Routledge, 2004.
- William C. Rhoden, Forty Million Dollar Slaves: The Rise, Fall, and Redemption of the Black Athlete, Crown Publishing Group, 2006.
- Archives de la Pro Football Hall of Fame (dossier officiel sur Fritz Pollard).
- Brown University Archives (biographie officielle de Fritz Pollard).
Notes
- Lane Tech (Lane Technical College Prep High School), fondé en 1908 à Chicago, est l’un des plus grands lycées publics des États-Unis. Il a été l’un des premiers à offrir des cursus techniques aux élèves afro-américains à une époque de forte ségrégation raciale. ↩︎
- Brown University, fondée en 1764 à Providence (Rhode Island), est l’une des plus anciennes universités des États-Unis. Membre de la Ivy League, elle se distingue dès le XIXᵉ siècle par une certaine ouverture à la diversité, bien que des discriminations subsistaient dans ses pratiques sociales et sportives. ↩︎
- Les Akron Pros furent l’une des équipes fondatrices de la American Professional Football Association (APFA), devenue la NFL. Basés à Akron (Ohio), ils remportèrent le tout premier championnat professionnel en 1920, avec Fritz Pollard parmi leurs figures de proue. ↩︎
- La Grande Dépression, déclenchée par le krach boursier de 1929, provoqua une crise économique mondiale majeure. Aux États-Unis, elle entraîna la faillite de nombreuses entreprises, l’effondrement de ligues sportives indépendantes, et renforça les inégalités raciales dans les opportunités économiques et culturelles. ↩︎
Sommaire
Kanye West, Heil Hitler et l’hypocrisie culturelle des plateformes
Kanye West, Heil Hitler et l’hypocrisie des plateformes : quand la violence noire est promue, mais que la mémoire occidentale reste intouchable.
Le mal qu’on choisit de voir
Le 8 mai 2025, un son fend le vacarme numérique : Kanye West publie Heil Hitler, un morceau aussi brutal qu’inadmissible, où l’artiste américain revendique son allégeance à l’un des pires régimes de l’histoire humaine.
Dans un réflexe presque automatique, toutes les grandes plateformes bannissent le titre.
Scandale. Bannissement. Communiqués indignés.
La machine morale semble fonctionner.
Mais alors, pourquoi continue-t-on, jour après jour, à inonder ces mêmes plateformes de chansons qui glorifient la violence, l’hypercriminalité, la haine de soi, la misogynie la plus crue ?
Pourquoi un « Heil Hitler » choque ; mais pas « Shoot him in the face« , « Pimp the bitches » ou « Kill ’em all » ?
Dans cet écart, dans cette hypocrisie feutrée, c’est toute une société du divertissement que l’on voit se dévoiler ; cynique, sélective, et complice.
Heil Hitler : trop explicite pour être consommable

Dès sa sortie, Heil Hitler est banni de YouTube, SoundCloud, Spotify, Deezer.
La chanson, portée par un beat orchestral martial, expose sans filtre une fascination grotesque pour Adolf Hitler, jusqu’à intégrer un extrait vocal authentique du dictateur.
Les réactions ne se font pas attendre :
- Organisations juives dénonçant un acte d’antisémitisme décomplexé,
- Médias généralistes relayant l’indignation,
- Fans tentant maladroitement de défendre « un geste artistique provocateur ».
Mais ce bannissement, s’il est compréhensible, révèle surtout une mécanique bien huilée :
- Lorsqu’une œuvre choque les sensibilités dominantes (ici, l’Occident blanc, juif ou progressiste), elle est jugée « intolérable ».
- En revanche, lorsqu’une œuvre piétine des populations déjà marginalisées (Noirs, femmes pauvres, jeunes des ghettos) elle est digérée, normalisée, marchandisée.
Quand la violence noire devient un produit de consommation

Il suffit d’ouvrir une application musicale pour le constater :
Chaque semaine, les tops charts sont inondés de morceaux glorifiant :
- Meurtres gratuits,
- Violences armées,
- Dégradations sexuelles,
- Narcotrafic érigé en modèle économique.
Les textes pullulent :
« Shoot the ops », « F** your bitch »*, « Die slow », « Count the bodies »…
Aucune plateforme n’interdit.
Aucun boycott institutionnel.
Pas de communiqués enflammés de CEOs indignés.
Pourquoi ?
Parce que ces violences sont devenues acceptables ; à condition qu’elles soient dirigées contre les « leurs ».
À condition qu’elles confortent l’idée inconsciente que la misère noire est un spectacle naturel, divertissant, profitable.
L’économie du racisme est plus rentable que sa condamnation

Heil Hitler choque car il expose frontalement une horreur inassimilable pour l’Occident : le nazisme.
Mais les dizaines de milliers de chansons de rap mainstream qui célèbrent le meurtre de jeunes Noirs ? Elles ne choquent pas. Elles font vendre.
Car les plateformes vivent d’algorithmes d’engagement.
Et rien n’engage mieux qu’une musique brutale, pulsatile, virale.
Chaque clic sur une chanson de drill sanglante ou de trap nihiliste rapporte des dollars.
Ainsi, l’industrie ne fait pas vraiment la promotion de la « culture noire » :
elle promeut une culture de la mort noire.
Tant que la violence reste codifiée, racialisée, et commodifiée, elle est parfaitement digérable par le marché.
Kanye a simplement franchi la frontière invisible : il a insulté un tabou qui n’était pas « vendable ».
Hypocrisies contemporaines : le crime accepté, l’idéologie refusée

Interdire Heil Hitler est un geste nécessaire.
Mais il est aussi insuffisant ; et hypocrite.
Car quelle est la différence morale entre glorifier l’assassinat d’un jeune Noir pour un quartier, et chanter la suprématie aryenne ?
Dans les deux cas, la pulsion de mort est honorée, esthétisée, mise en boucle.
La différence n’est pas éthique.
Elle est politique.
La haine antisémite choque une société occidentale marquée par la Shoah, inscrite dans ses lois, son éducation, sa conscience collective.
La haine intra-noire, elle, n’engage aucune culpabilité collective massive.
Elle est même attendue, désirée, recyclée.
Voilà la vérité crue : certaines morts choquent parce qu’elles résonnent dans la mémoire de ceux qui détiennent le pouvoir culturel ; d’autres sont ignorées car elles n’entament pas l’édifice du confort.
Se souvenir de ce qu’on tolère
Le scandale Heil Hitler n’est pas seulement celui de Kanye West.
C’est celui d’une industrie qui, chaque jour, fait mine de protéger la dignité humaine, tout en vendant la déchéance des siens.
C’est celui d’une société qui sait réagir à l’inacceptable… mais choisit soigneusement ce qu’elle juge inacceptable.
Et pendant que l’on supprime un morceau pour éviter la gêne diplomatique,
on laisse en playlist continue la bande-son de la mort lente de quartiers entiers.
La question n’est pas de savoir pourquoi Kanye a été banni.
Elle est de savoir pourquoi tant d’autres continuent d’être promus.
Sommaire
10 mai : L’obligation de la mémoire
Le 10 mai, Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions, rappelle l’importance de la mémoire et de la reconnaissance.
Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions
Une mémoire devenue loi

Au début des années 2000, la loi Taubira reconnaissant la traite et l’esclavage comme crimes contre l’humanité relance un débat brûlant : où placer la frontière entre histoire scientifique et mémoire militante ?
Le 10 mai 2001, le Parlement adopte définitivement la loi portée par Christiane Taubira. L’ancien intitulé (« journée commémorative du souvenir de l’esclavage et de son abolition ») devient, en 2006, la Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions.
Consacrée à la « réflexion civique sur le respect de la dignité humaine et la notion de crime contre l’humanité », cette journée vise toutes les mémoires : noires, antillaises, ultramarines, africaines. Un devoir de reconnaissance devenu outil de cohésion nationale.
Entre légitimité et controverses

Pourtant, depuis sa création, cette mémoire officielle suscite des critiques.
Certains redoutent qu’en érigeant la mémoire en obligation légale, l’État n’impose une lecture unique de l’histoire. En 2004, l’historien spécialiste de l’esclavage Olivier Grenouilleau publie Les Traites négrières : essai d’histoire globale. Il y défend l’idée que la traite transatlantique ne doit pas être isolée des autres formes d’esclavages. Lors d’une interview en 2005, il affirme :
« La traite musulmane n’a pas été menée au nom d’un racisme. »
Cette déclaration provoque un tollé. Accusé de relativiser la traite arabo-musulmane par rapport à la traite occidentale, Grenouilleau fait l’objet d’une plainte pour contestation de crime contre l’humanité ; plainte finalement classée sans suite.
La même année, dix-neuf historiens, dont Pierre Vidal-Naquet, lancent la pétition Liberté pour l’histoire, dénonçant ce qu’ils perçoivent comme une menace contre la liberté de la recherche historique. Sous la houlette de Pierre Nora, Liberté pour l’histoire devient un collectif luttant contre ce qu’ils appellent « la criminalisation du passé ».
Universalisme républicain ou négation des discriminations ?
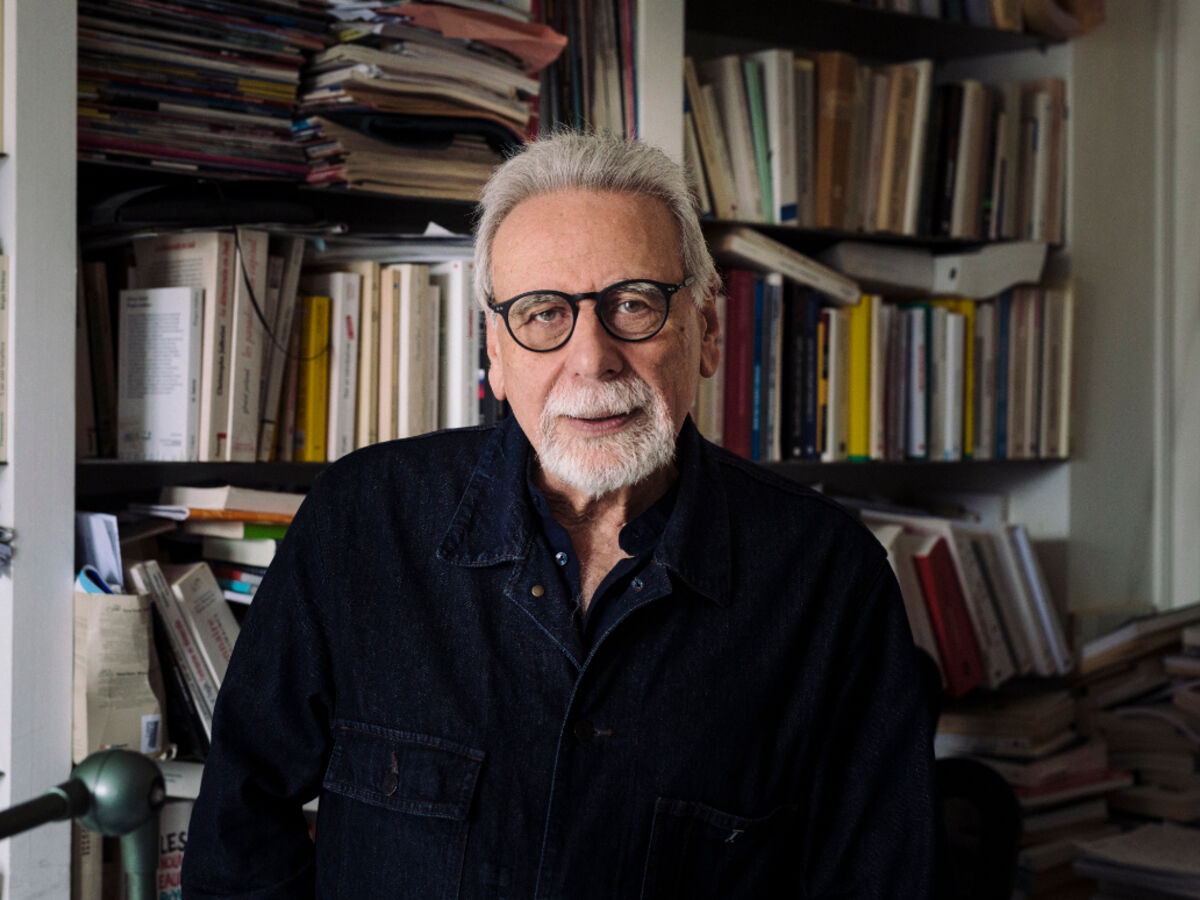
En 2023, la revue Hérodote.net soutient que la loi Taubira « rate l’occasion de réunir les Français autour de leur histoire commune », réaffirmant la doctrine de l’universalisme républicain née de la Révolution française :
liberté, égalité, fraternité… mais sans distinctions identitaires.
Or, cette idéologie est de plus en plus critiquée. Pour le politologue Alain Policar, l’universalisme républicain contribue à l’« occultation de l’Histoire », en ignorant les discriminations héritées de la colonisation et de l’esclavage.
Dans Dialogue transatlantique (2021), Djamila Ribeiro et Nadia Yala Kisukidi interrogent la difficulté de valoriser les identités sans fragmenter la société. Pour Kisukidi, une mémoire nationale commune n’est possible qu’en intégrant les récits minoritaires.
Ribeiro va plus loin :
« C’est l’absence de reconnaissance qui divise, pas sa présence. »
Reconnaître pour avancer
En France, la cohésion sociale passe par l’acceptation assumée du multiculturalisme. Pour les descendants des populations asservies ou colonisées, l’histoire n’est pas un détail : c’est un fondement identitaire.
Demander aux Antilles, à la Guyane, à La Réunion ou aux diasporas africaines de « tourner la page » serait nier l’impact encore actuel de la traite, de l’esclavage et du colonialisme.
La loi Gayssot (1990) a posé un jalon en criminalisant le négationnisme, c’est-à-dire toute tentative de nier les crimes contre l’humanité. Cette loi protège la mémoire de la Shoah, mais son principe s’étend aux autres crimes historiques majeurs.
Amnesty International rappelle que les crimes contre l’humanité heurtent la conscience de l’humanité entière ; un cadre moral et juridique que l’ONU a consacré en 1948.
La mémoire comme acte politique
Pourtant, certains continuent de minimiser l’impact moral et historique de l’esclavage. En 2008, Pierre Nora publie une tribune dans Le Monde affirmant que :
« La notion de crime contre l’humanité ne saurait s’appliquer rétroactivement. »
Cette déclaration choque. Trente-et-une personnalités, dont Serge Klarsfeld et Claude Lanzmann, signent une lettre ouverte intitulée Ne mélangeons pas tout, rappelant l’importance de reconnaître pleinement la gravité de l’esclavage comme crime contre l’humanité.
En 2017, l’historien Pierre Serna publiera à son tour une tribune claire :
« L’esclavage était bien un crime contre l’humanité. »
25 ans de la loi Taubira : un nouveau cycle de mémoire

À l’approche du 25ᵉ anniversaire de la loi, la réflexion sur sa portée est relancée.
Dominique Taffin, directrice de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, souligne que la loi a brisé un silence ancien :
« Elle a permis une reconnaissance officielle des souffrances des populations ultramarines et a eu un impact sur l’éducation, avec de nouveaux programmes scolaires, musées et mémoriaux. »
Parmi ces initiatives : le Mémorial ACTe en Guadeloupe, ou encore le Comité national pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage (CNMHE).
Transmettre, encore et toujours
Le 10 mai demeure un appel : continuer à enseigner, à reconnaître, à transmettre.
Comme l’indique la plateforme publique Lumni :
« Il faut réconcilier nos divisions autour d’une mémoire commune. »
Mais cette mémoire ne saurait être authentique si certains citoyens, descendants des esclaves ou des colonisés, n’y trouvent pas leur juste place.
Samuel Légitimus, journaliste et metteur en scène, le formule ainsi :
« L’image de la France est prisonnière de son histoire. Il faut l’aider à évoluer. »
Les prochaines grandes étapes (notamment le mémorial prévu pour 2026 et la journée du 23 mai dédiée aux victimes de l’esclavage) marquent une dynamique nouvelle.
Car la mémoire ne saurait être figée : elle est un socle vivant, un levier pour penser l’avenir.
Sommaire
Andrés Aguiar, le lieutenant noir de Garibaldi (héros oublié du Risorgimento)
À Montevideo, il était né sans nom. À Rome, il est mort en héros. Andrés Aguiar, esclave affranchi devenu lieutenant de Garibaldi, a traversé deux continents et deux révolutions. Mais il fallut plus d’un siècle pour que son nom ressurgisse enfin des marges de l’Histoire.
Montevideo, 1810 : Naissance dans les chaînes

Dans les ruelles poussiéreuses de Montevideo du début du XIXe siècle, une ville portuaire tiraillée entre ambitions impériales et luttes naissantes pour l’indépendance, naît un enfant noir, fruit du système esclavagiste qui structure alors toute l’Amérique latine. Andrés Aguiar, comme tant d’autres, vient au monde dans une condition d’infériorité imposée : celle d’un bien meuble, propriété d’autrui. Son nom, hérité non pas de ses ancêtres mais de son maître présumé (le général uruguayen Félix Eduardo Aguiar), est déjà un indice de cette dépossession première, de cette identité volée par l’Histoire.
On sait peu de chose des premières années d’Aguiar. Les archives sont silencieuses sur les existences que l’on jugeait sans importance. Mais à travers les bribes conservées par les historiens, émerge l’image d’un jeune homme robuste, agile, excellent dompteur de chevaux ; un savoir ancestral hérité des communautés africaines et créoles de la campagne orientale. À une époque où l’aptitude à manier le cheval pouvait faire la différence entre la servitude et la survie, Aguiar se taille une réputation de cavalier émérite, respecté y compris dans les rangs militaires.
Mais l’essentiel de sa trajectoire va se jouer dans le fracas des armes et les turbulences de la Guerra Grande (1838–1851)1, un conflit brutal entre les partisans du gouvernement de Montevideo et les forces fédéralistes soutenues par l’Argentine de Juan Manuel de Rosas. C’est dans ce contexte que la liberté lui est sans doute accordée ; non comme un droit, mais comme une stratégie de guerre. En 1842, les deux camps proclament l’émancipation des esclaves dans l’espoir de renforcer leurs effectifs. Près de 5 000 hommes sont ainsi affranchis pour servir la patrie… ou du moins, les ambitions de leurs chefs.
Libéré de ses chaînes mais pas encore maître de son destin, Aguiar se lie au destin d’un autre paria : Giuseppe Garibaldi2, aventurier italien exilé sur les rives du Río de la Plata, porteur d’un idéal républicain et universaliste encore balbutiant. Garibaldi, alors commandant de la Légion italienne3, attire autour de lui une cohorte bigarrée de combattants : des exilés européens, des gauchos, des noirs affranchis. Andrés Aguiar s’engage à ses côtés ; un geste qui, pour lui, relève autant de la survie que de la foi dans une idée nouvelle : celle que les armes peuvent ouvrir la voie à la liberté.
Garibaldi, dans ses mémoires, parlera de ces hommes avec une admiration peu commune pour l’époque. Il décrit Aguiar comme un compagnon de confiance, loyal, calme, courageux, doué d’un sang-froid exceptionnel. À ses yeux, cet ancien esclave n’est pas un simple soldat : c’est une figure, un symbole, une incarnation vivante de l’idéal de libération pour lequel il se bat.
C’est donc en Uruguay que naît non seulement le soldat Aguiar, mais aussi le mythe ; celui d’un homme qui, ayant tout perdu à la naissance, va peu à peu gagner ce que la République elle-même promettait à chacun : l’honneur, la reconnaissance, et le droit de mourir debout.
L’Uruguay en guerre ou le baptême du feu

Au cœur des années 1840, l’Uruguay est un champ de bataille permanent. Montevideo, encerclée depuis des années par les troupes de Manuel Oribe (allié du dictateur argentin Rosas) résiste avec l’énergie du désespoir. Dans ses rues pavées, une armée hétéroclite, surnommée le « gouvernement de la Défense », se bat pour sa survie. À leurs côtés, les étrangers affluent, non par appât du gain, mais mus par des idéaux ou poussés par l’exil. C’est dans ce creuset que la Légion italienne de Garibaldi prend les armes.
La Légion, loin d’être une force professionnelle, rassemble une fraternité d’hommes aux parcours brisés : artisans, marins, poètes, fugitifs, esclaves libérés. Parmi eux, Andrés Aguiar, désormais affranchi, s’impose non seulement par sa stature impressionnante mais par une intelligence du terrain et un sens aigu de la tactique. Il n’est pas un soldat ordinaire ; il devient rapidement un pilier. Là où les autres hésitent, lui avance, stoïque. On le remarque. Et plus encore, on le respecte.
La bataille de San Antonio4 en 1846 est son coup d’éclat. Sur les rives de l’arroyo du même nom, Garibaldi et ses hommes affrontent les troupes oribistes. L’affrontement est violent, désordonné, et la cavalerie ennemie s’abat sur les lignes républicaines. Garibaldi, tombé de cheval au cœur du chaos, est sur le point d’être capturé. Aguiar, dans un geste que l’on dirait tiré d’une épopée, surgit. Il fend la mêlée, désarçonne deux assaillants d’un seul coup de lance, extrait son commandant et le hisse sur sa propre monture avant de disparaître dans la poussière.
Ce n’est pas la première fois qu’il sauve Garibaldi ; et ce ne sera pas la dernière. Ce jour-là, pourtant, une nouvelle relation se scelle. Aguiar ne sera plus seulement un soldat parmi d’autres. Il devient l’ombre du général, son garde du corps attitré, son compagnon de route et de guerre. Le lien dépasse le cadre militaire. Aguiar devient un confident, un frère d’armes dans un monde où la fraternité ne se proclame pas, elle se prouve.
La presse, déjà avide de figures héroïques, commence à s’intéresser à ce soldat noir, silencieux mais central. Son image intrigue, détonne. Un géant à la peau sombre, monté sur un cheval noir, drapé d’un manteau écarlate, une lance ornée d’un fanion rouge dans le dos. À ses pieds, souvent, un chien à trois pattes : Guerrillo, un autre rescapé de la bataille, qu’Aguiar adopte et qui suivra les deux hommes jusqu’en Europe. Un trio improbable, presque légendaire, qui deviendra bientôt un symbole.
Si la guerre est un théâtre, Aguiar s’y forge un rôle rare : celui de l’égal discret. Dans un monde façonné par les hiérarchies raciales, il est l’un des rares hommes noirs à évoluer au plus près d’un chef militaire blanc de stature internationale. Et pourtant, jamais il ne cherche la lumière. C’est peut-être ce qui rend sa loyauté plus éclatante encore : elle n’est pas calculée, elle est choisie.
San Antonio n’est pas qu’un épisode militaire. C’est le moment où le destin d’un ancien esclave d’Amérique du Sud s’entrelace de façon indissociable avec celui d’un révolutionnaire italien, dans une alliance improbable mais indestructible ; née dans le feu et scellée dans la poussière des batailles.
Cap sur l’Europe : Le rêve de liberté
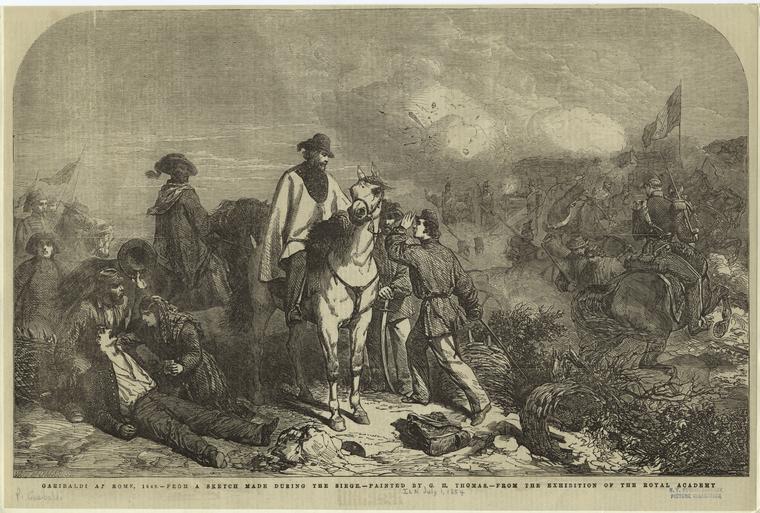
L’année 1848 est un séisme politique pour l’Europe : les peuples se soulèvent, les empires vacillent, les barricades montent à Paris, Berlin, Vienne… et Rome s’enflamme à son tour. Pour Garibaldi, c’est l’heure du retour : il quitte les rives du Río de la Plata pour rallier son Italie natale en feu. À ses côtés, Andrés Aguiar embarque sans hésiter. Ce n’est plus seulement la guerre d’un général qu’il suit, c’est une idée : celle d’une liberté sans frontières, affranchie des continents et des couleurs de peau.
À leur arrivée, l’Italie est morcelée : les troupes autrichiennes au nord, les Bourbons au sud, et les États pontificaux en plein vacillement. Garibaldi rejoint les combats en Lombardie, menant des actions éclairs dans les villes de Luino et Morazzone5. Aguiar, désormais aguerri et fin stratège, y joue un rôle tactique souvent ignoré par les récits européens : éclaireur, cavalier de liaison, protecteur rapproché. Il ne parle pas italien, mais il comprend la logique du terrain, la mécanique des sièges, et surtout l’instinct de survie. Ce sont ses gestes, sa présence, son autorité silencieuse qui font de lui un cadre naturel dans les escouades garibaldiennes.
C’est à Rome que le destin d’Aguiar se fige dans l’histoire. En février 1849, la République romaine est proclamée, renversant l’autorité du Pape. Mazzini, Saffi, Armellini gouvernent une ville désormais menacée par les armées françaises, dépêchées pour restaurer l’ordre pontifical. Garibaldi prend la tête de la défense populaire. Et parmi ses hommes, le lieutenant Aguiar, enfin promu officiellement ; une reconnaissance exceptionnelle pour un ancien esclave noir, dans une Europe encore ligotée par ses préjugés.
À Rome, Aguiar n’est plus seulement un combattant. Il devient une icône. La presse européenne, avide d’images fortes, s’empare de sa silhouette. Le Illustrated London News publie un dessin saisissant : Aguiar, crâne nu, portant une écharpe rouge et un sabre, chevauche derrière Garibaldi dans les ruelles sinueuses du Trastevere. L’hebdomadaire britannique le décrit comme « un brave parmi les braves, imposant et digne, le seul visage noir sur les lignes européennes ». D’autres gravures le montrent sabre au clair, portant un drapeau déchiré ou défendant un bastion avec une lance à fanion rouge. Il devient malgré lui l’ »Autre » glorifié : l’exotique loyal, l’Africain libre aux côtés des héros blancs.
Mais derrière ces représentations, il y a un homme. Un soldat sans famille, sans nation à proprement parler, qui porte sur lui une autre guerre : celle contre l’oubli. Aguiar ne réclame rien, mais sa présence seule dérange. Elle conteste la normalité d’une lutte européenne vue comme exclusivement blanche. Il est la preuve vivante que la liberté, celle qui se gagne les armes à la main, ne se limite pas à un peuple ou une géographie.
Dans les lettres des volontaires suisses ou allemands engagés dans la République romaine, on lit souvent des mentions étonnées d’Aguiar : certains le décrivent comme « l’incarnation du courage », d’autres comme un « démon rouge aux allures bibliques », tant son image frappait les esprits. L’artiste néerlandais Jan Koelman, également soldat, raconte comment Aguiar lançait des lassos pour désarçonner les cavaliers ennemis, récupérait les chevaux fuyant sans cavalier, et montait la garde pendant que Garibaldi dormait, allongé sur sa selle utilisée comme oreiller.
Ces récits tissent autour d’Aguiar une figure mi-historique, mi-mythique. Mais la réalité est plus poignante encore : au milieu des ruines, entre deux canonnades, un ancien esclave d’Uruguay tenait la ligne pour défendre une république italienne naissante, aux côtés de ceux qui, quelques années plus tôt, n’auraient pas partagé leur pain avec lui.
En juin 1849, alors que les troupes françaises préparent l’assaut final sur Rome, Aguiar reste en première ligne. C’est dans ce tumulte, aux abords de l’église Santa Maria in Trastevere, qu’il sera grièvement blessé, tombant à ses pieds. D’après les témoignages, il aurait crié en s’écroulant : « Vive les républiques d’Amérique et de Rome ! ». Transféré d’urgence à Santa Maria della Scala, il meurt le jour même malgré les soins du docteur Bertani, célèbre médecin des volontaires garibaldiens.
Aguiar meurt comme il a vécu : au cœur du combat, au service d’un idéal plus vaste que sa propre vie. Il ne laisse pas de lettres, pas de descendance, pas de fortune. Seulement une trace brûlante dans les archives de l’Histoire, et quelques croquis épars où sa silhouette, droite et noire, continue de hanter les récits de la liberté européenne.
Trastevere, 30 juin 1849, le dernier combat

Ce 30 juin 1849, les rues pavées de Trastevere ne résonnent plus des chants populaires, mais du fracas des obus et des cris de guerre. Après des semaines de siège, les troupes françaises, envoyées par Napoléon III pour restaurer le pouvoir papal, lancent leur assaut final contre la République romaine. Dans les faubourgs sud de Rome, une poignée de résistants, épuisés, affamés, mais tenaces, tient bon face à un ennemi mieux équipé et supérieur en nombre. Parmi eux, un homme en rouge, silhouette massive, à la peau d’ébène, se bat encore et toujours, lance au poing, jusqu’à ce que la guerre le fauche.

Andrés Aguiar est frappé par un éclat d’obus alors qu’il défend un point stratégique près de l’église Santa Maria in Trastevere6, l’un des plus anciens lieux de culte de Rome. Selon plusieurs témoignages, l’impact fut violent, projetant son corps contre un mur. Gravement blessé à la poitrine et au flanc, il est transporté d’urgence à quelques rues de là, à Santa Maria della Scala7, où des médecins militaires, dont le célèbre docteur Agostino Bertani8, tentent de le stabiliser. Mais l’hémorragie est trop importante, les moyens trop dérisoires, et Aguiar meurt quelques heures plus tard, dans cette petite église baroque transformée en hôpital de fortune.

Pour Garibaldi, la perte est incommensurable. Jamais le général au regard de feu, au verbe impétueux, ne s’était laissé aller à l’émotion. Mais face au corps sans vie de son frère d’armes, il plie. Le témoignage du capitaine Rafael Tosi est explicite :
« C’est la seule fois où je vis ses yeux se remplir de larmes. Il ne cria pas, ne s’emporta pas. Il resta silencieux, debout, les poings serrés, les larmes roulant sur ses joues tannées. »
Cette douleur ne s’exprime pas seulement par des gestes. Dans son journal, Garibaldi couche ces mots :
« Hier, Rome a compté de nouveaux martyrs. L’Amérique a offert, avec le sang de son valeureux fils Andrés Aguiar, une preuve d’amour pour notre Italie plus belle, plus trahie. »
Mais au-delà de l’émotion personnelle, la mort d’Aguiar cristallise une injustice historique. Voici un homme né esclave à Montevideo, mort pour une République européenne, et dont le nom, contrairement à tant d’autres héros de l’unification italienne, ne figurera sur aucune statue, aucune place publique, aucun manuel scolaire ; du moins, pas avant plus d’un siècle.

Son décès, pourtant, a marqué les esprits. Même les journaux conservateurs, qui caricaturaient jusqu’alors sa présence au côté de Garibaldi, y voient un symbole. Des gravures le montrent gisant au sol, le torse nu, la lance brisée à ses pieds. Il est décrit comme « l’incarnation d’une liberté noire étrangère, tombée pour une patrie qui n’était pas la sienne mais dont il avait fait le combat ». L’ironie tragique est là : Aguiar est mort pour une république dont il ne parlait même pas la langue, mais dont il comprenait le sens profond mieux que beaucoup de ses contemporains.
Le quartier de Trastevere, où il est tombé, ne gardera que peu de traces de son passage. Pourtant, les soldats, les volontaires, les habitants se souviennent. On raconte qu’un silence inhabituel s’installa dans la zone de combat ce soir-là. Une trêve tacite, comme si même les canons reconnaissaient la grandeur de la perte. Certains soldats français, témoins de la scène, auraient baissé leur fusil en le voyant tomber.
Mais l’Histoire, elle, choisit ses héros. Et souvent, elle oublie ceux qui n’avaient ni nom célèbre, ni peau blanche, ni statut bourgeois. C’est dans cette béance que se perd Aguiar ; dans ce moment où l’hommage populaire ne suffit pas à graver la mémoire dans la pierre.
L’oubli et la résurgence : Une mémoire retrouvée

À sa mort, Andrés Aguiar fut pleuré par Garibaldi, admiré par ses frères d’armes, salué même par ses ennemis, mais à peine mentionné dans les récits officiels de la République italienne naissante. Comme tant d’autres héros afrodescendants, sa mémoire s’estompa lentement, glissant dans l’ombre d’une Histoire écrite par d’autres, pour d’autres.
Ni plaque dans les manuels scolaires, ni présence dans les discours patriotiques. Au Janicule, haut lieu de la mémoire garibaldienne à Rome, des bustes en marbre veillent sur la ville, immortalisant les visages de ceux qui tombèrent pour l’unité italienne. Aguiar n’en faisait pas partie. Pourtant, il avait combattu comme lieutenant, versé son sang sur la même terre, et été célébré en son temps dans les journaux européens. Mais sa peau noire, son origine servile, son statut d’étranger l’ont lentement exclu de la légende nationale.
Il fallut attendre plus d’un siècle et demi pour que sa silhouette réapparaisse dans le paysage mémoriel. En 2013, l’Uruguay prend une première initiative. Le Musée historique national de Montevideo organise une exposition consacrée à ce fils oublié de la République. Un timbre commémoratif à son effigie est émis, montrant Aguiar en uniforme rouge, la lance en main, le regard fier ; image rare d’un Noir honoré non pour sa souffrance, mais pour son courage.
Ce geste, loin d’être anecdotique, marque un tournant. Il réinscrit Aguiar dans l’histoire afro-uruguayenne, où il incarne l’un des premiers exemples de résilience et d’héroïsme noir transatlantique. Il devient un symbole pour les jeunes générations afrodescendantes d’Amérique latine : celui d’un homme né esclave, devenu soldat, compagnon de Garibaldi, puis héros de deux continents.
En Italie, la reconnaissance fut plus lente, mais la résonance mondiale des luttes contemporaines finit par éveiller les consciences. En 2021, à l’occasion d’un hommage commun au général Thomas-Alexandre Dumas (le « général noir » français), la ville de Rome initie un projet de mémoire partagée entre la France, l’Italie et l’Uruguay. Le maire du XVIIe arrondissement de Paris et celui de Rome posent les bases d’une collaboration pour faire entrer dans la pierre ceux que l’histoire a laissés en marge.
Ce n’est qu’en 2024 que justice est véritablement rendue. Un buste d’Andrés Aguiar est inauguré au Janicule, au cœur du Panthéon des héros du Risorgimento. Sculpté dans une pierre sombre aux veines profondes, il contraste avec le marbre clair des autres figures. Un contraste qui, loin de le diminuer, souligne la singularité de son destin et la profondeur de son engagement. Il ne s’agit plus seulement d’un soldat noir aux côtés de Garibaldi. Il devient ce qu’il aurait toujours dû être : un symbole de la liberté transnationale, de la solidarité républicaine et de l’universalité des luttes contre l’oppression.
Les mots gravés sur la plaque sont simples :
« Andrés Aguiar, lieutenant de la République romaine. Né esclave, mort libre. »
Un rappel à l’ordre pour ceux qui auraient encore tendance à croire que l’Histoire est un monopole de blancs. Un monument pour rappeler que le sang versé pour la liberté ne connaît pas de couleur, mais que l’oubli, lui, a longtemps été sélectif.
L’écho d’un cavalier noir dans l’Histoire blanche
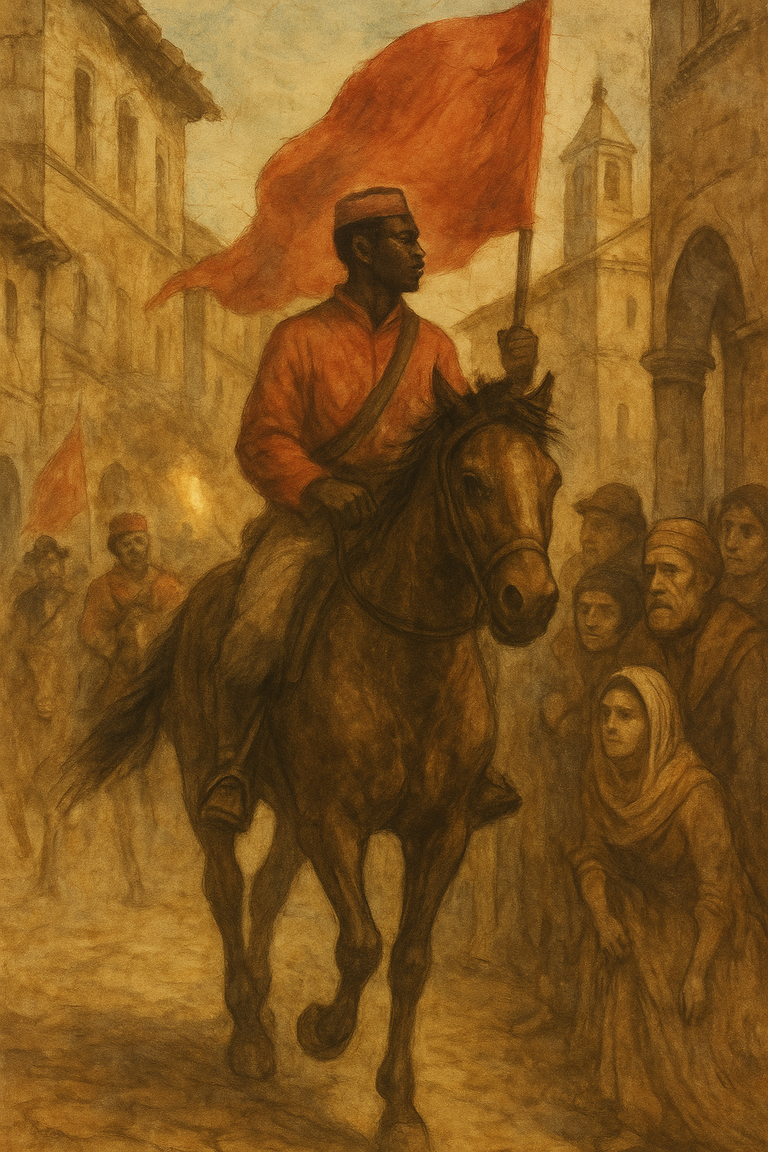
L’histoire d’Andrés Aguiar est celle d’un homme libre, né esclave. Elle traverse deux continents, deux révolutions, deux mémoires. C’est l’histoire d’un homme dont le corps a porté les cicatrices d’un siècle d’oppression, et dont l’âme s’est enflammée au contact des idéaux républicains. Sa silhouette puissante, sa lance rouge, sa fidélité à Garibaldi, sa mort sur les pavés de Rome : tout chez lui relève d’une tragédie classique et d’une épopée contemporaine.
Mais si son nom a mis si longtemps à franchir les seuils de la postérité, c’est bien parce qu’il était noir. Parce qu’il venait du Sud. Parce qu’il incarnait une mémoire qui dérange : celle d’un peuple trop souvent relégué aux marges du récit national, alors même qu’il en a écrit les pages les plus vibrantes.
En ressuscitant Aguiar aujourd’hui, il ne s’agit pas d’ajouter une figure exotique au panthéon républicain. Il s’agit de corriger une injustice historique, de restituer une voix, une présence, une flamme. Il s’agit de rappeler que la liberté n’est pas un privilège d’Occident, mais un combat universel ; et que ceux qui l’ont portée jusqu’au sacrifice le plus ultime méritent plus qu’un buste ou un timbre : ils méritent un chapitre.
Andrés Aguiar fut de ceux-là.
Et désormais, grâce à la mémoire retrouvée, il ne galope plus seul dans l’oubli.
Notes et références
- La Guerra Grande (1838–1851) désigne la longue guerre civile uruguayenne opposant les Blancos (conservateurs) aux Colorados (libéraux), sur fond d’interventions étrangères, notamment de l’Argentine de Rosas et du Brésil, reflétant les luttes d’influence dans la région du Río de la Plata au XIXᵉ siècle. ↩︎
- Giuseppe Garibaldi (1807–1882) est une figure centrale du Risorgimento, le mouvement d’unification italienne. Aventurier et stratège militaire, il mena également des campagnes en Amérique latine, notamment en Uruguay, où il combattit durant la Guerra Grande aux côtés des Colorados. Son image de « héros des deux mondes » s’est construite entre mythe et réalité, portée par son charisme, ses victoires symboliques et un engagement constant en faveur des républiques. ↩︎
- La Légion italienne désigne un corps de volontaires créé à Montevideo en 1843 par Giuseppe Garibaldi durant la Guerra Grande. Composée d’exilés italiens, souvent républicains ou carbonari, cette unité militaire défendit la cause des Colorados contre les Blancos soutenus par Rosas. Elle fut le creuset des futurs combattants du Risorgimento, liant l’idéal républicain européen aux luttes d’indépendance sud-américaines. ↩︎
- La bataille de San Antonio, livrée en 1846 dans le cadre de la Guerra Grande, opposa les troupes loyalistes de Montevideo, composées notamment de la Légion italienne commandée par Garibaldi, aux forces rurales des Blancos. Ce combat fut marqué par l’engagement décisif de nombreux combattants afro-descendants et étrangers, dont Andrés Aguiar, et s’inscrit dans la défense de la capitale assiégée, alors symbole d’une République menacée. ↩︎
- Luino et Morazzone sont deux petites villes de Lombardie, dans le nord de l’Italie. Connues pour leur soutien aux idéaux républicains au XIXᵉ siècle, elles furent le berceau de plusieurs volontaires engagés dans les campagnes de Giuseppe Garibaldi, notamment en Uruguay. Ce lien entre localités italiennes et luttes transatlantiques témoigne de l’internationalisation des combats pour la liberté au sein du monde atlantique. ↩︎
- Santa Maria in Trastevere est l’une des plus anciennes églises de Rome, située dans le quartier populaire du Trastevere. Symbole de résistance lors de l’entrée des troupes françaises en 1849 pour rétablir le pouvoir papal, elle fut le théâtre de violents affrontements entre les défenseurs de la République romaine et les soldats français. C’est dans ses environs que plusieurs volontaires garibaldiens, dont des Afro-descendants comme Andrés Aguiar, livrèrent leur dernier combat. ↩︎
- Santa Maria della Scala est une église historique du quartier du Trastevere à Rome, voisine de Santa Maria in Trastevere. Durant l’été 1849, à la chute de la République romaine, elle servit temporairement d’hôpital de fortune pour les blessés garibaldiens, dont plusieurs volontaires étrangers. Parmi eux, on compte Andrés Aguiar, officier afro-uruguayen, grièvement blessé lors des combats contre les troupes françaises. ↩︎
- Agostino Bertani (1812–1886) est un médecin et patriote italien, figure importante du Risorgimento. Connu pour son engagement humaniste, il organisa les services de santé des troupes garibaldiennes durant les campagnes militaires, notamment lors de la défense de la République romaine en 1849. Républicain convaincu, il incarna la jonction entre médecine, politique et idéal révolutionnaire au service des causes nationales et populaires. ↩︎
Sommaire
Le blanchiment des troupes coloniales
En 1944, la France retire ses soldats africains des lignes de front, effaçant leur rôle dans la Libération. Découvrez l’histoire du « blanchiment » des troupes coloniales.
L’effacement des soldats noirs de la Libération française

À l’automne 1944, alors que Paris acclame ses libérateurs et que les Champs-Élysées résonnent des clameurs de la victoire, une autre scène se joue dans l’ombre des projecteurs de la gloire. Sur les routes humides du Sud de la France, loin des caméras et des honneurs, des colonnes entières de soldats noirs, épuisés par des mois de combats, sont discrètement relevées de leurs fonctions. Ces hommes, venus d’Afrique-Occidentale française, du Tchad, du Sénégal ou du Cameroun, avaient pourtant versé leur sueur et leur sang pour la France. On les appelait les tirailleurs sénégalais, bien que peu d’entre eux fussent sénégalais. Et sans tambour ni trompette, ils furent écartés des premières lignes.
C’est ce que l’histoire officielle appellera plus tard le « blanchiment des troupes coloniales ». Une expression technique, presque neutre, mais qui dissimule un acte politique lourd de symboles : remplacer les soldats noirs par des combattants blancs issus des Forces françaises de l’intérieur (FFI), au nom d’une nouvelle mise en scène de la Libération. Ce remplacement n’était ni anodin ni logistique. Il était orchestré. Organisé. Silencieux. Invisibilisant.
À l’heure des photographies triomphales, la République renaissante ne voulait pas des visages d’Afrique pour illustrer son retour à la lumière. Dans une France en reconstruction, la mémoire devait elle aussi être reconfigurée. Et les soldats de l’Empire, qui avaient porté l’uniforme avec fierté, furent tout simplement effacés du cadre.
Mais cette histoire ne saurait rester en marge des récits héroïques. Car elle interroge la manière dont une nation traite ses défenseurs. Elle raconte la violence d’une reconnaissance différée, et le poids d’une mémoire raciale tue au profit d’un roman national blanc. Elle invite, enfin, à regarder en face les cicatrices d’un passé que trop d’archives, de discours et de silence ont tenté d’ensevelir.
Les tirailleurs sénégalais, ces combattants de l’ombre

Ils venaient de Saint-Louis, de Bamako, de Ouagadougou ou de Brazzaville. Ils n’avaient souvent jamais vu la mer. Et encore moins foulé la terre froide de la Provence. Mais ils étaient là. Casque enfoncé sur le front, baïonnette au canon, entonnant parfois un chant en langue wolof, bamanan ou ewe pour conjurer la peur. Ces hommes, qu’on appelait tous « tirailleurs sénégalais » (bien qu’ils vinssent de tout l’empire colonial d’Afrique) formaient l’ossature d’une armée française renaissante, forgée dans les cendres de l’humiliation de 1940.
Leur engagement dans la Seconde Guerre mondiale n’était ni anecdotique, ni secondaire. Il était massif, décisif, mais souvent relégué à l’arrière-plan des récits nationaux. Dès les premières années de la guerre, alors que la métropole est occupée et que Vichy pactise, les territoires africains ralliés à la France libre deviennent un vivier de recrutement. Sous le commandement du général Leclerc et avec le soutien de Félix Éboué, les forces africaines (notamment les troupes issues de l’Afrique-Équatoriale française) prennent part aux campagnes du Fezzan, de Libye, de Tunisie.
Mais c’est en août 1944, lors du débarquement de Provence, que leur rôle devient incontournable. La 1ère Armée française du général de Lattre de Tassigny compte alors environ 260 000 hommes, dont près de 130 000 issus des colonies africaines. Parmi eux, plus de 20 000 tirailleurs africains sont envoyés en première ligne. Ils avancent sous le feu, libèrent Toulon, Marseille, remontent la vallée du Rhône, participent aux durs combats des Vosges, puis à la percée finale vers l’Allemagne.
Ces hommes sont aguerris, expérimentés. Beaucoup ont déjà combattu en 1939-1940 ou dans les troupes coloniales. Ils connaissent la rudesse du front, l’injustice des rations inégales, la brutalité des commandements. Ils combattent pour une patrie qui, bien souvent, ne les considère pas comme ses fils. Mais ils avancent tout de même. Pour l’honneur. Pour les leurs. Pour une promesse que la République semblait leur chuchoter ; celle d’une reconnaissance, enfin.

Leur sacrifice ne se limite pas à la guerre. Certains ont été prisonniers de guerre en 1940, parqués dans des stalags allemands dans des conditions inhumaines. D’autres ont vu leurs compagnons massacrés, comme ce fut le cas à Chasselay, en 1940, où une colonne de tirailleurs a été exécutée par les nazis parce qu’ils étaient noirs.
Et pourtant, au moment des premières victoires françaises sur le sol métropolitain, leurs noms ne figurent pas sur les discours. Leurs visages ne sont pas dans les photos officielles. Ils sont là, sur les lignes de front, mais absents des lignes de l’Histoire. Des combattants de l’ombre, à qui l’on demande de mourir pour une patrie que l’on peine à leur accorder.
Ce paradoxe brutal est d’autant plus criant que ces tirailleurs étaient perçus par certains officiers français comme plus efficaces, plus disciplinés et plus résistants que les recrues métropolitaines issues de la Résistance intérieure. Et pourtant, c’est à eux qu’on demandera, quelques semaines plus tard, de céder leur place.
Le « blanchiment », une stratégie d’effacement
À la fin de l’été 1944, les routes de France sont jonchées de ruines, de silences et de chants de victoire. Mais dans les replis de cette liesse, une autre histoire se joue. Une histoire que la République n’a pas chantée. Alors même que les troupes africaines remontent vers l’Alsace, qu’elles délogent les derniers bastions allemands, qu’elles paient encore un tribut de sang sur les pentes des Vosges, une décision politique et raciale va venir effacer leur victoire. C’est ce qu’on appelle, dans les termes froids de l’administration militaire, le « blanchiment » des troupes coloniales.
À partir de septembre 1944, des ordres venus du haut commandement, en concertation avec les forces alliées, imposent le retrait progressif des tirailleurs sénégalais et autres soldats noirs de la 1ère Armée française. Dans les régiments de première ligne, on remplace les combattants africains par des recrues blanches, issues des Forces françaises de l’intérieur (FFI). Ces nouveaux venus, souvent moins formés, moins aguerris, prennent la relève des vétérans coloniaux. Les soldats noirs sont redéployés vers le Sud, affectés à des tâches de logistique, d’intendance, ou simplement rapatriés, sans fanfare ni adieu.
Dans certaines unités, la scène est surréaliste. Des tirailleurs, couverts de gloire et de cicatrices, doivent déposer leurs armes et remettre leurs équipements flambants neufs (symboles de leur courage) à des civils blancs à peine formés, parfois hostiles à leur présence. Le déshabillage est littéral. On retire l’uniforme comme on efface un nom, une mémoire, une dette. Les anciens de la 9e Division d’infanterie coloniale en témoignent avec amertume : « Ce jour-là, on nous a rendus invisibles. »
Ce processus de « blanchiment » n’est ni une coïncidence ni un simple réajustement militaire. C’est une décision stratégique, nourrie par des considérations politiques, sociales et raciales. L’armée américaine, ségréguée jusqu’en 1948, refuse la présence de troupes noires aux portes de l’Europe libérée, craignant l’image d’une armée « trop noire » entrant triomphalement dans Paris ou dans Berlin. Le mémo du général américain Walter B. Smith, en janvier 1944, ne laisse guère de place au doute : les soldats noirs doivent être séparés des troupes blanches, comme c’est le cas dans les régiments américains.
Mais les pressions ne viennent pas que des alliés. Le pouvoir français lui-même, soucieux de restaurer une République blanche et souveraine, se montre complice de cet effacement. Le général de Gaulle, homme de vision mais aussi stratège du réel, cherche à rallier la Résistance intérieure et à renforcer le sentiment d’unité nationale. Or, dans l’imaginaire collectif français de l’époque, la présence massive de troupes africaines à la Libération pourrait brouiller le récit d’une France qui s’est « libérée elle-même ».
Pour justifier ce retrait, on convoque des raisons plus acceptables. Le climat. Le froid. Le moral des troupes. Les gelures. Les désirs de rapatriement. On parle d’humanité. On parle de stratégie. Mais dans les faits, cette opération est vécue par les tirailleurs comme une trahison. Eux qui ont versé leur sang pour la France sont exclus du récit final. Ils ne défileront pas sur les Champs-Élysées. Ils n’apparaîtront pas sur les photos de Paris libérée. À l’exposition sur la Libération au musée Carnavalet, aucun visage noir ne figure sur les clichés. Un oubli trop précis pour être innocent.
Ce blanchiment est aussi une manière de restaurer l’ordre colonial. Car la guerre a tout bouleversé. Des Noirs ont commandé. Des indigènes ont libéré des Blancs. Des soldats africains ont partagé le pain avec des soldats français. Dans la boue, sous les obus, la hiérarchie raciale avait été suspendue. Or, le pouvoir colonial ne pouvait le tolérer trop longtemps. L’ordre devait revenir. Et cela passait par un effacement soigneusement orchestré.
Dans son documentaire Le blanchiment des troupes coloniales, le réalisateur Jean-Baptiste Dusséaux évoque cette mécanique d’invisibilisation avec lucidité : l’armée française préféra se priver de vingt mille combattants aguerris plutôt que d’assumer la diversité de ses libérateurs. Ce choix tragique a laissé une trace durable : celle d’un silence, d’un oubli, d’une dette morale que l’Histoire peine encore à solder.
Les motivations derrière le retrait

L’histoire officielle a longtemps recouvert le blanchiment des troupes coloniales d’un voile de rationalités militaires. On a parlé de logistique, de fatigue, de réalignement stratégique. Mais en grattant ce vernis, on découvre les véritables rouages d’un effacement délibéré, inscrit à la fois dans les rapports de force internationaux, la peur des métissages symboliques et le maintien d’un empire en déclin. Car ce retrait n’est pas seulement une opération tactique. C’est un choix politique, culturel et racial.
En janvier 1944, un mémo confidentiel signé du général Walter Bedell Smith, chef d’état-major du général Eisenhower, arrive sur les bureaux français. Le ton est direct : il est recommandé que les forces françaises limitent la présence de soldats noirs dans les unités opérant aux côtés des troupes américaines. Le contexte ? L’armée américaine elle-même est encore structurellement ségréguée : les soldats afro-américains ne combattent pas aux côtés des Blancs. Ils sont cantonnés à des tâches d’intendance, de ravitaillement, de transport. Leur engagement est reconnu… à condition qu’il reste invisible.
Dans ce système, l’idée que des soldats noirs (africains, de surcroît) puissent libérer des villes européennes, marcher triomphalement dans Paris, rencontrer les populations civiles, est un affront à l’ordre racial des États-Unis. Le Haut Commandement allié fait pression, et la France, qui cherche encore à restaurer sa légitimité dans la coalition, s’aligne. Le blanchiment devient alors une concession diplomatique, un gage donné à une Amérique blanche qui ne veut pas troubler l’image d’une Europe libérée par des forces « acceptables ».
Mais l’initiative ne vient pas uniquement des alliés. Elle naît aussi d’un réflexe français profondément ancré : celui de préserver l’ordre colonial. La guerre a fait voler en éclat la séparation géographique et symbolique entre colonisateurs et colonisés. Des tirailleurs africains ont porté les couleurs de la République. Ils ont libéré Marseille, Toulon, Lyon. Ils ont connu l’égalité des tranchées. Certains ont vu leur autorité reconnue, leurs compétences saluées, leur héroïsme admiré.
Et cela inquiète.
Les élites françaises redoutent que ce prestige militaire ne se transforme en revendications politiques ou sociales. Que ces soldats, revenus sur le sol africain après avoir combattu pour la « patrie des droits de l’homme », exigent à leur tour égalité, citoyenneté, représentation. Comment leur refuser ? Comment maintenir l’indigénat après les avoir appelés « frères d’armes » ? Pour beaucoup dans l’establishment colonial, le retrait des tirailleurs est un moyen de remettre chacun « à sa place ».
Plus subtilement, le retrait permet de reconstruire un récit national centré sur la Résistance blanche, intérieure, « gaullienne », un récit de renaissance qui évacue les figures coloniales du paysage héroïque. La France devait se reconstruire, mais sans ces visages qui rappelaient trop les ambiguïtés de son empire.
L’une des explications les plus souvent avancées est celle du climat. L’hiver européen, dur, humide, glacial, aurait fragilisé les soldats africains, peu préparés (dit-on) aux conditions extrêmes des Vosges ou de l’Alsace. On évoque les gelures, les rhumes persistants, la baisse de moral. On pointe des chiffres : plus de 300 cas de gelures recensés en une journée au sein de la 1ère DMI, le 10 octobre 1944.
Mais cette justification ne tient pas.
D’abord parce que ces soldats avaient déjà combattu en France durant la Première Guerre mondiale, dans la boue des tranchées, sous les pluies de la Marne, dans des conditions pires encore. Ensuite parce que les pertes humaines causées par le froid n’étaient pas supérieures à celles des autres régiments. Enfin, parce que les tirailleurs eux-mêmes n’étaient pas demandeurs de retour, mais espéraient au contraire participer jusqu’au bout à la libération d’un pays qu’ils avaient contribué à défendre.
Derrière cet argument médical se cache un choix politique. Le climat devient un alibi commode pour maquiller une décision profondément raciale. Et dans les rapports militaires internes, les phrases trahissent une autre vérité : celle de la peur de mélanges symboliques. Le contact entre soldats noirs et populations blanches (notamment les femmes) est perçu comme une menace à l’ordre moral. Des incidents réels ou exagérés survenus en Italie nourrissent ces craintes.
Privés de leurs armes, évincés des champs d’honneur, les tirailleurs sénégalais n’ont pas eu le droit au mot de la fin. Aucune consultation, aucun discours. Leur retrait fut administratif, sec, anonyme. Dans certains cas, ils durent eux-mêmes céder leurs uniformes aux nouvelles recrues FFI, jeunes Français blancs fraîchement enrôlés. Ils furent dispersés dans des régiments de maintenance, puis rapatriés par bateaux vers Dakar, Bamako, Conakry. Certains ne comprirent jamais pourquoi. D’autres en gardèrent une colère sourde, transmise à leurs enfants et petits-enfants.
Leur silence fut celui de la République. Ni reconnaissance, ni pension équitable, ni décoration publique. Juste le vide. Le blanchiment fut plus qu’un retrait militaire : ce fut une opération de blanchiment mémoriel. Un gommage méthodique de visages, de noms, de parcours héroïques.
Conséquences et mémoire effacée
Effacer un soldat, ce n’est pas le désarmer. C’est le désincarner. C’est ôter son nom du récit national, le reléguer dans les marges de l’histoire, là où s’entassent les silences d’État. Le blanchiment des troupes coloniales, plus qu’une simple opération militaire, a engendré une invisibilisation systématique, un bannissement symbolique qui continue, aujourd’hui encore, à hanter les mémoires des diasporas africaines et afrodescendantes.
Lorsque Paris est libérée, les caméras s’installent sur les Champs-Élysées. Elles capturent la liesse, les drapeaux, les accolades. Elles immortalisent les hommes du général Leclerc, les figures blanches de la Résistance, les héros de la Libération. Mais sur ces images d’archives devenues mythiques, les visages noirs sont absents. Comme s’ils n’avaient jamais combattu. Comme si la République s’était libérée d’elle-même, sans l’aide de ceux qu’elle envoyait mourir pour sa liberté.
La mise à l’écart des tirailleurs sénégalais lors des défilés de la victoire n’est pas un oubli accidentel. C’est un acte de communication politique. Il fallait reconstruire une image héroïque, homogène, blanche, d’une France résistante et victorieuse. L’empire colonial, pourtant si présent dans les faits, devait être gommé dans la forme. Ce déni d’apparition publique a eu des effets durables : pendant des décennies, les manuels scolaires, les commémorations, les statues, ont reproduit cette même cécité.
Et ce qui ne se montre pas finit par ne plus exister.
Mais les hommes n’oublient pas. Et dans les ports où on les débarque, dans les casernes où on les parque, les tirailleurs murmurent, puis grondent. Ils ont tout donné, et ne reçoivent que l’ombre d’une reconnaissance. À leur retour, leurs soldes sont amputées, leurs pensions rognées, leur dignité piétinée. Pire encore : certains sont à nouveau internés. Soupçonnés de révolte, surveillés comme des corps subversifs.
C’est à Thiaroye, au Sénégal, en décembre 1944, que la tension atteint son point de rupture. Des centaines d’anciens combattants, exaspérés par le traitement injuste qui leur est réservé, se rassemblent pour réclamer leur dû. L’État français, au lieu d’écouter, choisit de réprimer.
Le massacre de Thiaroye, dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre, reste l’une des pages les plus sombres et les plus honteuses de l’histoire militaire française. Le nombre de morts exact demeure incertain (l’ombre administrative pèse encore), mais les témoignages évoquent plusieurs dizaines de tirailleurs exécutés froidement par l’armée française, sur le sol africain, après avoir servi la France.
Ce drame n’est pas seulement une tragédie. Il est le symptôme d’un double abandon : militaire et mémoriel. Ces hommes, venus défendre la République, furent tués pour avoir osé demander justice.
Il a fallu attendre le tournant du XXIe siècle pour que la République commence, timidement, à rouvrir le dossier. Des documentaires, des travaux universitaires, des romans, des artistes se sont emparés de ce pan occulté de l’histoire. Le cinéma s’est invité, parfois avec pudeur, parfois avec fracas, pour réveiller les consciences endormies. Des voix se sont élevées pour rappeler que l’histoire de la France ne pouvait se construire sur l’effacement de ceux qui l’ont libérée.

En 2006, Jacques Chirac reconnaît publiquement le massacre de Thiaroye. En 2010, les pensions des anciens combattants coloniaux sont enfin alignées sur celles de leurs homologues français. Mais beaucoup sont déjà morts. Beaucoup n’ont rien vu de ce geste tardif, trop souvent perçu comme une aumône posthume.
Aujourd’hui encore, le nom des tirailleurs sénégalais n’est pas inscrit dans toutes les écoles, les rues, les mémoriaux. Leur trace subsiste dans quelques stèles, dans quelques cérémonies du 11 novembre. Trop peu pour ceux qui ont versé leur sang sur les plages de Provence, dans les neiges des Vosges ou dans les campagnes de Lorraine.
Et pourtant, ils sont là.
Ils sont dans les chants de leurs petits-enfants, dans les combats pour l’égalité, dans les mémoires transgénérationnelles de la diaspora. Ils sont dans chaque silence qu’on refuse d’accepter, chaque hommage qu’on exige, chaque ligne d’histoire qu’on réécrit.
Sources
- Julien Fargettas, Les tirailleurs sénégalais : les soldats noirs entre légendes et réalités, 1939-1945, Tallandier, 2012.
- Claire Miot, Le retrait des tirailleurs sénégalais de la Première Armée française en 1944, Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 2015.
- Jean-Baptiste Dusséaux, Le Blanchiment des troupes coloniales, documentaire, France 3, 2015.
- Article « Blanchiment des troupes coloniales« , Wikipédia.