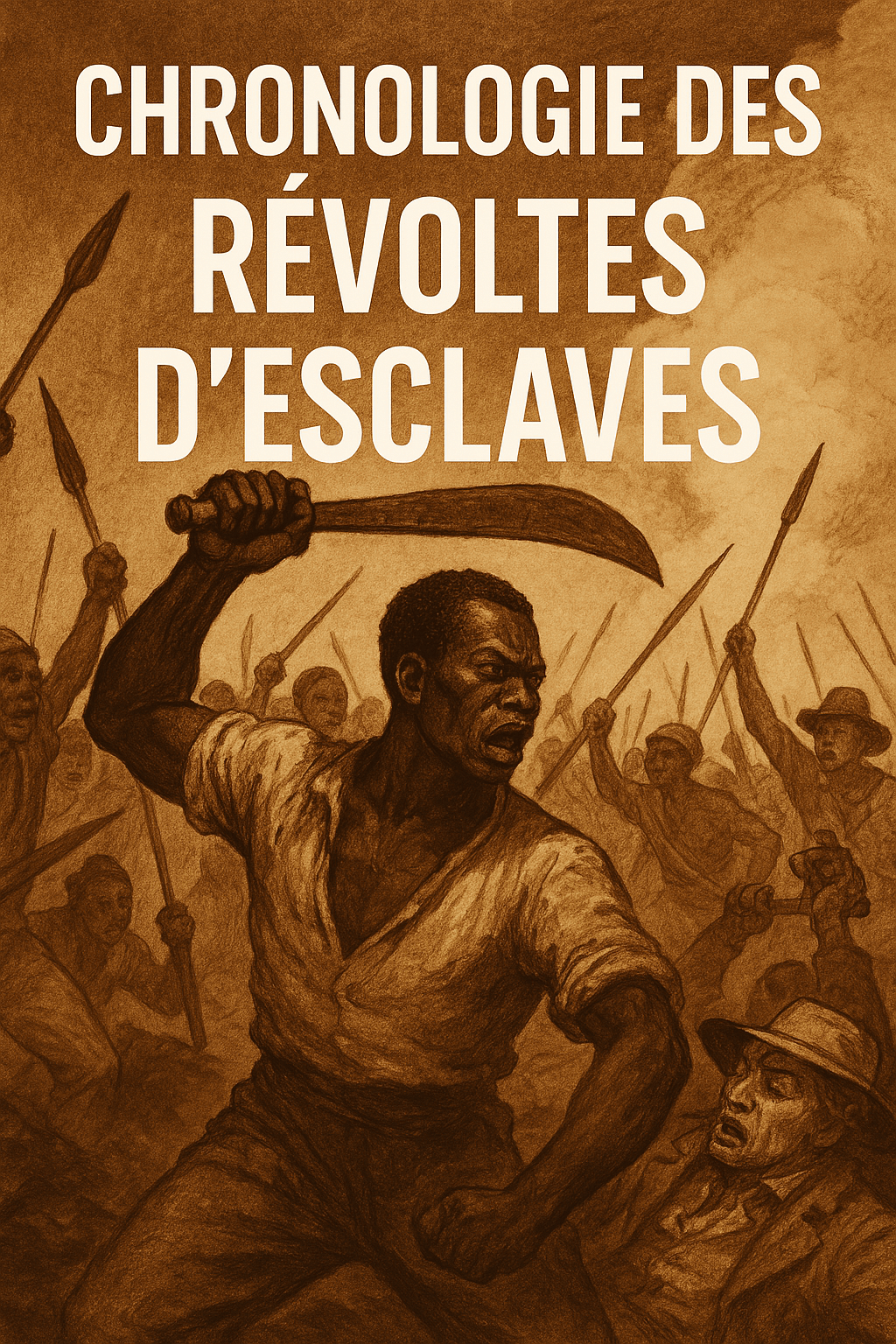Loin des discours victimaires, Nofi explore de manière analytique les processus historiques, économiques et politiques par lesquels l’Europe, à travers la traite négrière, la colonisation et les mécanismes néo-coloniaux, a inséré l’Afrique dans une logique structurelle de sous-développement. Il ne s’agit pas d’un réquisitoire, mais d’un examen méthodique des causes profondes d’un déséquilibre hérité et durable, dont les effets continuent de structurer l’économie africaine contemporaine.
Contexte de l’Afrique précoloniale et premiers contacts européens
Au tournant des XVe et XVIe siècles, alors que l’Europe entame son expansion maritime, l’Afrique subsaharienne est tout sauf une terra incognita. Loin des clichés persistants d’un continent figé dans l’oralité ou la discontinuité historique, elle abrite de puissants royaumes et empires, structurés par des institutions politiques, des systèmes de production, des codes juridiques et des expressions artistiques autonomes. Des entités telles que l’Empire du Mali ou celui du Songhaï contrôlent alors des réseaux commerciaux florissants reliant les rives du Niger aux caravanes transsahariennes, tandis que le royaume du Bénin déploie une diplomatie active avec les Européens dès le XVIe siècle. L’Éthiopie, quant à elle, incarne une autre voie : celle d’un pouvoir chrétien africain indépendant, aux ambitions impériales séculaires.
La pluralité de ces sociétés ne les empêche pas d’entretenir des échanges complexes, tant à l’intérieur du continent qu’avec ses marges nord-africaines et, bientôt, avec les puissances maritimes européennes. Lorsque les Portugais longent la côte atlantique, c’est d’abord dans une logique exploratoire et commerciale. Les premières implantations (Elmina en 1482, les îles de São Tomé ou les comptoirs au Kongo) sont des points d’ancrage côtiers, non des foyers de colonisation. Les Européens ne disposent alors ni de la technologie militaire, ni des effectifs nécessaires pour s’imposer à l’intérieur des terres. Ce sont donc les Africains qui contrôlent l’essentiel des termes de l’échange : l’or, l’ivoire, les esclaves contre des tissus, des perles ou des armes.
Mais cette relation inégale ne tarde pas à se transformer. À partir du XVIIe siècle, la traite négrière transatlantique devient le moteur principal de l’économie côtière ouest-africaine. Alimentée par la demande croissante des plantations esclavagistes des Amériques, elle restructure durablement les équilibres régionaux. Certaines entités politiques africaines, comme le royaume d’Abomey ou les chefferies côtières de la Côte de l’Or, se spécialisent dans la capture et la livraison d’esclaves.
Elles y trouvent à court terme des ressources, du prestige et des armes. Mais ce faisant, elles s’insèrent dans une logique de dépendance économique et d’instabilité politique. Les sociétés vivant en dehors des circuits esclavagistes sont elles-mêmes fragilisées par les razzias, la militarisation régionale, et l’affaiblissement du tissu social provoqué par l’exportation forcée de centaines de milliers d’individus chaque siècle.
Cette dynamique place l’Afrique dans une trajectoire particulière de participation à l’économie-monde naissante. Elle ne s’intègre pas comme une puissance marchande autonome, mais comme une périphérie extractive, dont la principale ressource devient sa population. Loin d’un simple effet collatéral, cette insertion brutale dans le commerce transatlantique prépare le terrain à la colonisation proprement dite. Car en sapant les structures politiques endogènes, en installant des dépendances économiques asymétriques, et en accoutumant certaines élites à négocier sur des bases déséquilibrées, la traite jette les bases d’une domination plus explicite au XIXe siècle.
Ainsi, bien avant que les canons européens n’ouvrent la voie à la conquête territoriale, c’est par le commerce, la dette morale et la manipulation des rivalités locales que l’Afrique commence à être façonnée au service de l’expansion européenne. C’est dans ce contexte historique précis que se comprend la suite : celle de l’asservissement économique systémique que Walter Rodney décrira comme un processus d’« underdevelopment », construit méthodiquement et non subi passivement.
Étapes historiques de l’exploitation européenne
Entre la traite négrière atlantique et la conquête coloniale du XIXe siècle, l’Afrique a connu un basculement historique majeur, non sous l’effet d’une simple rencontre des civilisations, mais dans le cadre d’un processus d’assujettissement structuré. Walter Rodney en pose le constat : le sous-développement de l’Afrique est le produit historique d’une surexploitation continue, soutenue par une architecture économique et politique mise en place par l’Europe. Ce processus s’est joué en deux grandes séquences : l’exportation de millions de corps africains dans le cadre de la traite, puis l’appropriation systémique des terres, des institutions et des économies à travers la colonisation.
La traite négrière atlantique, entre les XVIe et XIXe siècles, constitue la première grande phase d’extraction brutale de ressources humaines. Environ 12 à 15 millions d’Africains ont été déportés vers les Amériques, dans ce qui fut probablement l’un des plus grands transferts de population forcée de l’histoire. Ce système économique (connu sous le nom de commerce triangulaire) reliait les ports d’Europe, les comptoirs africains et les plantations du Nouveau Monde. Il générera des fortunes colossales pour les armateurs, les négociants et les capitalistes européens, tout en saignant durablement l’Afrique de sa force vive.
Les régions du Golfe de Guinée, du Bénin, de la Casamance ou du Congo seront les plus affectées : des villages détruits, des artisans capturés, des structures sociales disloquées. Les conséquences furent non seulement démographiques (stagnation, voire recul de la population) mais également politiques : guerres inter-ethniques attisées par la demande européenne, militarisation de certains royaumes au détriment de l’organisation civile, et affaiblissement de la cohésion interne.
À l’échelle du continent, cette période installe une logique de violence comme moteur économique. La traite n’est pas une simple ponction démographique, elle désarticule les mécanismes de reproduction sociale : elle cible les jeunes adultes, freine la croissance, empêche l’accumulation de savoirs, déstabilise les dynamiques commerciales locales. Dès lors, bien avant la conquête coloniale, l’Afrique est placée dans une posture défensive, fragilisée de l’intérieur.
Lorsque l’Europe entame, à partir de 1880, ce que l’historiographie a appelé le « partage de l’Afrique », le terrain a déjà été préparé. La Conférence de Berlin (1884–1885), qui consacre officiellement les règles de l’annexion du continent, entérine le principe de l’occupation effective comme justification du droit colonial. En moins de trente ans, près de 90 % de l’Afrique passe sous domination européenne : le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Congo, le Kenya, la Namibie ou encore l’Angola deviennent des « colonies » administrées, exploitées, encadrées.
Les moyens déployés sont sans équivoque : supériorité militaire écrasante (armes à feu, artillerie, logistique), dispositifs de terreur (exécutions sommaires, destructions de villages, répression systématique), usage stratégique de la division entre groupes ethniques ou tribaux. De la résistance de Samory Touré à la guerre du Maji-Maji, les exemples abondent d’un continent qui n’a pas accepté passivement la domination. Mais ces résistances sont étouffées, marginalisées, parfois même retournées contre elles-mêmes par le jeu du recrutement indigène dans les armées coloniales.
La domination ne repose pas seulement sur les armes. Elle s’accompagne de structures administratives d’une redoutable efficacité. La France met en place un système d’administration directe : gouverneurs généraux, cercles coloniaux, chefferies sous contrôle, et un Code de l’indigénat instituant une inégalité de droit entre colonisés et colons. La Grande-Bretagne, dans certaines zones, adopte la stratégie du pouvoir indirect (indirect rule), s’appuyant sur les autorités traditionnelles pour gouverner sans mobiliser trop de ressources. Dans les deux cas, la souveraineté africaine est annulée, les lois sont imposées, les langues européennes deviennent des vecteurs de domination symbolique et juridique.
Ces pratiques sont soutenues par un appareil idéologique puissant. La colonisation, selon les discours européens, n’est pas une entreprise de prédation, mais une « mission civilisatrice ». On prétend instruire, soigner, évangéliser, moraliser. L’Afrique, décrite comme un continent « arriéré », devient le terrain d’une mise en tutelle justifiée par l’écart supposé entre « races civilisées » et « primitifs ». Ce discours permet de masquer les véritables enjeux : contrôler les axes stratégiques (canaux, ports, terres fertiles), sécuriser les sources de matières premières (caoutchouc, coton, or, uranium, huile de palme), et élargir les débouchés commerciaux nécessaires à la croissance industrielle européenne.
Ainsi, du XVIe au XXe siècle, l’exploitation européenne de l’Afrique s’opère selon deux logiques complémentaires : l’extraction humaine d’abord, l’extraction territoriale ensuite. Dans les deux cas, le continent n’est pas intégré à l’économie globale en tant que partenaire, mais asservi comme réservoir. Le projet colonial ne fut ni philanthropique ni passager. Il fut une opération systémique, pensée, outillée, exécutée, avec pour finalité la soumission durable des sociétés africaines à l’intérêt des métropoles européennes.
Mécanismes économiques de la dépossession coloniale
Au-delà de la conquête territoriale et de la domination politique, la colonisation européenne de l’Afrique s’est articulée autour d’une architecture économique de la dépossession. Contrairement au discours de la « mise en valeur » souvent mobilisé dans les archives administratives, les pratiques économiques coloniales ont eu pour finalité première l’appropriation des ressources, l’exploitation de la main-d’œuvre, et la stérilisation durable des capacités d’autonomie économique du continent. Walter Rodney insiste avec force sur cette dimension systémique : les mécanismes de sous-développement ne sont pas des conséquences accidentelles, mais le cœur même du projet colonial.
Après l’abolition formelle de la traite et de l’esclavage, les puissances coloniales instaurent un système de travail forcé à grande échelle, déguisé sous des formes pseudo-légales. Le Code de l’indigénat, en vigueur dans l’Empire français dès 1887, légalise la réquisition de milliers de travailleurs africains, contraints à œuvrer pour les chantiers publics, les exploitations agricoles européennes ou les grandes compagnies concessionnaires.
Ce travail forcé, mal rémunéré voire gratuit, constitue la clef de voûte de l’accumulation coloniale. Il permet, à un coût dérisoire, la construction d’infrastructures stratégiques (routes, voies ferrées, ports) qui ne bénéficient nullement aux économies locales. L’exemple du chemin de fer Congo-Océan, édifié entre 1921 et 1934, est révélateur : entre 15 000 et 30 000 travailleurs y perdront la vie, pour une voie ferrée destinée exclusivement à l’évacuation des ressources vers l’Atlantique.
Parallèlement, l’administration coloniale procède à un accaparement foncier massif. Les terres les plus fertiles sont confisquées au profit des colons ou des entreprises étrangères. En Algérie, au Kenya ou dans le Zimbabwe colonial, les paysans africains sont évincés et refoulés vers des « réserves » souvent improductives. Cette spoliation territoriale s’accompagne de cultures obligatoires d’exportation. L’économie vivrière est sacrifiée au profit du coton, de l’arachide, du café, du cacao ou de l’hévéa, dont la production devient une obligation légale dans certaines régions.
Ces cultures, imposées parfois sous la menace ou la sanction administrative, désorganisent les écosystèmes agricoles et créent une insécurité alimentaire chronique. L’Afrique devient une « plantation géante » tournée vers l’exportation, au seul bénéfice des industries européennes.
À cette dynamique s’ajoute une extraction intensive des ressources naturelles, opérée par des sociétés européennes appuyées par l’administration coloniale. Les mines d’or du Ghana, le cuivre du Katanga, les diamants sud-africains, le caoutchouc du Congo belge, ou encore les bois tropicaux exportés vers l’Europe sont exploités dans des conditions de quasi-servitude. L’économie coloniale n’est pas conçue pour intégrer ou développer les régions africaines, mais pour extraire et transférer la richesse. Les infrastructures (ports, chemins de fer, entrepôts) sont pensées exclusivement en fonction des besoins logistiques de l’exportation, non de la circulation interne ou du commerce africain. L’essentiel de la valeur ajoutée est capté hors du continent : à Londres, à Paris, à Bruxelles.
Ce système repose également sur une fiscalité coloniale coercitive. Les impôts de capitation (comme l’impôt indigène dans l’AOF ou le hut tax dans les colonies britanniques) obligent les populations africaines à se procurer de la monnaie coloniale, bien souvent inaccessible dans une économie de subsistance. Les conséquences sont multiples : monétisation forcée des campagnes, obligation de vendre du bétail ou des produits agricoles à vil prix pour payer l’impôt, et surtout, migration contrainte vers les centres de travail. L’impôt devient ainsi un instrument d’enrôlement indirect de la main-d’œuvre et de contrôle social. Pendant ce temps, les colons et les sociétés européennes bénéficient d’exemptions fiscales et de subventions administratives. L’inégalité est structurelle et institutionnalisée.
Enfin, les colonies sont prises dans un pacte colonial rigide, verrouillant leur économie dans une dépendance complète à la métropole. Les exportations sont orientées vers un seul marché, les importations limitées aux produits manufacturés européens, et toute tentative d’industrialisation est empêchée. Il n’est pas permis de créer des industries locales susceptibles de concurrencer la métropole.
Cette stratégie provoque une désindustrialisation progressive du tissu économique africain. L’artisanat textile, la métallurgie traditionnelle, les ateliers de transformation locale sont supplantés ou détruits. Par exemple, dans de nombreuses régions ouest-africaines, l’arrivée massive de tissus industriels britanniques provoque l’effondrement de la production locale. À long terme, cette logique prive l’Afrique des bases économiques nécessaires à une industrialisation endogène, la maintenant dans un rôle de fournisseur de matières premières brutes, dépendante pour ses besoins les plus élémentaires.
Ainsi, loin d’un simple déséquilibre commercial ou d’une maladresse administrative, l’économie coloniale repose sur un principe fondamental d’extraction unilatérale. L’exploitation de la main-d’œuvre, la confiscation des terres, l’extorsion fiscale et l’étouffement industriel forment un système cohérent, pensé pour empêcher l’émergence de puissances économiques africaines. C’est dans cette structure (coloniale dans sa forme, capitaliste dans sa finalité) que s’inscrit ce que Rodney nomme « le sous-développement », non comme absence de développement, mais comme résultat d’un développement inverse, au profit exclusif de l’Europe.
L’impacts socio-économiques à long terme de la domination coloniale
Si la colonisation européenne s’est officiellement achevée au milieu du XXe siècle, ses effets, eux, perdurent avec une intensité structurelle. Loin d’un simple épisode historique clos, l’ordre colonial a légué à l’Afrique une série d’entraves durables : désorganisations sociales profondes, dépendance économique, retards dans la formation et les infrastructures, ainsi qu’un dualisme interne devenu presque inextricable. L’analyse de Walter Rodney permet de comprendre que ce n’est pas seulement l’Afrique qui a été exploitée, mais aussi son avenir qui a été confisqué.
Le premier impact notable est la désorganisation des sociétés africaines, en particulier au niveau de leurs structures familiales, sociales et productives. Le travail forcé et les déplacements massifs de main-d’œuvre masculine vers les mines, les chantiers ou les plantations ont bouleversé l’organisation traditionnelle des communautés. L’économie de subsistance, centrée sur la famille élargie, a été marginalisée ; les femmes se sont retrouvées seules à maintenir les cultures vivrières pendant que les hommes travaillaient à des centaines de kilomètres dans des conditions souvent proches du servage.
Cette dislocation du tissu social a eu des conséquences durables : affaiblissement du lien intergénérationnel, déracinement culturel, fragilité des solidarités communautaires, et, à terme, vulnérabilité aux crises internes et aux conflits sociaux. Le déséquilibre introduit par cette fracture structurelle continue d’entraver les tentatives d’un développement endogène cohérent après les indépendances.
Sur le plan économique, la colonisation a enfermé l’Afrique dans une dépendance structurelle et une extraversion économique dont elle peine encore à se libérer. À l’indépendance, les économies africaines étaient presque exclusivement tournées vers l’exportation de quelques matières premières (café, coton, cacao, pétrole, minerais), dont les cours sont fixés sur les marchés mondiaux, donc volatils et incertains. À l’inverse, les biens manufacturés, les machines, les véhicules et même les produits de base de consommation courante continuent d’être importés à grands frais.
Cette asymétrie, consolidée par les accords économiques postcoloniaux (comme ceux du Franc CFA en Afrique francophone), maintient un rapport inégal avec l’ancien colonisateur. L’absence de transformation locale des matières premières, combinée à une balance commerciale déficitaire chronique, piège les pays africains dans un cycle d’endettement et de sous-investissement.
Cette dépendance est aggravée par un dualiste économique hérité du système colonial. Le modèle économique mis en place par les administrations européennes distinguait deux sphères distinctes : un secteur « moderne » (mines, plantations, ports, infrastructures) contrôlé par les colons ou leurs relais économiques, et un secteur « traditionnel » ou « informel » ; essentiellement rural, vivrier, non intégré au circuit marchand dominant.
Cette coupure s’est perpétuée : les grandes villes, pôles industriels ou ports restent connectés aux flux mondiaux, tandis que les campagnes, où vit encore la majorité de la population, demeurent isolées, sous-équipées et mal desservies. L’État postcolonial hérite de cette dichotomie : les politiques publiques favorisent les zones urbaines et les pôles exportateurs, souvent au détriment des régions rurales, créant des inégalités internes profondes et un marché intérieur morcelé.
Par ailleurs, le legs colonial est aussi infrastructurel et humainement déficient. Les routes, les lignes ferroviaires et les réseaux de communication construits par les colonisateurs ne visaient qu’un objectif : relier les points d’extraction (mines, plantations) aux ports d’exportation. Très peu de connexions interrégionales ont été mises en place, rendant difficile, après les indépendances, la construction d’un marché national intégré. De plus, les investissements dans l’éducation et la santé ont été minimalistes. Seule une élite étroite, formée pour les besoins de l’administration coloniale, a eu accès à l’enseignement secondaire ou supérieur. En 1960, l’ensemble de l’Afrique occidentale française comptait moins de 1 000 diplômés de l’université.
Ce déficit de formation a lourdement pénalisé la capacité des jeunes États à encadrer leur développement : la pénurie d’ingénieurs, de médecins, de juristes ou de gestionnaires a laissé le champ libre aux experts étrangers ou aux entreprises multinationales, prolongeant ainsi la dépendance technologique.
Enfin, ces déséquilibres accumulés ont produit une pauvreté structurelle et des inégalités sociales persistantes. Contrairement au récit d’un progrès colonial graduel, les chiffres montrent un continent appauvri par la captation de ses richesses et l’exclusion de ses populations des circuits de décision et de bénéfice économique. Les colonies ont financé les métropoles ; jamais l’inverse. Le développement des villes européennes, de leurs banques, de leurs industries, a souvent été rendu possible par les transferts massifs de capitaux, de ressources naturelles et de main-d’œuvre prélevés sur l’Afrique.
Ce déséquilibre fondateur se retrouve, aujourd’hui encore, dans la structure des revenus : une minorité (souvent urbaine, connectée à l’économie globale et parfois proche des anciennes puissances) concentre la richesse, tandis que la majorité vit avec des revenus inférieurs aux seuils de pauvreté définis par les normes internationales. Le sous-développement, tel que le conceptualise Rodney, est donc moins un échec endogène qu’un projet réussi de dépossession systémique.
Ainsi, l’entreprise coloniale n’a pas seulement organisé l’Afrique autour de l’exploitation : elle a aussi miné les fondations d’un développement autonome. En sabotant les structures sociales, en empêchant l’industrialisation, en imposant une spécialisation déséquilibrée, elle a façonné des économies vulnérables, incapables de résister aux chocs extérieurs. Le continent ne souffre pas d’un manque de richesses, mais d’une architecture historique du pillage dont les effets se répercutent encore aujourd’hui. Revenir sur ces mécanismes, c’est comprendre pourquoi tant de pays africains, malgré leurs ressources, peinent encore à sortir du cycle de la pauvreté.
Héritage contemporain et perspectives postcoloniales
Après les indépendances des années 1950 à 1970, l’Afrique entre officiellement dans l’ère postcoloniale, mais l’analyse rigoureuse des dynamiques économiques et politiques montre une persistance profonde des logiques de domination héritées de la colonisation. Les nouveaux États, bien que souverains en apparence, restent largement enchâssés dans des structures néocoloniales. Les zones monétaires, comme celle du franc CFA toujours arrimé à une monnaie européenne, témoignent de la continuité d’une dépendance financière façonnée sous la tutelle impériale.
De nombreux secteurs stratégiques (énergie, mines, agriculture d’exportation) demeurent sous le contrôle de groupes occidentaux ou étrangers, prolongeant sous une forme assouplie mais tout aussi contraignante l’accaparement des richesses locales. Le rapport de force s’est déplacé du militaire vers le diplomatique, du canon vers le contrat, mais l’asymétrie reste intacte.
La tâche des jeunes nations africaines s’est alors révélée d’une complexité redoutable. Les frontières issues du découpage impérial, souvent incohérentes sur le plan humain ou géographique, ont accouché d’entités politiques instables, traversées de tensions internes. Les conflits postcoloniaux, qu’ils soient ethniques, séparatistes ou économiques, puisent fréquemment leur origine dans ce morcellement artificiel.
Sur le plan économique, la situation n’est guère plus favorable. La spécialisation coloniale (exportation de matières premières, importation de produits finis) a laissé en héritage des économies désarticulées, dépourvues d’une base industrielle robuste et incapables de répondre aux besoins internes. Pour s’en extraire, il faudrait des investissements massifs dans les infrastructures, l’éducation, la recherche, la santé ; autant de chantiers minés par l’endettement structurel hérité du départ des puissances coloniales.
À défaut de capital accumulé, nombre d’États africains se sont tournés vers les prêts extérieurs et les programmes d’aide internationale. Mais ceux-ci, souvent conditionnés par les anciens colonisateurs ou par les institutions dominées par les puissances occidentales, ont rarement permis une transformation en profondeur des structures économiques. Les ajustements structurels imposés dans les années 1980, la libéralisation forcée, les privatisations massives ont surtout contribué à affaiblir encore davantage les marges de manœuvre des États africains. La dette publique devient à la fois une charge budgétaire insoutenable et un instrument de pression politique, prolongeant par d’autres moyens l’ingérence étrangère dans les affaires africaines.
Face à cette impasse, des tentatives d’émancipation apparaissent. Certaines consistent à renforcer la coopération régionale et continentale, comme en témoignent l’Union africaine ou les zones de libre-échange en construction. D’autres relèvent de la revalorisation des ressources locales : campagnes de nationalisation, contrôle accru sur les matières premières, renégociation des contrats miniers. En parallèle, un mouvement de réappropriation historique s’amorce : restitution des patrimoines culturels pillés, réécriture de l’histoire économique du continent. Des penseurs comme Walter Rodney ont jeté les bases d’une lecture offensive et critique du passé colonial : démontrer que le sous-développement africain n’est pas le fruit d’une incompétence intrinsèque, mais bien le résultat d’un processus d’exploitation organisé.
Ce diagnostic, aussi sévère que précis, ne doit pas pour autant conduire au fatalisme. Rodney lui-même insiste : si l’Europe a bâti sa puissance sur le dos de l’Afrique, celle-ci conserve les moyens de forger son propre avenir. Encore faut-il sortir de l’emprise symbolique et économique de l’ancien ordre colonial. Il ne s’agit pas de rejouer sans fin le procès du passé, mais de comprendre, avec lucidité et méthode, comment ce passé a structuré le présent. C’est à cette condition que le continent africain pourra redevenir maître de ses trajectoires et acteur de son développement, en rompant enfin avec les chaînes visibles et invisibles de la dépossession.
Notes et références
- Rodney, Walter. How Europe Underdeveloped Africa. Bogle-L’Ouverture Publications, 1972.
- Amin, Samir. Le développement inégal : essai sur les formations sociales du capitalisme périphérique. Éditions de Minuit, 1973.
- Suret-Canale, Jean. Afrique noire occidentale et centrale : des origines à la conquête coloniale. Éditions Sociales, 1961.
- Coquery-Vidrovitch, Catherine. Afrique noire : permanences et ruptures. Payot, 1985.
- Bernal, Martin. Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classical Civilization. Rutgers University Press, 1987.
- Gann, Lewis H. & Duignan, Peter. The Rulers of British Africa, 1870–1914. Stanford University Press, 1978.
- Nzouankeu, Jacques Mariel. Les partis politiques africains. Présence Africaine, 1984.
- Nkrumah, Kwame. Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism. Thomas Nelson, 1965.
- Cooper, Frederick. Africa Since 1940: The Past of the Present. Cambridge University Press, 2002.
- Mbembe, Achille. Sortir de la grande nuit : Essai sur l’Afrique décolonisée. La Découverte, 2010.
- Fall, Babacar. Le travail forcé en Afrique occidentale française (1900–1946). Karthala, 1993.