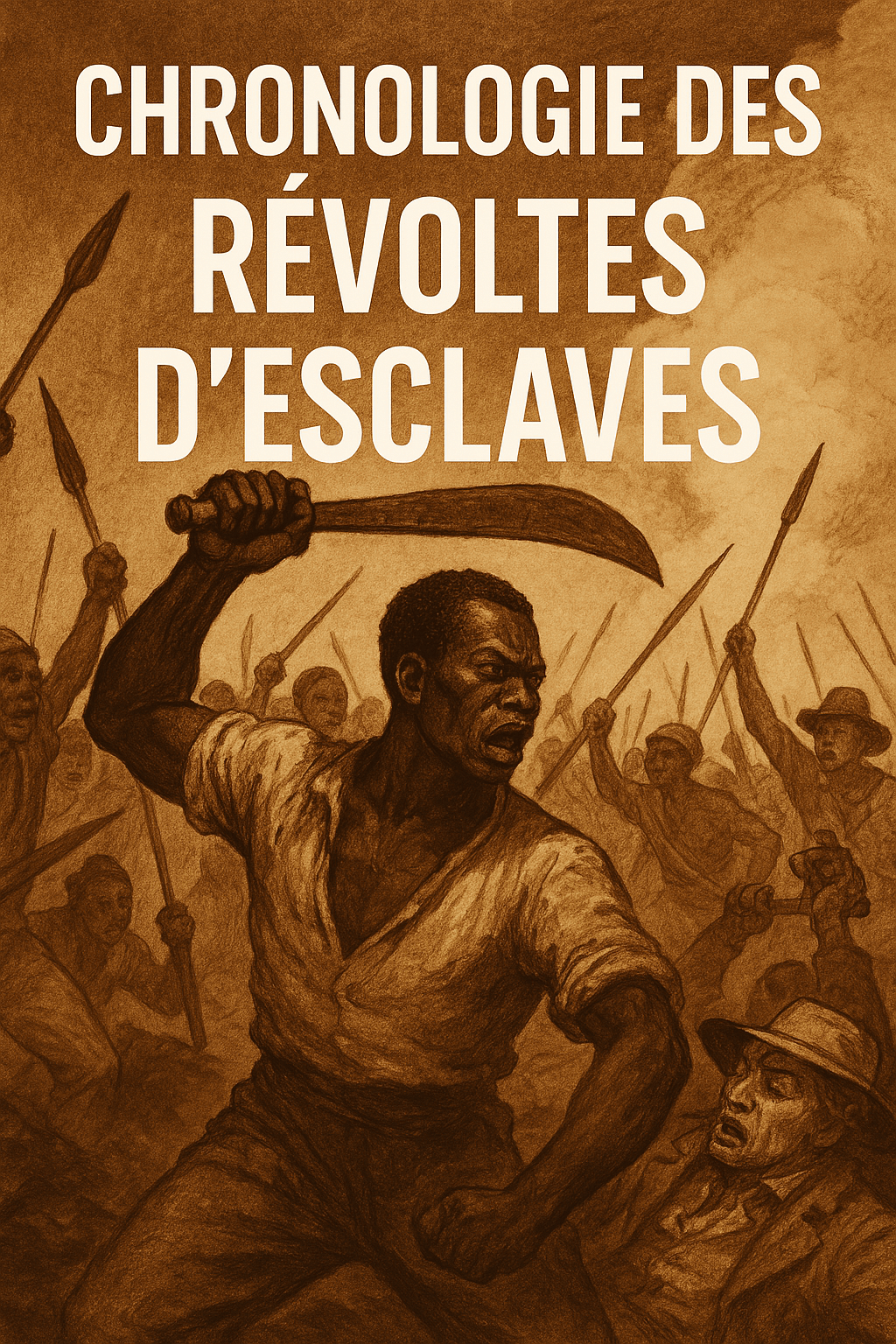En 1944, la France retire ses soldats africains des lignes de front, effaçant leur rôle dans la Libération. Découvrez l’histoire du « blanchiment » des troupes coloniales.
L’effacement des soldats noirs de la Libération française

À l’automne 1944, alors que Paris acclame ses libérateurs et que les Champs-Élysées résonnent des clameurs de la victoire, une autre scène se joue dans l’ombre des projecteurs de la gloire. Sur les routes humides du Sud de la France, loin des caméras et des honneurs, des colonnes entières de soldats noirs, épuisés par des mois de combats, sont discrètement relevées de leurs fonctions. Ces hommes, venus d’Afrique-Occidentale française, du Tchad, du Sénégal ou du Cameroun, avaient pourtant versé leur sueur et leur sang pour la France. On les appelait les tirailleurs sénégalais, bien que peu d’entre eux fussent sénégalais. Et sans tambour ni trompette, ils furent écartés des premières lignes.
C’est ce que l’histoire officielle appellera plus tard le « blanchiment des troupes coloniales ». Une expression technique, presque neutre, mais qui dissimule un acte politique lourd de symboles : remplacer les soldats noirs par des combattants blancs issus des Forces françaises de l’intérieur (FFI), au nom d’une nouvelle mise en scène de la Libération. Ce remplacement n’était ni anodin ni logistique. Il était orchestré. Organisé. Silencieux. Invisibilisant.
À l’heure des photographies triomphales, la République renaissante ne voulait pas des visages d’Afrique pour illustrer son retour à la lumière. Dans une France en reconstruction, la mémoire devait elle aussi être reconfigurée. Et les soldats de l’Empire, qui avaient porté l’uniforme avec fierté, furent tout simplement effacés du cadre.
Mais cette histoire ne saurait rester en marge des récits héroïques. Car elle interroge la manière dont une nation traite ses défenseurs. Elle raconte la violence d’une reconnaissance différée, et le poids d’une mémoire raciale tue au profit d’un roman national blanc. Elle invite, enfin, à regarder en face les cicatrices d’un passé que trop d’archives, de discours et de silence ont tenté d’ensevelir.
Les tirailleurs sénégalais, ces combattants de l’ombre

Ils venaient de Saint-Louis, de Bamako, de Ouagadougou ou de Brazzaville. Ils n’avaient souvent jamais vu la mer. Et encore moins foulé la terre froide de la Provence. Mais ils étaient là. Casque enfoncé sur le front, baïonnette au canon, entonnant parfois un chant en langue wolof, bamanan ou ewe pour conjurer la peur. Ces hommes, qu’on appelait tous « tirailleurs sénégalais » (bien qu’ils vinssent de tout l’empire colonial d’Afrique) formaient l’ossature d’une armée française renaissante, forgée dans les cendres de l’humiliation de 1940.
Leur engagement dans la Seconde Guerre mondiale n’était ni anecdotique, ni secondaire. Il était massif, décisif, mais souvent relégué à l’arrière-plan des récits nationaux. Dès les premières années de la guerre, alors que la métropole est occupée et que Vichy pactise, les territoires africains ralliés à la France libre deviennent un vivier de recrutement. Sous le commandement du général Leclerc et avec le soutien de Félix Éboué, les forces africaines (notamment les troupes issues de l’Afrique-Équatoriale française) prennent part aux campagnes du Fezzan, de Libye, de Tunisie.
Mais c’est en août 1944, lors du débarquement de Provence, que leur rôle devient incontournable. La 1ère Armée française du général de Lattre de Tassigny compte alors environ 260 000 hommes, dont près de 130 000 issus des colonies africaines. Parmi eux, plus de 20 000 tirailleurs africains sont envoyés en première ligne. Ils avancent sous le feu, libèrent Toulon, Marseille, remontent la vallée du Rhône, participent aux durs combats des Vosges, puis à la percée finale vers l’Allemagne.
Ces hommes sont aguerris, expérimentés. Beaucoup ont déjà combattu en 1939-1940 ou dans les troupes coloniales. Ils connaissent la rudesse du front, l’injustice des rations inégales, la brutalité des commandements. Ils combattent pour une patrie qui, bien souvent, ne les considère pas comme ses fils. Mais ils avancent tout de même. Pour l’honneur. Pour les leurs. Pour une promesse que la République semblait leur chuchoter ; celle d’une reconnaissance, enfin.

Leur sacrifice ne se limite pas à la guerre. Certains ont été prisonniers de guerre en 1940, parqués dans des stalags allemands dans des conditions inhumaines. D’autres ont vu leurs compagnons massacrés, comme ce fut le cas à Chasselay, en 1940, où une colonne de tirailleurs a été exécutée par les nazis parce qu’ils étaient noirs.
Et pourtant, au moment des premières victoires françaises sur le sol métropolitain, leurs noms ne figurent pas sur les discours. Leurs visages ne sont pas dans les photos officielles. Ils sont là, sur les lignes de front, mais absents des lignes de l’Histoire. Des combattants de l’ombre, à qui l’on demande de mourir pour une patrie que l’on peine à leur accorder.
Ce paradoxe brutal est d’autant plus criant que ces tirailleurs étaient perçus par certains officiers français comme plus efficaces, plus disciplinés et plus résistants que les recrues métropolitaines issues de la Résistance intérieure. Et pourtant, c’est à eux qu’on demandera, quelques semaines plus tard, de céder leur place.
Le « blanchiment », une stratégie d’effacement
À la fin de l’été 1944, les routes de France sont jonchées de ruines, de silences et de chants de victoire. Mais dans les replis de cette liesse, une autre histoire se joue. Une histoire que la République n’a pas chantée. Alors même que les troupes africaines remontent vers l’Alsace, qu’elles délogent les derniers bastions allemands, qu’elles paient encore un tribut de sang sur les pentes des Vosges, une décision politique et raciale va venir effacer leur victoire. C’est ce qu’on appelle, dans les termes froids de l’administration militaire, le « blanchiment » des troupes coloniales.
À partir de septembre 1944, des ordres venus du haut commandement, en concertation avec les forces alliées, imposent le retrait progressif des tirailleurs sénégalais et autres soldats noirs de la 1ère Armée française. Dans les régiments de première ligne, on remplace les combattants africains par des recrues blanches, issues des Forces françaises de l’intérieur (FFI). Ces nouveaux venus, souvent moins formés, moins aguerris, prennent la relève des vétérans coloniaux. Les soldats noirs sont redéployés vers le Sud, affectés à des tâches de logistique, d’intendance, ou simplement rapatriés, sans fanfare ni adieu.
Dans certaines unités, la scène est surréaliste. Des tirailleurs, couverts de gloire et de cicatrices, doivent déposer leurs armes et remettre leurs équipements flambants neufs (symboles de leur courage) à des civils blancs à peine formés, parfois hostiles à leur présence. Le déshabillage est littéral. On retire l’uniforme comme on efface un nom, une mémoire, une dette. Les anciens de la 9e Division d’infanterie coloniale en témoignent avec amertume : « Ce jour-là, on nous a rendus invisibles. »
Ce processus de « blanchiment » n’est ni une coïncidence ni un simple réajustement militaire. C’est une décision stratégique, nourrie par des considérations politiques, sociales et raciales. L’armée américaine, ségréguée jusqu’en 1948, refuse la présence de troupes noires aux portes de l’Europe libérée, craignant l’image d’une armée « trop noire » entrant triomphalement dans Paris ou dans Berlin. Le mémo du général américain Walter B. Smith, en janvier 1944, ne laisse guère de place au doute : les soldats noirs doivent être séparés des troupes blanches, comme c’est le cas dans les régiments américains.
Mais les pressions ne viennent pas que des alliés. Le pouvoir français lui-même, soucieux de restaurer une République blanche et souveraine, se montre complice de cet effacement. Le général de Gaulle, homme de vision mais aussi stratège du réel, cherche à rallier la Résistance intérieure et à renforcer le sentiment d’unité nationale. Or, dans l’imaginaire collectif français de l’époque, la présence massive de troupes africaines à la Libération pourrait brouiller le récit d’une France qui s’est « libérée elle-même ».
Pour justifier ce retrait, on convoque des raisons plus acceptables. Le climat. Le froid. Le moral des troupes. Les gelures. Les désirs de rapatriement. On parle d’humanité. On parle de stratégie. Mais dans les faits, cette opération est vécue par les tirailleurs comme une trahison. Eux qui ont versé leur sang pour la France sont exclus du récit final. Ils ne défileront pas sur les Champs-Élysées. Ils n’apparaîtront pas sur les photos de Paris libérée. À l’exposition sur la Libération au musée Carnavalet, aucun visage noir ne figure sur les clichés. Un oubli trop précis pour être innocent.
Ce blanchiment est aussi une manière de restaurer l’ordre colonial. Car la guerre a tout bouleversé. Des Noirs ont commandé. Des indigènes ont libéré des Blancs. Des soldats africains ont partagé le pain avec des soldats français. Dans la boue, sous les obus, la hiérarchie raciale avait été suspendue. Or, le pouvoir colonial ne pouvait le tolérer trop longtemps. L’ordre devait revenir. Et cela passait par un effacement soigneusement orchestré.
Dans son documentaire Le blanchiment des troupes coloniales, le réalisateur Jean-Baptiste Dusséaux évoque cette mécanique d’invisibilisation avec lucidité : l’armée française préféra se priver de vingt mille combattants aguerris plutôt que d’assumer la diversité de ses libérateurs. Ce choix tragique a laissé une trace durable : celle d’un silence, d’un oubli, d’une dette morale que l’Histoire peine encore à solder.
Les motivations derrière le retrait

L’histoire officielle a longtemps recouvert le blanchiment des troupes coloniales d’un voile de rationalités militaires. On a parlé de logistique, de fatigue, de réalignement stratégique. Mais en grattant ce vernis, on découvre les véritables rouages d’un effacement délibéré, inscrit à la fois dans les rapports de force internationaux, la peur des métissages symboliques et le maintien d’un empire en déclin. Car ce retrait n’est pas seulement une opération tactique. C’est un choix politique, culturel et racial.
En janvier 1944, un mémo confidentiel signé du général Walter Bedell Smith, chef d’état-major du général Eisenhower, arrive sur les bureaux français. Le ton est direct : il est recommandé que les forces françaises limitent la présence de soldats noirs dans les unités opérant aux côtés des troupes américaines. Le contexte ? L’armée américaine elle-même est encore structurellement ségréguée : les soldats afro-américains ne combattent pas aux côtés des Blancs. Ils sont cantonnés à des tâches d’intendance, de ravitaillement, de transport. Leur engagement est reconnu… à condition qu’il reste invisible.
Dans ce système, l’idée que des soldats noirs (africains, de surcroît) puissent libérer des villes européennes, marcher triomphalement dans Paris, rencontrer les populations civiles, est un affront à l’ordre racial des États-Unis. Le Haut Commandement allié fait pression, et la France, qui cherche encore à restaurer sa légitimité dans la coalition, s’aligne. Le blanchiment devient alors une concession diplomatique, un gage donné à une Amérique blanche qui ne veut pas troubler l’image d’une Europe libérée par des forces « acceptables ».
Mais l’initiative ne vient pas uniquement des alliés. Elle naît aussi d’un réflexe français profondément ancré : celui de préserver l’ordre colonial. La guerre a fait voler en éclat la séparation géographique et symbolique entre colonisateurs et colonisés. Des tirailleurs africains ont porté les couleurs de la République. Ils ont libéré Marseille, Toulon, Lyon. Ils ont connu l’égalité des tranchées. Certains ont vu leur autorité reconnue, leurs compétences saluées, leur héroïsme admiré.
Et cela inquiète.
Les élites françaises redoutent que ce prestige militaire ne se transforme en revendications politiques ou sociales. Que ces soldats, revenus sur le sol africain après avoir combattu pour la « patrie des droits de l’homme », exigent à leur tour égalité, citoyenneté, représentation. Comment leur refuser ? Comment maintenir l’indigénat après les avoir appelés « frères d’armes » ? Pour beaucoup dans l’establishment colonial, le retrait des tirailleurs est un moyen de remettre chacun « à sa place ».
Plus subtilement, le retrait permet de reconstruire un récit national centré sur la Résistance blanche, intérieure, « gaullienne », un récit de renaissance qui évacue les figures coloniales du paysage héroïque. La France devait se reconstruire, mais sans ces visages qui rappelaient trop les ambiguïtés de son empire.
L’une des explications les plus souvent avancées est celle du climat. L’hiver européen, dur, humide, glacial, aurait fragilisé les soldats africains, peu préparés (dit-on) aux conditions extrêmes des Vosges ou de l’Alsace. On évoque les gelures, les rhumes persistants, la baisse de moral. On pointe des chiffres : plus de 300 cas de gelures recensés en une journée au sein de la 1ère DMI, le 10 octobre 1944.
Mais cette justification ne tient pas.
D’abord parce que ces soldats avaient déjà combattu en France durant la Première Guerre mondiale, dans la boue des tranchées, sous les pluies de la Marne, dans des conditions pires encore. Ensuite parce que les pertes humaines causées par le froid n’étaient pas supérieures à celles des autres régiments. Enfin, parce que les tirailleurs eux-mêmes n’étaient pas demandeurs de retour, mais espéraient au contraire participer jusqu’au bout à la libération d’un pays qu’ils avaient contribué à défendre.
Derrière cet argument médical se cache un choix politique. Le climat devient un alibi commode pour maquiller une décision profondément raciale. Et dans les rapports militaires internes, les phrases trahissent une autre vérité : celle de la peur de mélanges symboliques. Le contact entre soldats noirs et populations blanches (notamment les femmes) est perçu comme une menace à l’ordre moral. Des incidents réels ou exagérés survenus en Italie nourrissent ces craintes.
Privés de leurs armes, évincés des champs d’honneur, les tirailleurs sénégalais n’ont pas eu le droit au mot de la fin. Aucune consultation, aucun discours. Leur retrait fut administratif, sec, anonyme. Dans certains cas, ils durent eux-mêmes céder leurs uniformes aux nouvelles recrues FFI, jeunes Français blancs fraîchement enrôlés. Ils furent dispersés dans des régiments de maintenance, puis rapatriés par bateaux vers Dakar, Bamako, Conakry. Certains ne comprirent jamais pourquoi. D’autres en gardèrent une colère sourde, transmise à leurs enfants et petits-enfants.
Leur silence fut celui de la République. Ni reconnaissance, ni pension équitable, ni décoration publique. Juste le vide. Le blanchiment fut plus qu’un retrait militaire : ce fut une opération de blanchiment mémoriel. Un gommage méthodique de visages, de noms, de parcours héroïques.
Conséquences et mémoire effacée
Effacer un soldat, ce n’est pas le désarmer. C’est le désincarner. C’est ôter son nom du récit national, le reléguer dans les marges de l’histoire, là où s’entassent les silences d’État. Le blanchiment des troupes coloniales, plus qu’une simple opération militaire, a engendré une invisibilisation systématique, un bannissement symbolique qui continue, aujourd’hui encore, à hanter les mémoires des diasporas africaines et afrodescendantes.
Lorsque Paris est libérée, les caméras s’installent sur les Champs-Élysées. Elles capturent la liesse, les drapeaux, les accolades. Elles immortalisent les hommes du général Leclerc, les figures blanches de la Résistance, les héros de la Libération. Mais sur ces images d’archives devenues mythiques, les visages noirs sont absents. Comme s’ils n’avaient jamais combattu. Comme si la République s’était libérée d’elle-même, sans l’aide de ceux qu’elle envoyait mourir pour sa liberté.
La mise à l’écart des tirailleurs sénégalais lors des défilés de la victoire n’est pas un oubli accidentel. C’est un acte de communication politique. Il fallait reconstruire une image héroïque, homogène, blanche, d’une France résistante et victorieuse. L’empire colonial, pourtant si présent dans les faits, devait être gommé dans la forme. Ce déni d’apparition publique a eu des effets durables : pendant des décennies, les manuels scolaires, les commémorations, les statues, ont reproduit cette même cécité.
Et ce qui ne se montre pas finit par ne plus exister.
Mais les hommes n’oublient pas. Et dans les ports où on les débarque, dans les casernes où on les parque, les tirailleurs murmurent, puis grondent. Ils ont tout donné, et ne reçoivent que l’ombre d’une reconnaissance. À leur retour, leurs soldes sont amputées, leurs pensions rognées, leur dignité piétinée. Pire encore : certains sont à nouveau internés. Soupçonnés de révolte, surveillés comme des corps subversifs.
C’est à Thiaroye, au Sénégal, en décembre 1944, que la tension atteint son point de rupture. Des centaines d’anciens combattants, exaspérés par le traitement injuste qui leur est réservé, se rassemblent pour réclamer leur dû. L’État français, au lieu d’écouter, choisit de réprimer.
Le massacre de Thiaroye, dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre, reste l’une des pages les plus sombres et les plus honteuses de l’histoire militaire française. Le nombre de morts exact demeure incertain (l’ombre administrative pèse encore), mais les témoignages évoquent plusieurs dizaines de tirailleurs exécutés froidement par l’armée française, sur le sol africain, après avoir servi la France.
Ce drame n’est pas seulement une tragédie. Il est le symptôme d’un double abandon : militaire et mémoriel. Ces hommes, venus défendre la République, furent tués pour avoir osé demander justice.
Il a fallu attendre le tournant du XXIe siècle pour que la République commence, timidement, à rouvrir le dossier. Des documentaires, des travaux universitaires, des romans, des artistes se sont emparés de ce pan occulté de l’histoire. Le cinéma s’est invité, parfois avec pudeur, parfois avec fracas, pour réveiller les consciences endormies. Des voix se sont élevées pour rappeler que l’histoire de la France ne pouvait se construire sur l’effacement de ceux qui l’ont libérée.

En 2006, Jacques Chirac reconnaît publiquement le massacre de Thiaroye. En 2010, les pensions des anciens combattants coloniaux sont enfin alignées sur celles de leurs homologues français. Mais beaucoup sont déjà morts. Beaucoup n’ont rien vu de ce geste tardif, trop souvent perçu comme une aumône posthume.
Aujourd’hui encore, le nom des tirailleurs sénégalais n’est pas inscrit dans toutes les écoles, les rues, les mémoriaux. Leur trace subsiste dans quelques stèles, dans quelques cérémonies du 11 novembre. Trop peu pour ceux qui ont versé leur sang sur les plages de Provence, dans les neiges des Vosges ou dans les campagnes de Lorraine.
Et pourtant, ils sont là.
Ils sont dans les chants de leurs petits-enfants, dans les combats pour l’égalité, dans les mémoires transgénérationnelles de la diaspora. Ils sont dans chaque silence qu’on refuse d’accepter, chaque hommage qu’on exige, chaque ligne d’histoire qu’on réécrit.
Sources
- Julien Fargettas, Les tirailleurs sénégalais : les soldats noirs entre légendes et réalités, 1939-1945, Tallandier, 2012.
- Claire Miot, Le retrait des tirailleurs sénégalais de la Première Armée française en 1944, Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 2015.
- Jean-Baptiste Dusséaux, Le Blanchiment des troupes coloniales, documentaire, France 3, 2015.
- Article « Blanchiment des troupes coloniales« , Wikipédia.
Sommaire