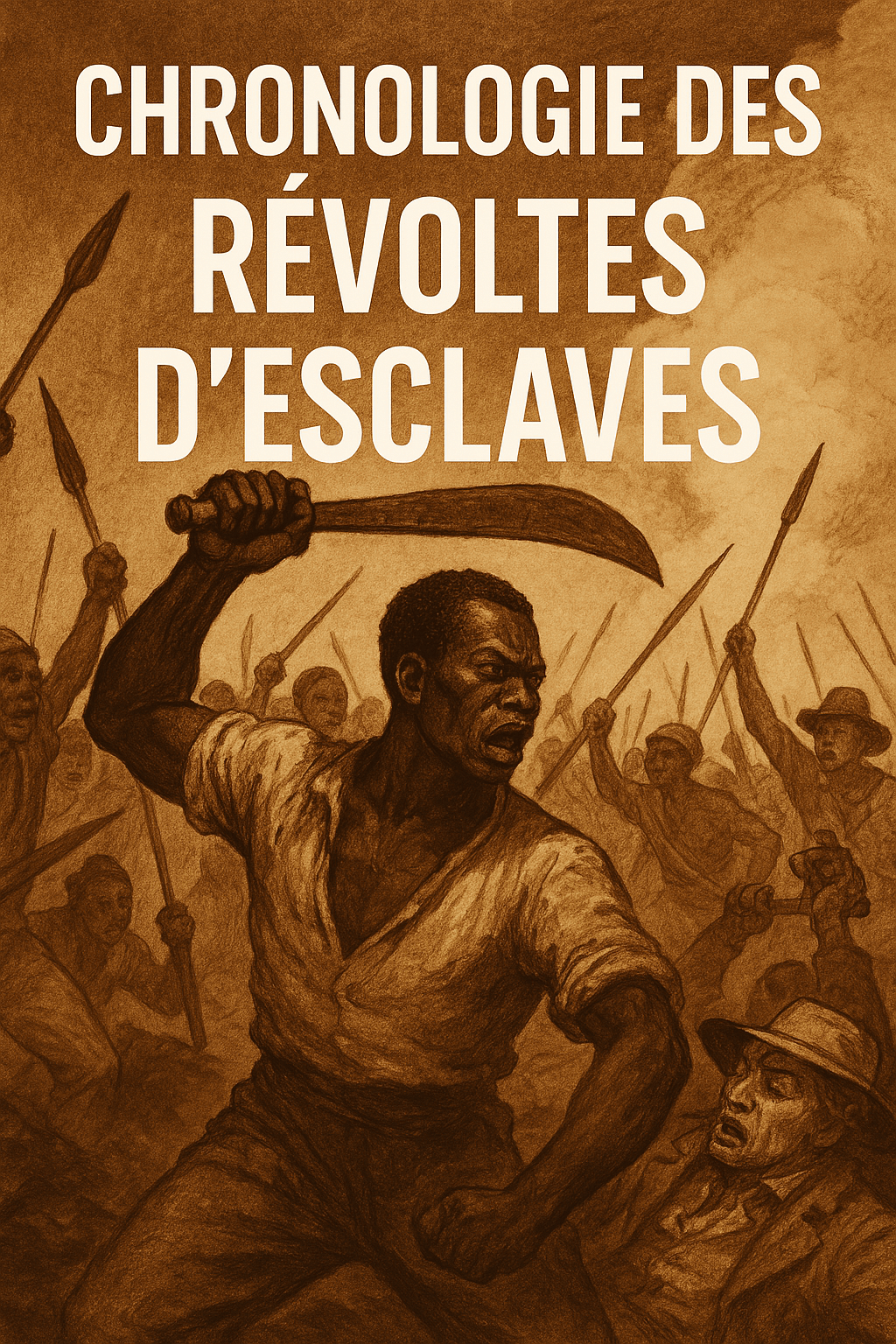À l’heure où les récits fondateurs africains peinent à se faire entendre dans le tumulte de l’histoire mondiale, la Charte du Mandé (proclamée au XIIIe siècle selon la tradition orale) revient comme un souffle ancien aux accents modernes. Texte mythique ou manifeste politique ? De Kouroukan Fouga aux rues de Kayes, en passant par les couloirs de l’UNESCO, Nofi interroge la portée d’un serment qui revendiquait la dignité humaine bien avant les Lumières. Entre exaltation symbolique et controverse académique, une plongée critique dans ce que certains appellent déjà “la première déclaration des droits de l’homme”.
À l’ombre de Kouroukan Fouga : une parole enfouie
Ils disent que tout a commencé par un serment, prononcé les mains pleines de poussière et d’avenir.
Au pied d’un vieux baobab, quelque part entre Kangaba et les confins de la savane, un griot égrène les mots comme on tisse des sorts. Sa voix, rythmée par le balancement du corps et le martèlement d’un tambour doux, traverse l’air du crépuscule. Autour de lui, le vent soulève la terre rouge, mêlant les odeurs de mil, de feu de bois et de mémoire.
L’homme parle, ou plutôt chante. Il dit le nom de Soundiata Keïta, l’enfant boiteux devenu roi des rois. Celui qu’on croyait condamné à ramper mais qui fit plier les trônes. Il raconte comment, au lendemain de la victoire contre Soumaoro Kanté, les peuples du Mandé se rassemblèrent sur la plaine de Kouroukan Fouga. Là, entre les mains jointes des sages et les flèches croisées des chasseurs, fut énoncée une parole ; pas un décret, pas une loi gravée dans le marbre, mais un souffle porté par la tradition orale : une charte.
On dit que cette charte abolissait l’esclavage. Qu’elle affirmait la dignité humaine. Qu’elle interdisait la faim, la guerre de razzia, le mépris du faible. Qu’elle reconnaissait à chacun le droit d’être maître de soi, libre dans ses actes et gardien de son propre travail. Un manifeste d’égalité, avant l’heure, bien avant les Lumières, avant 1789, avant la Déclaration universelle.
Mais que vaut une parole ancienne dans un monde moderne ? Une charte non écrite peut-elle encore nous parler, nous troubler, nous guider ? Peut-on croire qu’un empire africain, au XIIIe siècle, ait rêvé des droits humains ; non comme une invention, mais comme une évidence ?
À l’ombre du baobab, le griot continue de dire. Et dans chaque syllabe, quelque chose d’inouï pulse sous les siècles : une promesse de justice, murmurée dans la poussière.
Genèse politique d’une mémoire orale
Il n’y a pas de parchemin. Pas de sceau royal. Pas de manuscrit jauni retrouvé dans une cave de monastère. Ce que nous appelons “Charte du Mandé” n’est ni un acte notarié ni une constitution au sens occidental du terme. C’est une mémoire portée par le souffle. Un texte de feu, transmis de gorge en gorge, de griot en griot, comme une braise qu’on ravive à chaque génération.
La scène fondatrice, elle aussi, est chantée plus qu’écrite. Kouroukan Fouga, l’an 1236. Soundiata Keïta, auréolé de sa victoire sur le roi sorcier Soumaoro, convoque les peuples du Mandé. Là, sur cette vaste plaine devenue agora, s’assemblent les chefs de clan, les chasseurs, les forgerons, les anciens. Tous les piliers d’une société encore mal cicatrisée par des années de guerre. Ce jour-là, entre les applaudissements des vents et la vigilance des ancêtres, on prononce ce que l’on retiendra plus tard comme une charte : quarante-quatre articles, dit-on, qui tracent les lignes d’une société fondée non pas sur la conquête, mais sur le pacte.
Les mots frappent fort, simples et radicaux :
“La faim n’est pas une bonne chose, l’esclavage non plus.”
C’est la phrase qui revient le plus souvent. Elle claque comme une sentence et s’élève comme une prophétie. On y entend le cri de ceux qui furent pris dans les chaînes, la promesse de ceux qui refusent de voir recommencer le cycle du mépris.
Ce texte est tout sauf neutre. Il pose des bornes : à la guerre de razzia, à la privation de liberté, à la déshumanisation du semblable. Il affirme aussi des droits subtils, presque inaudibles si on n’y prête pas attention : le droit à la parole, le droit de se mouvoir, le droit de posséder le fruit de son labeur. Rien qui ne soit juridiquement normé, mais tout ce qui fait l’ossature d’une société juste.
Pour certains, cette charte n’est qu’une fiction tardive, réécrite à la lumière des idéaux modernes. Pour d’autres, elle est la preuve que l’Afrique n’a jamais attendu les Lumières pour penser le droit, la dignité et la paix.
Entre ces deux feux, reste une certitude : dans un monde façonné par la domination coloniale et l’effacement des savoirs africains, cette parole ressuscitée dérange. Elle dérange parce qu’elle suggère que les peuples africains n’étaient pas seulement dans l’histoire, mais dans la pensée politique. Et que cette pensée, bien que transmise sans plume ni papier, portait déjà en elle les germes d’une justice universelle.
Et si la première déclaration des droits de l’homme était africaine ?
Et si tout ce que l’on croyait savoir sur l’origine des droits humains devait être repensé ? Si le chant du griot précédait les imprimeries parisiennes, si la parole malinké avait murmuré “égalité” avant que les révolutionnaires de 1789 ne l’écrivent à l’encre noire sur parchemin blanc ? L’idée dérange, elle agite les certitudes. Pourtant, elle s’impose peu à peu, non comme une vérité historique absolue, mais comme une possibilité crédible, presque poétique.
La Charte du Mandé, proclamée en 1236, affirme des principes que l’on retrouvera plus de cinq siècles plus tard dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789) ou la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948). Le droit à la vie, la condamnation de l’esclavage, la libre disposition de son travail, le respect du prochain ; ces idées ne sont pas nées sur les bancs du Parlement français, mais, peut-être, sur les terres du Mandé, entre le bruit des calebasses et le grondement du djembé.
Il serait naïf de prétendre que la charte mandingue équivaut juridiquement aux déclarations européennes. Mais il serait tout aussi faux de la reléguer au rang de simple mythe. Dans l’article sur la faim et l’esclavage, dans le serment des chasseurs appelant à la fraternité et à la justice, dans l’idée que toute vie est une vie, on perçoit une éthique radicalement humaine. Une souveraineté fondée non sur le droit divin ni la domination de classe, mais sur l’interdépendance et la reconnaissance mutuelle.
Dans cette tradition, la propriété du travail n’est pas une abstraction bourgeoise ; c’est une évidence sociale. L’individu n’est pas seul, il est responsable de sa famille, de sa terre, de sa parole. Et la paix civile n’est pas imposée d’en haut, elle est le fruit d’un équilibre entre devoirs et droits, mémoire et avenir.
Dans l’Afrique contemporaine, marquée par les inégalités, les conflits ethniques, les résidus d’esclavage par ascendance, ces mots anciens résonnent étrangement comme des mots d’ordre. Ils nous rappellent que les valeurs universelles n’ont pas de centre unique, qu’elles peuvent naître aussi bien dans une assemblée de griots que dans un hémicycle éclairé au gaz.
Ce texte est une prière faite à voix haute contre l’effacement. Et c’est cela qui dérange : la capacité des vaincus à léguer un idéal.
Car dans cette charte, il ne s’agit pas simplement d’un passé glorieux à brandir, mais d’un futur à reconquérir. Une manière de dire que l’afrofuturisme ne commence pas dans les galaxies fictives, mais dans les plis de nos mémoires.
La polémique des origines
À première vue, la Charte du Mandé semble être une relique glorieuse, un témoignage du génie politique africain précolonial. Mais derrière cette image lumineuse couvent des braises de controverse, attisées par les débats académiques les plus vifs. Car la question qui hante les historiens n’est pas tant ce que dit la charte, mais ce qu’elle est vraiment.
Pour Jean-Loup Amselle, anthropologue réputé, et Francis Simonis, historien de l’Université d’Aix-Marseille, l’affaire est claire : la Charte du Mandé est une reconstruction contemporaine. Elle serait, selon eux, le produit d’une volonté de doter l’Afrique d’un ancêtre des droits de l’homme, un geste guidé plus par l’idéologie afrocentriste que par une rigueur historique. Simonis va plus loin : il évoque “l’invention” de la charte, au sens archéologique du terme ; une création datée de 1998, lors d’un atelier à Kankan, en Guinée, où plusieurs versions orales ont été fusionnées pour produire un texte unifié.
Le reproche principal ? L’absence de sources écrites médiévales, la variabilité des récits oraux, la confusion entre le Serment des chasseurs de 1222 et la Charte de Kouroukan Fouga de 1236. À leurs yeux, l’UNESCO aurait commis une erreur en classant cette charte comme patrimoine culturel immatériel sans s’assurer de sa vérifiabilité scientifique.
Mais à cette approche positiviste, d’autres opposent une autre vision, plus ancrée dans les réalités africaines. Pour Éric Jolly et Noël Sanou, spécialistes de l’oralité et de la culture mandingue, cette charte n’est pas une invention, mais une transformation. Elle évolue comme tout texte oral, s’adapte, s’actualise, sans cesser d’être authentique. Car dans les sociétés africaines, la parole vivante a valeur d’archive. Le griot est à la fois mémoire et médiateur, et le récit ne ment pas : il traduit une vérité sociale, non une chronologie figée.
Le débat n’est pas seulement historique, il est profondément éthique. En 2009, lorsque l’UNESCO inscrit la Charte du Mandé au patrimoine mondial, elle choisit de reconnaître la légitimité d’un récit africain. Mais ce choix soulève une question vertigineuse : faut-il que l’Afrique prouve son passé par des manuscrits pour qu’il soit crédible ? L’écrit doit-il primer sur l’oral pour qu’un texte entre dans la mémoire collective mondiale ?
Dans le fond, la controverse révèle une fracture plus large : celle entre deux conceptions de la vérité. L’une, froide et factuelle, réclame des preuves tangibles. L’autre, plus intuitive, voit dans la Charte un symbole puissant, une déclaration de principes enracinée dans la pensée africaine. Et au croisement de ces deux feux, une interrogation demeure : la vérité historique est-elle plus précieuse que la vérité symbolique ?
Peut-être que, parfois, ce sont les fictions collectives qui portent les plus grands élans de liberté.
Le Mali contemporain et ses contradictions
On l’invoque avec ferveur lors des commémorations nationales. Elle trône sur les affiches pédagogiques, citée dans les discours présidentiels comme un patrimoine de fierté. Et pourtant, dans le Mali d’aujourd’hui, la Charte du Mandé ressemble parfois à un miroir fendu. Elle reflète autant qu’elle déforme. Elle éclaire des idéaux qu’elle n’a pas su faire advenir.
Car derrière les célébrations officielles, une autre réalité subsiste ; têtue, brutale, insupportable. Celle de l’esclavage par ascendance, encore bien présent dans plusieurs régions du pays, notamment chez les Soninké. Des femmes interdites de mariage, des enfants privés d’éducation, des familles stigmatisées pour être « de naissance servile ». En 2021, au moins vingt personnes ont été emprisonnées au motif… qu’elles réclamaient la fin de cette hiérarchie sociale ancestrale. Ce n’est pas une légende. C’est une plaie ouverte, dans une république qui se targue de porter une charte antiesclavagiste vieille de huit siècles.
À ces contradictions s’ajoutent les tensions ethniques, les milices communautaires, les conflits fonciers, et une crise de légitimité de l’État central. Comment parler de paix, de justice et de solidarité (les mots mêmes de Kouroukan Fouga) quand le tissu social est lui-même lacéré ?
Un jeune activiste de Kayes, interrogé dans un reportage de la BBC, l’a dit avec une ironie cinglante :
“Ils nous parlent de Soundiata… mais dans mon village, les jôn ne votent pas.”
Sa phrase claque comme un rappel à l’ordre. Elle dit l’écart entre le récit fondateur et le quotidien, entre la promesse et le vécu.
Peut-on dès lors réactiver un texte ancien comme projet d’émancipation moderne ? Peut-on relire la Charte du Mandé non comme une relique, mais comme un manifeste ? C’est là tout l’enjeu. Il ne s’agit pas de sacraliser un passé glorieux, mais de s’en emparer pour transformer le présent. D’en faire non pas un musée, mais une matrice politique. Une boussole dans les tempêtes contemporaines.
Reste une exigence : que les principes proclamés à Kouroukan Fouga ne servent pas à masquer les injustices, mais à les combattre. Que la parole du griot ne soit pas une incantation vide, mais une invitation à l’action. Autrement dit : faire de la charte non un mythe qui endort, mais une vérité qui dérange ; et qui pousse à agir.
Ce que le Mandé nous dit encore
Le crépuscule est revenu. Le vieux griot est toujours là, sous le même baobab, ses mains calleuses posées sur le bois de son ngoni. Sa voix, râpeuse et lente, s’effile dans le soir qui tombe. Il n’a pas changé de place, mais le monde autour de lui, lui, vacille. Les téléphones filment, les enfants écoutent distraitement, les anciens hochent la tête — et pourtant, quelque chose, dans l’air, demeure solennel.
Il murmure un dernier vers, comme on ferme un livre sans le clore vraiment :
“La parole que j’ai dite, je l’ai reçue. Que celui qui l’entend sache qu’elle ne m’appartient pas. Elle vient de plus loin, et va plus loin encore.”
La Charte du Mandé ne prouve peut-être rien. Elle n’a ni codex, ni sceau, ni date gravée dans la pierre. Elle flotte entre les siècles, comme un papyrus invisible. Mais ce qu’elle affirme (la dignité humaine, la solidarité comme loi, la liberté comme socle) touche à l’essentiel. Elle rêve tout. Et c’est peut-être là sa force : elle ne s’impose pas, elle inspire.
Dans un monde où les récits dominants étouffent les voix minorées, dans une Afrique souvent regardée par d’autres avant de s’écouter elle-même, la Charte du Mandé chuchote un contre-récit. Elle invite à penser l’histoire non comme un monopole européen, mais comme une polyphonie où l’Afrique n’est pas seulement actrice, mais aussi autrice.
Car finalement, ce texte-là n’est pas fait pour être lu dans le silence d’une bibliothèque. Il est fait pour être dit, repris, réinventé ; et surtout, vécu.
Dans chaque mot de cette charte souffle une urgence : celle de croire qu’une autre histoire africaine est possible ; et peut-être, déjà écrite.
Notes et références
- La Charte du Mandé et autres traditions du Mali, éd. Albin Michel, 2003.
- Djibril Tamsir Niane, Sunjata ou l’épopée mandingue, Présence Africaine, 1960.
- CELTHO (Centre d’études linguistiques et historiques par tradition orale), La Charte de Kurukan Fuga. Aux sources d’une pensée politique en Afrique, L’Harmattan, 2008.
- Éric Jolly, « L’épopée en contexte. Variantes et usages politiques de deux récits épiques (Mali/Guinée) », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2010/4, p. 885-912.
- Noël Sanou, « La Charte du Mandé : reconfigurations textuelles et mémorielles », Afroglobe, vol. 1, n°1, avril/mai 2021, p. 72–105.
- Francis Simonis, « Le griot, l’historien, le chasseur et l’Unesco », Ultramarines, n°28, 2015.
- UNESCO, « La Charte du Mandén, proclamée à Kouroukan Fouga », Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, 2009.
- Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, Slavery by descent in Mali must be criminalised, communiqué du 23 mai 2023.
- Al Jazeera, « Slavery is alive in Mali and continues to wreak havoc on lives », 29 octobre 2021.