Avec Noirabe, Rohff prétend transformer une insulte en cri de fierté. Mais derrière l’énergie brute, le morceau révèle surtout une impasse : celle d’une identité tiraillée entre appartenance religieuse et conscience raciale, où le racisme arabe envers les Noirs reste soigneusement évité. Décryptage critique.
Noirabe : cri de rage ou impasse identitaire ?
Avec Noirabe, Rohff frappe fort. Le vétéran du rap français, figure emblématique du 94 et de la diaspora comorienne, choisit de s’approprier un mot lourd de mépris pour en faire le titre de son morceau. Dans la bouche des uns, “Noirabe” est une insulte : elle désigne ces Noirs musulmans accusés de privilégier leur appartenance religieuse à leur conscience raciale, au point de taire ou d’ignorer le racisme arabe envers les Africains. Dans la bouche de Rohff, le terme devient slogan, cri de ralliement et marque identitaire.
Mais derrière ce geste de revanche apparente, une question s’impose : que gagne-t-on vraiment à brandir un mot forgé dans la stigmatisation ? Peut-on transformer une insulte sans en affronter les racines historiques et politiques ? En refusant d’ouvrir le débat sur la traite orientale, le racisme maghrébin ou les hiérarchies de couleur dans le monde musulman, Rohff s’expose à un paradoxe : il revendique le Noirabe tout en incarnant ce que le mot critique.
Plutôt qu’un manifeste, Noirabe révèle ainsi une contradiction profonde : celle d’une identité diasporique écartelée entre fierté noire et loyauté religieuse, mais incapable de nommer toutes les oppressions.
Un mot chargé de contradictions

Le mot Noirabe n’est pas une simple combinaison entre deux identités. Il porte une charge politique et polémique forte. Dans les débats diasporiques et postcoloniaux, il désigne un profil bien précis : celui du Noir musulman qui place son appartenance religieuse au-dessus de sa conscience raciale, au point de passer sous silence, voire de minimiser, le racisme structurel présent dans le monde arabe et musulman.
À l’origine, Noirabe fonctionne comme une insulte communautaire, née dans les marges militantes et dans les échanges de la diaspora noire. Il stigmatise cette attitude jugée contradictoire, voire aliénée : se solidariser avec ses coreligionnaires au mépris de la solidarité noire, alors même que l’histoire des sociétés arabo-musulmanes est marquée par la traite orientale, l’esclavage des Noirs et des hiérarchies raciales persistantes. Autrement dit, être Noirabe, c’est assumer une forme de loyauté religieuse qui invisibilise le racisme vécu par les siens.
En choisissant d’intituler ainsi son morceau, Rohff prétend retourner l’insulte comme un acte de revanche. Mais le problème de fond demeure entier : il revendique le terme sans interroger ce qu’il contient, à savoir une critique du déni. Là où un renversement symbolique devrait déconstruire les mécanismes d’oppression (comme l’usage militant du n-word aux États-Unis), Rohff se contente de brandir l’étiquette comme un slogan identitaire. Résultat : l’insulte n’est pas déconstruite, mais légitimée, vidée de sa portée critique et transformée en produit.
Les Comores et l’islam : un récit partiel



Dans Noirabe, Rohff lance une affirmation tranchée :
« Pour c’qui est des Comores, les arabes ne sont pas venus nous imposer une religion ; ils nous ont pas forcé à oublier nos pratiques ; ça c’est un fait. »
Autrement dit, il présente l’islamisation de l’archipel comme un processus pacifique, naturel, accepté sans contrainte par les populations locales. Ce récit est séduisant pour une partie de la diaspora comorienne : il inscrit l’histoire des Comores dans une tradition religieuse valorisée, où l’islam se transmet comme une évidence spirituelle plutôt que par la violence.
Mais l’histoire documentée est plus complexe. L’islamisation des Comores a été progressive et multi-séculaire, amorcée dès le Xe siècle, renforcée aux XVe–XVIe siècles par l’influence des marchands swahilis, omanais et yéménites. Or, ces circulations s’inscrivaient dans le réseau commercial de l’océan Indien, où l’or, l’ivoire et les épices côtoyaient aussi le commerce des captifs. Les côtes swahilies, dont dépendaient les Comores, jouaient un rôle majeur dans la traite orientale, alimentant les marchés esclavagistes d’Arabie et d’Asie.

Estampe. In Le Monde Illustré, 20 octobre 1877, p. 244. Coll. Musée historique de Villèle. Fonds Michel Polényk, inv. ME.2017.1.51
En affirmant que l’islam est venu “sans contrainte”, Rohff propose donc une vision idéalisée : un islam déconnecté des rapports de domination et des hiérarchies raciales qui ont pourtant accompagné son expansion. Cette omission nourrit précisément la critique contenue dans le terme Noirabe : mettre en avant une appartenance religieuse tout en passant sous silence le racisme arabo-musulman, qu’il soit historique (traite orientale, statut d’abd) ou contemporain (hiérarchies de couleur au Maghreb, discriminations dans le Golfe).
Ainsi, plus qu’un fait établi, la déclaration de Rohff relève d’un récit identitaire partiel : valorisant pour la fierté comorienne, mais qui élude les zones d’ombre. Et c’est justement dans ce décalage entre mythe et histoire que se joue toute la pertinence (ou la fragilité) de la revendication du terme Noirabe.
Force brute, mais une pensée fragile

Sur le plan formel, Noirabe est typique de Rohff : un rap frontal, martelé, où la voix domine la production. Le flow reste énergique, percutant, porté par une diction rugueuse qui a fait sa réputation. Mais si la puissance est intacte, l’habillage musical est minimaliste : une instru sombre, efficace mais sans réelle inventivité. Comparé à la richesse sonore des nouvelles générations (drill, afrotrap, hybridations électro), le morceau sonne classique, presque figé dans une esthétique des années 2000.
L’écriture suit la même logique de force brute. Rohff balance des punchlines comme des uppercuts, sans progression narrative ni argumentaire. On passe du football (« Même absent j’retourne le Parc ») à la géopolitique (« J’écris Free Palestine et fier »), de l’afrofuturisme (« Je ne crois pas en Wakanda ») aux mythes africains (« J’désenvoute Mami Wata »), du métavers à la CAN. Ces références éclatées produisent un effet patchwork : elles impressionnent par leur variété mais peinent à s’organiser en discours cohérent.
Le refrain, répété comme un mantra (« Ça rappe, ça rappe… Noirabe, c’est noirabe »), condense l’esprit du morceau : l’insulte est transformée en slogan, scandé pour frapper les esprits. Mais cette réappropriation reste superficielle : on crie plus qu’on n’explique, on assène plus qu’on ne déconstruit.
Enfin, si l’on sent la sincérité rageuse de l’artiste (une colère nourrie par le rejet et la stigmatisation) cette authenticité se perd dans l’auto-célébration (« J’suis la ref de ton rappeur préféré », « Trop de classiques pour les énumérer »). La posture domine, l’ego prend le dessus, au détriment d’une réflexion construite sur ce que signifie réellement être “Noirabe”.

Au cœur de Noirabe, la contradiction saute aux yeux. D’un côté, Rohff proclame l’unité : il aligne une longue liste de peuples et de communautés ; bantous, soninkés, bambaras, berbères, amazighs, kurdes, tchétchènes, Antillais, “français de souche qui nous jettent pas d’regards louches”. Ce passage se veut fédérateur, un cri de ralliement transcommunautaire contre les fractures raciales.
Mais dans le même souffle, l’artiste se laisse emporter par les invectives. Il attaque “les Bassem”, “les shlags”, les “négros de maison”, les “youtubeurs” et d’autres cibles implicites. L’appel à l’unité se dissout dans une suite de règlements de compte. Résultat : un discours contradictoire, où la main tendue cohabite avec la stigmatisation.
Sur le plan identitaire, la réappropriation de “Noirabe” tombe elle aussi dans une impasse. Revendiquer l’insulte sans l’analyser revient à la légitimer. Surtout, Rohff esquive le point central : le terme dénonce d’abord le déni du racisme arabe vis-à-vis des Noirs. Or, loin d’ouvrir ce débat, il le contourne, préférant brandir l’étiquette comme un slogan viril. Ce faisant, il transforme un outil critique en simple marque de fabrique.
Enfin, Noirabe représente une occasion manquée. Le morceau aurait pu devenir un espace de réflexion sur les discriminations croisées ; ce que signifie, en France, être à la fois noir et musulman, c’est-à-dire cumuler deux stigmates sociaux. Mais au lieu de creuser cette expérience, Rohff s’enferme dans l’ego-trip et la provocation. Il met en scène la colère sans la traduire en analyse, laissant intact le malaise qu’il prétend affronter.
Un symptôme plutôt qu’un manifeste
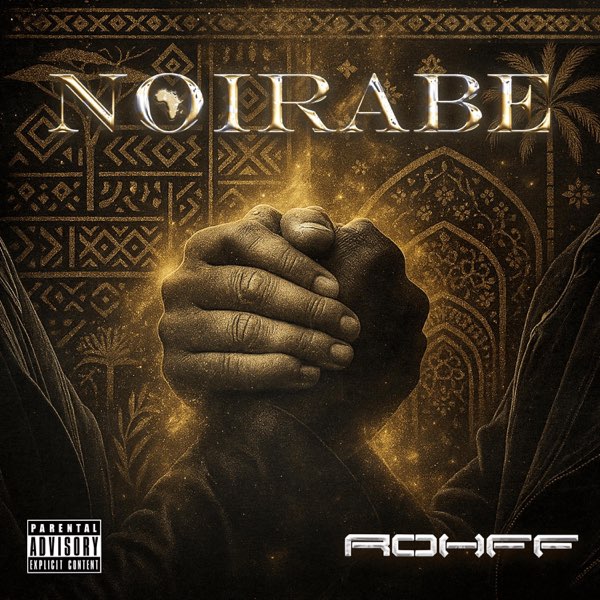
Avec Noirabe, Rohff prétend transformer une insulte en étendard. Mais loin d’un manifeste libérateur, le morceau met surtout en lumière une impasse. Celle d’une posture diasporique qui tente de concilier deux appartenances (noire et musulmane) mais qui, dans les faits, en nie une partie.
En refusant d’affronter la réalité du racisme arabe vis-à-vis des Noirs, qu’il soit historique (traite orientale, hiérarchies esclavagistes) ou contemporain (Maghreb, Golfe), Rohff tombe exactement dans la critique visée par le terme qu’il revendique. Revendiquer “Noirabe” sans l’interroger, c’est reproduire le déni qu’il désigne.
Le morceau n’a donc rien d’un hymne. C’est plutôt un symptôme d’une contradiction identitaire persistante dans une partie de la diaspora : vouloir se réclamer d’une double appartenance, mais au prix d’un silence sur l’une des oppressions.
Voilà pourquoi, chez Nofi, nous ne voyons pas Noirabe comme une œuvre à célébrer, mais comme un objet à examiner. Ce pseudo cri de fierté illustre les non-dits et les fractures qu’il faudrait encore avoir le courage de nommer…
