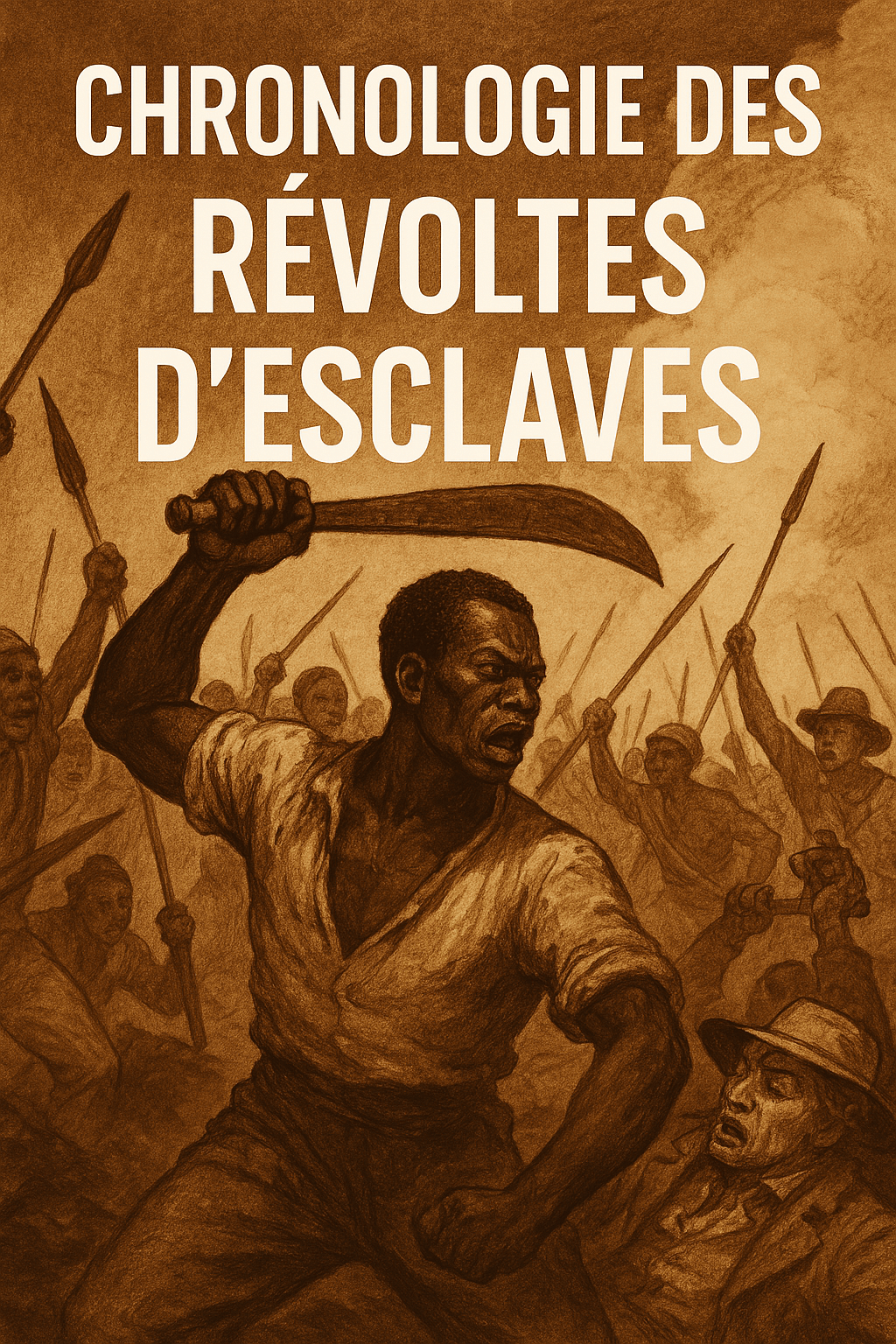Sous la canopée étouffante de l’esclavage sudiste, Denmark Vesey, homme libre et prédicateur, orchestra une insurrection avortée qui hante encore l’histoire américaine. Derrière les procès secrets, les pendaisons massives et les mémoires en conflit, se dessine le portrait d’un visionnaire dont le combat révèle les lignes de fracture raciales, politiques et morales d’une nation en quête de justice.
Sous un chêne aux racines profondes, battu par les vents de Charleston, un homme noir libre se dresse. Dans sa main, une Bible usée, annotée à la marge, tremble à peine sous la lumière du jour qui décline. C’est Denmark Vesey. À ses pieds, le sol n’est pas encore retourné, mais dans son esprit, les germes de l’insurrection sont déjà semés. Il ne tient pas une arme, mais un récit ; celui de l’Exode, celui d’un peuple opprimé, guidé par la foi vers la liberté. Dans le Sud esclavagiste de 1822, ce simple geste devient un acte de rébellion.
La Caroline du Sud d’alors n’est pas simplement un État : c’est un système clos, impitoyable, cimenté par le sang et l’avidité. Les plantations prospèrent sur la chair noire, les lois (les codes noirs) verrouillent chaque mouvement, chaque mot, chaque souffle des Africains réduits en esclavage. Dans cette société panoptique, où la terreur est un langage officiel, les hommes comme Vesey sont des anomalies, des fissures dans le récit blanc du contrôle total.
Et pourtant, l’histoire de Denmark Vesey ne se résume pas à une “conspiration avortée”. Elle éclaire les brèches de l’empire esclavagiste ; ces zones d’ombre où s’enchevêtrent les révoltes atlantiques, les églises noires subversives, les promesses inabouties des Révolutions française, haïtienne et américaine. Vesey, en tant qu’individu, défie les catégories : libre mais surveillé, pieux mais dangereux, charpentier mais stratège. L’épisode qui porte son nom est bien plus qu’un soulèvement étouffé dans l’œuf ; c’est une éruption mémorielle, une onde de choc que l’Amérique peine encore à regarder en face.
Le tissu de l’enfance et de l’affranchissement
Denmark Vesey naît vers 1767 sur l’île de Saint‑Thomas, alors colonie danoise, carrefour tourmenté des routes atlantiques et matrice de multiples appartenances. Certains récits (transmis de bouche à oreille ou ressuscités par des biographes) le disent d’origine Coromantee, ces peuples Akan d’Afrique de l’Ouest réputés pour leur combativité, d’autres penchent pour une ascendance Mandé. Ce flou n’est pas une faiblesse documentaire mais une preuve vivante de la condition diasporique ; celle d’hommes arrachés à la géographie, mais porteurs d’un héritage résilient et indéfinissable.
À quatorze ans, il est acheté par le capitaine Joseph Vesey, négrier bermudien. Son sort bascule : il voyage, assiste aux transactions humaines, sert d’interprète. Il maîtrise l’anglais, le français, l’espagnol ; des langues qui, loin de le libérer, lui ouvrent pourtant les couloirs secrets de la traite et des colères muettes. Cette pluralité linguistique ne le rend pas simplement utile ; elle fait de lui un pont entre les mondes, un observateur malgré lui des structures du pouvoir colonial.
Ses allers‑retours entre la Martinique, les Bermudes et la Caroline dessinent une cartographie intime de l’Atlantique noir. Ce n’est pas un esclave des champs : c’est un homme du passage, du port, du seuil. Un témoin des révoltes larvées, des codes corrompus, des évangiles manipulés. Il ne vit pas dans un seul monde ; il vit dans plusieurs simultanément, à une époque où cela, pour un homme noir, est déjà une forme d’hérésie. Ce parcours esquisse les prémices de ce que l’on appellerait plus tard la “transnationalité noire” : un enchevêtrement d’identités et de résistances qui dépasse les frontières imposées par les empires.
En 1799, la chance frappe à la porte de Telemaque sous une forme aussi improbable que symbolique : un billet de loterie gagnant. Avec 1 500 dollars en main (somme vertigineuse pour un homme noir dans une société esclavagiste) il achète sa liberté pour 600 dollars. Cet acte n’est pas seulement une transaction : c’est une métamorphose. Il délaisse le nom imposé par le capitaine Vesey et se rebaptise Denmark, hommage à la nation coloniale qui l’a vu naître, peut-être aussi une subtile provocation envers l’Amérique esclavagiste.
Libre, mais pas libéré. Car Beck, sa femme, demeure en esclavage, tout comme leurs enfants, captifs d’une loi cynique (partus sequitur ventrem) qui déclare que l’enfant suit le statut de la mère. Vesey tente, en vain, de racheter leur liberté. Le refus du maître n’est pas anodin : il est le rappel brutal que même l’argent, quand il vient d’un homme noir, ne rachète pas l’entièreté de l’humanité. La liberté de Vesey est donc incomplète, bancale, rongée par l’absence. C’est une liberté à huis clos, surveillée, mutilée.
Pourtant, il s’élève. Artisan respecté, charpentier habile, il fonde une entreprise et travaille pour des clients blancs comme noirs. Mais son vrai chantier se construit ailleurs : dans les cœurs. Vesey devient prédicateur, d’abord dans la Second Presbyterian Church, puis au sein de l’African Methodist Episcopal Church. Son autorité morale, sa maîtrise des Écritures et son charisme en font une figure d’admiration et d’influence dans la communauté noire de Charleston. Il incarne un paradoxe insupportable pour la ville blanche : un homme noir, libre, cultivé, respecté ; et potentiellement dangereux.
Son existence même est une réfutation vivante du système esclavagiste. Sa liberté devient une provocation. Son discours, une menace. Son respect, une hérésie.
Processus d’une révolution — Planification, inspiration, colères
Dans une ville où l’écriture pouvait condamner un esclave à la mutilation, l’AME Church (African Methodist Episcopal) fut une anomalie, un lieu de mots et d’espoir. Fondée en 1818, cette congrégation noire indépendante, deuxième plus grande de la nation, offrait plus qu’un refuge spirituel : elle était un atelier de conscience collective. Un endroit où se forgeait une théologie de la libération, nourrie à la fois par les versets bibliques et les récits de résistance. Pour les autorités blanches, l’AME n’était pas une église, mais une école clandestine, un foyer de sédition.
Denmark Vesey, prédicateur charismatique et lecteur vorace, y trouvait une tribune. Il brandissait l’Exode comme une promesse divine, prêchait que Dieu lui-même s’opposait aux maîtres d’Égypte ; et par extension, aux planteurs de Caroline du Sud. Il n’inventait rien : il traduisait, actualisait, armait les Écritures contre l’ordre esclavagiste. Là où d’autres voyaient soumission, Vesey lisait insurrection.
Le choix du 14 juillet 1822, comme date du soulèvement projeté n’était pas une coïncidence. C’était un écho. Aux cris qui avaient renversé les rois à Paris. Aux machettes levées qui avaient aboli l’esclavage à Saint-Domingue. C’était l’alignement volontaire de la cause noire avec une tradition révolutionnaire transatlantique ; un message codé autant qu’une stratégie politique. Si la Révolution française avait proclamé la liberté, si Haïti avait prouvé sa faisabilité, alors Charleston devait être le prochain maillon.
L’AME, Bastille, Haïti ; trois pôles, trois étoiles dans la constellation de la colère noire. Vesey ne complotait pas dans l’ombre : il construisait une mémoire partagée. Une vision. Un souffle.
Dans l’arrière-cour de Charleston, loin des salons blanchis à la chaux et des marchés aux esclaves, un murmure courait ; un souffle transmis de bouche à oreille, de chaumière en église, de la ville aux plantations. Denmark Vesey, aidé de prédicateurs et d’anciens camarades de l’AME, tissait un réseau (invisible mais vaste) ancré dans les familles, les amitiés, les serments partagés entre esclaves et affranchis. Il s’appuyait sur la force de la parenté élargie et sur les canaux anciens de la tradition orale. C’était une organisation sans parchemin, sans drapeau, mais avec une mémoire vivante et une mission claire.
Le plan était audacieux. S’emparer de l’arsenal de Meeting Street, libérer les esclaves, éliminer les maîtres. Puis, une fois la ville de Charleston prise, embarquer sur des navires marchands et naviguer vers Haïti ; cette terre noire libre, encore auréolée de la victoire contre l’esclavage. Le spectre de la révolution haïtienne, qui avait hanté les nuits blanches depuis 1804, revenait sous forme d’écho dans les prêches et les murmures de Vesey. Là-bas, les esclaves avaient triomphé. Ici, on s’apprêtait à suivre leurs traces.
Mais comme souvent dans les révoltes étouffées avant d’éclater, la brèche s’ouvrit depuis l’intérieur. Deux esclaves, George Wilson et Joe LaRoche, porteurs d’un profond conflit moral, devinrent les pivots du renversement. Wilson, métis loyal envers son maître, fut mis au courant par LaRoche, qui, lui, avait initialement soutenu le soulèvement. Face au vertige de la décision (participer à une rébellion aux risques immenses ou dénoncer ses frères pour sauver sa propre peau) les deux hommes choisirent la délation.
Leur témoignage fut décisif. Il confirma des rumeurs précédentes, éveilla la méfiance de la ville, et déclencha une répression foudroyante. L’histoire retiendra leur choix comme une tragédie, non seulement pour ce qu’ils ont dit, mais pour ce qu’il révèle : le dilemme déchirant entre loyauté collective et survie individuelle. C’est peut-être là l’une des grandes ironies du projet Vesey ; que sa chute ait été précipitée par des hommes qu’il voulait également libérer.
La répression judiciaire — Justice expéditive et secret de procédure
Lorsque les premiers noms tombèrent (Denmark Vesey, Rolla Bennett, et d’autres) la ville de Charleston ne convoqua pas un tribunal ordinaire, mais une juridiction d’exception : la Cour des Magistrates and Freeholders. Un nom noble, presque rassurant, mais derrière lui, une mécanique judiciaire opaque, violente, expéditive. Les auditions se tinrent à huis clos. Les accusés, noirs libres ou esclaves, n’eurent ni avocat, ni confrontation avec leurs accusateurs, ni la possibilité de se défendre autrement qu’en proclamant leur innocence, souvent en vain.
Les témoignages ? Obtenus sous pression, parfois sous menace de mort, souvent dans les entrailles du Charleston Workhouse, où les sévices physiques faisaient partie de l’interrogatoire. Même les délateurs comme George Wilson n’échappaient pas à l’ambiguïté d’un système où la confession, forcée ou non, était la clé de la survie. Tout cela se déroulait dans un silence médiatique presque total ; la presse locale suspendue, le récit maîtrisé de bout en bout par les autorités.
Dans ce théâtre d’ombres, les standards judiciaires en vigueur pour les citoyens blancs furent sciemment ignorés. Habeas corpus, confrontation des témoins, défense par des pairs ; rien de tout cela ne fut appliqué. Le simulacre judiciaire ne visait pas la vérité mais l’exemple. L’efficacité de la terreur. La restauration de l’ordre symbolique.
Le 2 juillet 1822, Denmark Vesey et cinq autres hommes furent pendus. Aucun n’avait confessé. Aucun n’avait renoncé à sa dignité. Le message, lui, était clair : l’élite blanche avait senti le souffle chaud d’une insurrection potentielle, et elle comptait bien refroidir l’atmosphère par le gibet. Loin d’apaiser la ville, ces exécutions inaugurèrent une nouvelle ère de répression ; une politique de soupçon généralisé, où toute aspiration noire à la liberté était assimilée à un crime contre l’État.
Après les premières pendaisons, la machine répressive s’emballe. Le frisson de panique dans les rangs de l’élite blanche devient une stratégie d’extermination politique. Entre juillet et août 1822, la Cour multiplie les arrestations : 131 hommes noirs, libres ou esclaves, sont inculpés. La logique de cette vague est claire ; étendre les filets, frapper large, étouffer toute braise susceptible de ranimer l’incendie.
Mais plus le filet s’élargit, plus la trame s’effiloche. Les témoignages deviennent flous, contradictoires, parfois absurdes. Certains accusés, pour éviter la corde, dénoncent des dizaines d’autres, parfois au hasard, parfois sous la menace. Les confessions se contredisent, les dates divergent, les complots s’enchevêtrent ; et pourtant, la Cour continue de juger, de condamner, d’exécuter.
Sur les 131 inculpés, 67 sont reconnus coupables. Trente-cinq d’entre eux sont pendus. Trente-et-un sont déportés, souvent vers Cuba, sans procès équitable ni recours. Les autres sont relâchés, non pas blanchis, mais simplement écartés faute de preuves “utiles”. Les motifs réels des condamnations varient peu : “intention de participer”, “connaissance du complot”, “sympathie avec les meneurs”. La loi n’a plus besoin de faits, seulement d’ombres projetées sur les murs d’une salle close.
Cette répression, aux allures d’épuration politique, s’appuie sur une peur savamment entretenue. L’absence de preuve tangible (aucun arsenal trouvé, aucun document intercepté) devient un détail secondaire. Le danger n’a pas besoin d’être réel ; il suffit qu’il soit perçu. Et cette perception, alimentée par les récits déformés, les rumeurs hystériques, les récits sur Haïti ou le Missouri Compromise, offre aux autorités l’outil parfait : un complot invisible justifie toutes les violences visibles.
Ainsi, la mémoire du “complot Vesey” devient autant un fait historique qu’un mythe mobilisateur : un avertissement gravé dans la chair noire, un récit répété dans les cercles de pouvoir pour légitimer le durcissement des lois, l’abolition des libertés noires, et la surveillance permanente de ceux qu’on soupçonne (toujours) de vouloir redevenir libres.
Après l’exécution ; Terreur institutionnelle et mémoire gardienne
À peine les exécutions achevées, la vengeance ne s’arrête pas aux cadavres. Elle s’étend aux vivants, aux institutions, aux libertés embryonnaires. L’insurrection avortée de Denmark Vesey devient le prétexte d’un renforcement brutal de l’ordre esclavagiste. Le législateur blanc, ébranlé, ne cherche pas à comprendre les causes du soulèvement, mais à ériger des remparts juridiques contre tout ce qu’il suppose subversif.
Première cible : la manumission. Déjà restreinte, elle devient quasi impossible. Dorénavant, pour affranchir un esclave, il faut le vote à la majorité des deux chambres de l’Assemblée ; autant dire que la liberté individuelle devient un acte d’État. Ensuite, le Negro Seamen Act (1822) interdit aux marins noirs libres de quitter leurs navires sans être immédiatement emprisonnés durant leur escale à Charleston. Sous prétexte de prévenir la contamination idéologique, l’État transforme son port en prison à ciel ouvert. Chaque navire devient un vecteur potentiel de rébellion, chaque marin, un messager de liberté à bâillonner.
L’AME Church, cœur spirituel et politique du soulèvement, est rasée. Officiellement, pour “trouble à l’ordre public”. En réalité, parce qu’elle offrait aux Noirs un espace d’auto-organisation, de lecture, de foi décolonisée. Le pasteur Morris Brown est banni de l’État. La congrégation se disperse, se cache, survit en silence.
Mais la répression ne s’arrête pas là. Elle se grave dans la pierre. En 1829, l’État fait ériger un arsenal militaire en plein cœur de Charleston ; le Citadel. Forteresse et symbole, ce bastion militaire a pour mission de défendre la ville non contre une armée étrangère, mais contre sa propre population noire. L’architecture devient politique : mur, tour, uniforme ; autant de réponses à une peur blanche institutionnalisée.
Derrière cette escalade autoritaire, deux figures s’opposent : James Hamilton, maire de Charleston et maître d’œuvre de la répression, incarne le poing fermé. Thomas Bennett, gouverneur modéré, s’alarme de la brutalité du procès et du mépris du droit. Mais la peur a déjà tranché. Dans l’opinion blanche, Vesey est devenu un spectre à conjurer, un prétexte à durcir la loi. Dans ce bras de fer, Hamilton l’emporte. Il ne sauve pas Charleston ; il en transforme le cœur en garnison.
L’histoire, comme la justice, n’est jamais neutre ; et la mémoire de Denmark Vesey en est la preuve. Dès le XIXe siècle, deux récits émergent : l’un, dominant, forgé par les magistrats de Charleston, décrit une vaste conspiration noire déjouée in extremis. L’autre, plus souterrain, questionne la véracité de cette version, suspecte une manipulation politique, voire une invention délibérée pour réprimer toute velléité d’émancipation.
En 1964, l’historien Richard Wade marque un tournant. Dans une étude pionnière, il déconstruit le récit officiel et suggère que la “conspiration Vesey” aurait été, au mieux, une idée mal structurée, au pire, un prétexte à une purge raciale. Aucune arme retrouvée, aucun plan écrit, des témoins contradictoires, des procédures judiciaires expéditives : Wade évoque “de la colère, beaucoup de rumeurs, mais peu de faits”. Une thèse dérangeante, qui place la responsabilité du mythe Vesey entre les mains des autorités blanches.
En 2001, Michael P. Johnson pousse plus loin. Il critique la crédulité avec laquelle les historiens, jusque-là, avaient pris pour argent comptant les procès-verbaux biaisés du tribunal. Pour lui, l’absence de confrontation des témoins, les aveux arrachés sous pression, et l’instrumentalisation de la peur forment un théâtre politique ; une mise en scène destinée à réaffirmer le contrôle blanc.
Face à eux, une autre école s’élève : Douglas Egerton, James O’Neil Spady, Lacy Ford. Ces historiens défendent la plausibilité (voire l’authenticité) du complot. Ils s’appuient sur des témoignages précoces non contraints (ceux de George Wilson et Joe LaRoche), sur le rôle de la communauté noire dans la mémoire orale du soulèvement, et sur les liens documentés entre Vesey et l’AME Church. Pour eux, nier l’existence du plan revient à sous-estimer la capacité d’organisation des esclaves et à effacer une expression authentique de résistance.
La comparaison avec Nat Turner, dont la révolte sanglante a éclaté en 1831 en Virginie, révèle une autre strate de cette bataille mémorielle. Là où Vesey est présenté comme un comploteur fantasmatique dans une conspiration supposée, Turner devient, malgré les massacres, une figure réduite, isolée, maîtrisée. L’État de Virginie choisit alors de minimiser la menace pour contenir la panique. La Caroline du Sud, en revanche, amplifie le spectre Vesey pour durcir ses lois. Deux insurrections, deux usages inverses de la peur : l’une pour calmer, l’autre pour radicaliser.
Ainsi, la mémoire de Vesey ne se divise pas entre vrai et faux, mais entre mémoire instrumentalisée et vérité complexifiée. Ce n’est pas tant la véracité des faits que leur fonction sociale qui définit leur place dans l’histoire. Et cela, dans une Amérique où les récits noirs sont trop souvent filtrés, fragmentés ou effacés, est peut-être la leçon la plus urgente.
Héritage et résonances contemporaines
L’histoire de Denmark Vesey ne s’est pas arrêtée à la potence. Elle s’est déplacée (lentement, douloureusement) dans les rues de Charleston, dans ses parcs, ses plaques commémoratives, ses controverses. Elle est devenue mémoire disputée, question vive plantée dans le sol d’une ville encore marquée par ses fondations esclavagistes.
En 1976, le gouvernement fédéral désigne la Denmark Vesey House comme National Historic Landmark. Ironie amère : la maison n’était presque certainement pas la sienne. Mais qu’importe ; dans une ville où tant de traces de la résistance noire ont été effacées, ce geste sonne comme un acte de restitution, même approximatif. Une décennie plus tard, la municipalité de Charleston commande un portrait officiel de Vesey. Suspendu un temps dans un auditorium municipal, il cristallise les tensions. Faut-il afficher l’image d’un homme accusé d’avoir voulu tuer des Blancs ? Pour certains élus, c’est impensable. Pour d’autres, c’est un devoir.
Il faut attendre 2014 pour qu’un véritable monument lui soit consacré, érigé dans Hampton Park ; à l’écart du centre touristique, loin du marché aux esclaves devenu lieu d’attraction. La statue représente Vesey en charpentier, Bible à la main, visage tendu vers un avenir qu’il n’a pas connu. Le choix du lieu, discret, presque camouflé, en dit long. Vesey est reconnu, mais pas pleinement réintégré. Son effigie est tolérée, mais son message reste inconfortable.
Car au cœur de la controverse se niche une question brûlante : Denmark Vesey était-il un terroriste ou un libérateur ? Un précurseur de la liberté ou un agitateur sanguinaire ? Cette fracture n’est pas simplement idéologique ; elle est raciale. Dans bien des discussions, le regard porté sur Vesey révèle une Amérique à deux vitesses mémorielles : celle qui canonise ses rebelles blancs (de la Tea Party à John Brown), et celle qui hésite, tergiverse, voire condamne ses figures noires de résistance.
Aujourd’hui encore, son nom divise. Il incarne moins un passé figé qu’un miroir tendu à une société qui peine à nommer ses héros quand ceux-ci sont noirs, insoumis, et porteurs d’un projet de justice radicale.
En 2020, au cœur d’une saison de la NFL marquée par les hommages silencieux à des figures noires de la résistance, un détail attire l’attention : DeAndre Hopkins, receveur vedette des Arizona Cardinals, porte sur son casque un nom que peu de spectateurs reconnaissent immédiatement ; Denmark Vesey. Aucun slogan. Aucune explication. Juste un nom, gravé en lettres blanches, posé comme une énigme sur le cuir noir du casque.
Ce choix n’est pas anodin. Hopkins ne cite pas un militant contemporain, ni une victime récente de violences policières. Il convoque une mémoire plus ancienne, plus complexe ; celle d’un homme qui, en 1822, fut exécuté pour avoir rêvé, et préparé, une révolte de masse contre l’esclavage. Ce geste de réappropriation, discret mais percutant, révèle une vérité essentielle : Vesey, longtemps enfermé dans les manuels d’histoire ou les marges des archives judiciaires, revient dans l’arène publique comme symbole d’une insoumission noire intemporelle.
À travers ce nom, Hopkins souligne une continuité : celle des figures qui, dans leur époque respective, ont refusé la servitude, même au prix de leur vie. Il rappelle aussi que les héros ne portent pas toujours l’uniforme d’un soldat ou la toge d’un avocat ; parfois, ce sont des hommes debout dans l’ombre, tenant une Bible et un plan. Vesey, homme libre mais incomplet, artisan du visible et du caché, continue de hanter l’Amérique. Non comme un fantôme vengeur, mais comme une voix têtue, qui murmure : la liberté ne se demande pas, elle se construit ; morceau par morceau, mot après mot, jusqu’à ce que la peur change de camp.
Reconnaissance, complexité, responsabilité
Denmark Vesey n’était pas une chimère, ni un fantasme agité par les élites blanches en quête de contrôle. Il fut chair, souffle et volonté ; un homme libre dans une ville qui ne supportait pas l’idée d’une liberté noire. Il n’agissait pas seul ; il portait avec lui les douleurs d’une communauté dispersée, enracinée dans l’Atlantique, liée par la mémoire de Saint-Domingue, les psaumes de l’Exode, les silences d’églises souterraines. Sa détermination n’était pas celle d’un fanatique, mais d’un homme que l’injustice avait rendu lucide.
L’affaire Vesey nous enseigne davantage sur le pouvoir que sur le complot. Elle dévoile comment la peur peut être cultivée comme un outil politique, comment l’ordre peut se travestir en justice, comment la répression peut se justifier par l’invisible. Chaque confession arrachée, chaque pendaison prononcée sans preuve matérielle, chaque loi durcie après coup nous rappelle que l’histoire, lorsqu’elle est laissée aux mains des dominants, se transforme souvent en arme contre la vérité.
Reconnaître Vesey aujourd’hui, ce n’est pas le sanctifier à tout prix. C’est accepter ses zones d’ombre, ses contradictions, les débats qu’il suscite encore. Mais c’est surtout assumer qu’il a posé une question à laquelle aucune société juste ne peut se dérober : qu’est-ce qu’un homme libre dans un monde d’esclaves ? Et que faut-il risquer pour y répondre avec dignité ?
Face à l’oubli organisé, à la marginalisation des figures noires dans la mémoire publique, l’histoire de Denmark Vesey nous oblige. Elle nous force à écrire autrement, à regarder en face ceux que l’on a trop longtemps désignés comme des menaces, quand ils étaient, en réalité, des éclaireurs.
Sources
- Douglas R. Egerton, He Shall Go Out Free: The Lives of Denmark Vesey, Madison House, 1999.
- David M. Robertson, Denmark Vesey, Alfred A. Knopf, 1999.
- John Oliver Killens, Great Gittin Up Morning: The Story of Denmark Vesey, Doubleday, 1972.
- Lillie Johnson Edwards, Denmark Vesey, Chelsea House, 1990.
- John Lofton, Insurrection in South Carolina, Antioch Press, 1964.
- Michael P. Johnson, « Denmark Vesey and His Co-Conspirators », William and Mary Quarterly, vol. 58, no 4, 2001.
- Robert S. Starobin, Denmark Vesey: The Slave Conspiracy of 1822, Prentice-Hall, 1971.
Sommaire